Introduction
Les organisations du travail social ne sont pas « compliquées » : leurs missions sont clairement définies dans un Code qui regroupe de manière cohérente l’ensemble des actions sociales et leur confère une structure qui fait sens. Mais les organisations du travail social sont « complexes » en ce sens qu’elles traitent de phénomènes personnels, collectifs et sociétaux où interagissent de manière aléatoire des éléments hétérogènes et imprévisibles. Pour traiter ces questions complexes, il faut des réponses complexes. Une réponse simple ne traite pas la complexité de la question. Bref, si le compliqué doit être simplifié, le complexe, lui, doit se comprendre.
Il n’est donc pas compliqué d’envisager la fonction de chef de service. Mais il est essentiel de la penser dans toute sa complexité, complexité étroitement liée à la complexité des organisations du travail social.
Pour tenter d’éclairer ce tableau des fonctions, je vous propose de concevoir une stratégie d’encadrement des équipes des établissements et services sociaux et médico-sociaux appuyée sur un trépied dont chaque pied est, en fait, un contrepied :
- 1°) En contrepied à la tentation totalisante : la dynamique du manque ;
- 2°) En contrepied à l’illusion du consensus : la culture de la conflictualité ;
- 3°) En contrepied à la loi du plus fort : la construction des désaccords.
Il s’agit d’un trépied – ces petits tabourets utilisés pour la traite des vaches dans les étables assurant une stabilité sur un sol inégal – c’est-à-dire d’une configuration ou chacun est indispensable à l’autre :
- Le manque sans la reconnaissance des différentes positions des acteurs complémentaires c’est le vide ;
- La conflictualité des positions sans élaboration et compréhension des intérêts en présence, c’est la guerre ;
- Un travail sur ce qui fait désaccord entre les acteurs sans reconnaître que chacun est insuffisant dans le système est juste une manipulation et non une résolution.
Réfléchir la stratégie à partir de la position de chef de service, dans un contexte d’incertitude, d’instabilité et en terre de complexité, suppose de se donner des points d’appui solides. Mais ce ne sont pas des certitudes rigides, tout au plus quelques convictions fortes trempées dans une éthique de la fragilité. En effet, diriger, aujourd’hui, ce n’est pas être puissant et autoritaire – arguments incompatibles avec la complexité – mais savoir composer avec nos manques, en tenant compte des intérêts en présence – et particulièrement ceux des usagers – et en tentant d’associer toutes les parties prenantes dans la conflictualité inhérente aux systèmes d’action.
- La dynamique du manque
- Au fondement de l’expérience humaine : le manque
Naître femme ou homme, c’est faire l’expérience du manque, du sexe que l’on n’a pas. Ce fondement anthropologique modélise le rapport au monde de chacun d’entre nous. Au-delà de l’expérience individuelle, l’homme-social fait également l’expérience du manque car toute rencontre de l’autre convoque un rapport d’altérité. L’altérité, c’est cette pièce à deux faces qui, d’un côté, renvoie à ce qui m’est commun à autrui et, de l’autre, ce qui reste radicalement marqué par la différence. Au plan collectif également, nos sociétés, du fait notamment de la division sociale des fonctions, sont des lieux où s’éprouve le manque : inégalités, rejets, peurs, incompréhensions entre communautés, jalousies, distinctions de classes, etc.
J’ai conscience, ici, d’enfoncer quelques portes déjà ouvertes depuis des lustres par les philosophes, les psychanalystes, les sociologues ou les psychosociologues, mais ce rappel ne vise qu’à nous redire que notre manière de voir le monde, de nous y situer, d’y agir, est systématiquement marquée par cette expérience fondatrice de notre humanité : le manque.
- L’établissement ou le service social ou médico-social : l’incomplétude
Les institutions humaines sont inévitablement marquées par cette expérience du manque. Elles sont, elles-mêmes, des lieux du manque. L’illusion fantasmatique de la toute-puissance, qui fait croire que l’homme pourrait être complet et qu’une institution peut être totale, ne parviennent pas à occulter le fait que toute organisation est incomplète, qu’il y a toujours un ou plusieurs éléments qui font défaut.
Parmi les organisations, celles dédiées au travail social ne font pas exception. Peut-être encore moins que d’autres. En effet, les organisations du travail social sont particulièrement marquées par le manque. Manque parce qu’elles s’adressent à des sujets manquants (les « sans »). Manque parce qu’elles vivent quotidiennement la frustration de ne pouvoir répondre à tous les besoins.
La pensée dominante ne facilite pas cette prise de conscience qui permet de percevoir que les organisations sont incomplètes. Quelques expressions pour illustrer cela : « réponse aux besoins » comme si la tâche était à la hauteur des enjeux, « prise en compte des demandes » comme si la mission n’était pas préalablement définie et limitée, « l’usager au centre » comme si le dispositif construit autour de lui ne recélait aucune faille. A cette idéologie qui emprunte au fantasme de toute puissance, s’ajoutent des éléments de contexte qui accroissent la fragilité du système : contraintes des appels à projets qui formatent les réponses, limitations budgétaires, technocratisation des processus, contrôle bureaucratique tatillon et chronophage, etc. Dans ce contexte, les organisations du travail social doivent résister à cette rationalisation instrumentale qui développe des appétits de cumul qui rendent obèses de trop nombreuses organisations qui confondent développement et grossissement. Non seulement les organisations du travail social doivent assumer le fait d’être des organismes manquants mais elles doivent faire de cette incomplétude un atout pour la clinique.
- Ne pas tout faire : condition du pouvoir d’agir
Car c’est effectivement une des conditions du développement du pouvoir d’agir que de ne pas apporter toutes les réponses aux besoins. Ce positionnement qui fait du manque une chance ouvre deux perspectives :
- D’une part, le fait que l’établissement ou le service n’apporte pas toutes les réponses ouvre un espace à l’identification, la reconnaissance et l’activation des potentiels de l’usager. Au lieu de répondre à sa place, il est appelé à mobiliser ses propres ressources. L’apport des compétences de l’organisation prend alors un caractère subsidiaire aux compétences de l’usager.
- D’autre part, ayant clarifié les compétences manquantes – parce qu’elle ne peut ou ne veut en disposer à l’interne –, l’organisation est appelée à aller les chercher en dehors de son périmètre. C’est le meilleur moyen de développer des dynamiques de réseau dans lesquelles l’usager est également acteur.
Finalement, un travail qui ne repose pas sur l’illusion du plein, favorise une clinique réellement centrée sur le pouvoir d’agir de l’usager.
- Conclusions pour les fonctions d’encadrement
Si nous sommes d’accord pour dire que ce qui caractérise une organisation de travail auprès de personnes vulnérables, se sont ses manques, ses vacuités, ses espaces laissés libres, assumer l’encadrement hiérarchique n’est alors plus « remplir » mais « ouvrir ». La fonction dirigeante s’érige ainsi en art d’associer les acteurs pour aller vers le but fixé. Mais non pas dans le registre de la contrainte qui revient à créer les conditions qui évitent les déviances. Diriger, sous cet angle, c’est articuler les interstices pour donner sens aux énergies qui traversent l’organisation. Au-delà d’assortir des compétences, l’encadrement d’une équipe professionnelle articule des manques, coordonne des espaces en creux qui laissent place tant aux initiatives et créativités des acteurs qu’aux surgissements de nouveaux possibles. Et cette manière d’investir la fonction de direction suppose de ne pas occuper tout l’espace de la décision, tous les lieux du pouvoir. C’est aussi « en creux » que le cadre hiérarchique légitime la place qu’il occupe.
- La culture de la conflictualité
- Au fondement de l’expérience sociale : la conflictualité
Si le manque constitue un fondement de l’’expérience humaine, la conflictualité est un fondement de l’expérience sociale. Manque et conflictualité se situent dans un lien de cause à effet : c’est parce qu’il y a manque que les sujets, les communautés et les institutions sont différenciés. Et c’est cette différence qui est à l’origine de toute conflictualité. Une société de « mêmes » ne connait pas de conflits d’intérêts. Une organisation « totale » ne connait pas de clivages ou de distinctions.
La conflictualité n’est pas le conflit. Si ce dernier vise la destruction de l’autre ou des idées qu’il défend, la conflictualité cherche la confrontation féconde, la controverse constructive. Nous pourrions dire qu’une conflictualité mal régulée aboutit au conflit.
Le moyen le plus abouti dont nous disposons pour réguler la conflictualité inhérente à toute forme sociale, c’est la démocratie. C’est-à-dire une régulation des intérêts individuels et collectifs en présence par des formes de délibération et de décision qui associent tous les points de vue, toutes les parties prenantes. La démocratie a à voir avec l’incomplétude en ce sens qu’elle postule que ni un individu seul (le roi ou le dictateur), ni un groupe exclusif (l’aristocratie ou les apparatchiks) ne peut garantir le bien commun.
- L’établissement ou le service social ou médico-social : une scène des désaccords
L’établissement ou le service social ou médico-social est particulièrement sensible à cette dynamique de la conflictualité. Il constitue une scène originale où se jouent des désaccords de toutes sortes :
- Désaccord sur les normes entre les travailleurs sociaux, vecteurs d’intégration sociale, et les usagers, potentiellement à la marge des normes sociales ;
- Conflits d’intérêts entre les gestionnaires, les professionnels, les usagers, les familles d’usagers…
Le travail clinique, c’est-à-dire l’art de prendre soin des personnes, crée un espace scénique qui ne ressemble pas à celui des autres institutions sociales. La manière de prendre en compte la singularité des sujets, les alliances qui se construisent entre un professionnel et un usager, la dimension interdisciplinaire dans laquelle se construisent les plans d’action, sont autant d’aspects qui utilisent des formes originales de gestion de la conflictualité. Le problème, c’est qu’ils ne sont pas reconnus ainsi car l’organisation de travail est coincée dans son illusion de complétude toute puissante et, corolairement, dans le mythe consensuel qui éradique les divergences d’intérêts.
- Reconnaître les divergences de positions : condition du pouvoir d’agir
Or, la condition du pouvoir d’agir des usagers comme des professionnels et des organisations du travail social repose sur la possibilité de reconnaître les intérêts en présence et de les réguler dans une culture de la conflictualité.
Mais c’est une révolution intellectuelle que reconnaître que c’est parce que nous ne sommes pas d’accord qu’il y a une dynamique à l’œuvre. Cette position va à l’encontre d’une pensée toute faite, mâtinée d’évidences et de lieux communs, qui consiste à croire que c’est parce que tout le monde est d’accord et va dans le même sens que l’organisation est productive. C’est ignorer tous les bruits, les stratégies, les déviances et les contournements des consignes qui, in fine, permettent au système de fonctionner. Vivre sur le mythe du consensus – une seule pensée, un seul but, une seule manière d’y parvenir – ne permet pas de percevoir tous les signaux faibles qui animent de l’intérieur la vie de l’organisation, qui l’alimentent et lui permettent d’évoluer.
La pensée unique, c’est, à terme, la momification de l’organisation qui aliène ses membres et brime ses minorités – en sciences politiques, c’est le totalitarisme. La reconnaissance des divergences de positions des parties prenantes, individuelles et collectives, c’est la lutte contre l’entropie, la régénérescence continue de l’organisation pas la souplesse de ses formes et l’évolution de ses buts et c’est surtout, la reconnaissance et le respect de toutes ses parties prenantes, même les plus faibles. Et nous savons combien, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, il est primordial de reconnaître et respecter les plus vulnérables.
- Conclusions pour les fonctions d’encadrement
Occuper une fonction d’encadrement dans une organisation qui assume son incomplétude et le vit dans une culture de la conflictualité, suppose de créer des espaces de débats, des moments de confrontation, des supports d’expression qui facilitent l’échange des opinions, des positions, des approches. Cela suppose une dynamique qui libère l’expression et fluidifie les échanges, les mobilités, les souplesses tant au plan individuel que collectif pour résister à la tendance naturelle de toute organisation à se fossiliser, à se rigidifier, à se scléroser. Cela suppose de créer les conditions sécurisantes pour que chaque partie-prenante se sente autorisée à parler et que la parole ne soit pas dangereuse. Cette sécurisation des postures professionnelles ne se décrète pas, elle s’établit progressivement par la construction patiente d’une confiance partagée.
La culture de la conflictualité refuse la simplification des positions ou des idées en s’efforçant toujours de comprendre chacune dans toutes leurs complexités. Elle résiste à l’instrumentalisation des acteurs en donnant droit de cité aux subjectivités. Elle assume les différences et ne vit pas son rapport à l’altérité comme une menace mais comme une opportunité pour s’enrichir. Mais cela suppose une méthodologie précise pour faire avec ces désaccords.
- La construction des désaccords
- Construire les désaccords : une exigence démocratique pour faire société
Car il ne suffit pas de se dire manquants et différents pour que ça fonctionne ! Pour ne pas se dégrader en conflit, la culture de la conflictualité suppose des méthodes.
Une vision simpliste des organisations – autosuffisantes et disciplinées – fait l’impasse sur les désaccords ou, du moins, les considère comme des forces négatives qu’il faut vaincre. Dans ces organisations, seul le consensus s’impose, de gré ou de force. Il repose alors sur la domination d’un groupe sur les autres mais aussi sur l’occultation des rapports de forces qui structurent l’organisation, rejetant les minorités. Ce triple aveuglement – des désaccords, des rapports de force et des minorités – permet de faire « comme si » on était tous d’accord. Cet aveuglement est l’ennemi de la démocratie.
Il n’est en effet pas possible de faire société, au sens démocratique du terme, en ignorant désaccords, rapports de forces et minorités. Le projet démocratique se fixe l’ambition de tenir compte de ces éléments en en faisant des atouts dynamiques de la construction collective du bien commun.
La construction des désaccords apparaît alors comme une méthode garantissant les principes de la démocratie.
- L’établissement ou le service social ou médico-social : un laboratoire de démocratie
L’établissement ou le service social ou médico-social peut être vu comme un laboratoire de démocratie. Il est intrinsèquement sensible aux clivages qui traversent la société, qui marquent les usagers (situations liées aux exclusions sociales, au handicap, à l’âge, à l’accès au droit commun, au travail, etc.) et forment la base de son contexte d’action et de ses missions. Il y a donc un enjeu particulier à intégrer le principe démocratique dans les pratiques des établissements et services sociaux et médico-sociaux, du fait de leurs missions et du fait des personnes qu’ils accompagnent.
Là plus qu’ailleurs, mettre au travail la question des désaccords est essentiel parce que ces désaccords manifestent les rapports d’intérêts qui génèrent les questions sociales (inclusion/exclusion, adaptation/inadaptation, reconnaissance/stigmatisation, intégration/rejet…), engendrent les difficultés des personnes accompagnées et modélisent les missions confiées à l’organisation. Travailler les désaccords inhérents au travail social, donc les questions éminemment politiques qu’ils portent, ramène les pratiques au cœur de la finalité de l’action. Faire des établissements et services des laboratoires du vivre ensemble ouvre une alternative aux impasses d’une société qui ne parvient pas à inclure tous ses membres.
- Se reconnaître dans nos désaccords pour agir ensemble
Au quotidien d’une pratique clinique, fonder la relation d’aide sur les désaccords en présence, est la condition d’un faire ensemble, de la construction d’un commun. La position qui consiste à se sentir capable de répondre à tous les besoins et de tout faire, à chercher le consensus en ignorant les différences, est une position de domination du fort sur le faible. Cela renvoie au syndrome du travailleur social formé pour savoir, de sa seule place, ce qui est bon pour l’autre et ce qu’il convient donc de faire.
Mettre au point une méthode pour travailler à la construction des désaccords est donc une perspective pour les fonctions d’encadrement particulièrement adaptée à un projet en référence à la démocratie.
- Conclusions pour les fonctions d’encadrement
Nous proposons ici de refonder la fonction dirigeante sur une base qui consiste à comprendre et assumer les désaccords, à les considérer comme des éléments pouvant enrichir le travail ce qui suppose de mettre au travail les dissensus qui émergent au cœur des pratiques.
Pour ce faire, voici une démarche en quatre étapes :
Première étape : Il s’agit d’un travail sur soi. En effet, quand on occupe une position hiérarchique, il est important, préalablement, de comprendre en quoi et pourquoi je ne suis pas d’accord avec la position de l’autre ou des autres (il peut s’agir de professionnels individuellement ou en équipes, d’usagers, de familles, de partenaires, etc.). Cet effort de compréhension intérieure de ses propres ressentis permet de ne pas vivre le désaccord comme une atteinte personnelle mais comme un fait constituant la relation de travail. Ce niveau d’analyse mobilise l’intelligence sous toutes ses formes – corporelle, sensitive, perceptive, sentimentale, émotionnelle, instinctive… – et permet d’assouplir sa position en comprenant mieux ce qui la fonde. Cette souplesse permet de donner de la mobilité à sa position, c’est la condition du dialogue en altérité et de la gestion de la conflictualité.
Seconde étape : Il s’agit de lever les malentendus qui résident souvent dans des difficultés de vocabulaire. Affirmer des différences de position ne prend sens que sur la base d’acceptions communes. Les désaccords doivent donc se traiter avec un langage commun, sinon, nous risquons de maintenir des quiproquos qui ne sont pas des désaccords mais des incompréhensions. Cette seconde étape, conduite avec rigueur et respect, fait tomber les erreurs d’interprétation, les fausses idées, voire les procès d’intention.
Troisième étape : Il s’agit, à proprement parler, de la « construction des désaccords »[1] qui touche le fond des désaccords. Paradoxalement, il s’agit d’identifier les désaccords sur lesquels on est d’accord pour dire qu’ils nous séparent. Ils peuvent être classés en deux catégories : les désaccords non essentiels et les désaccords irréductibles :
- Les désaccords négociables : ceux que chaque partie peut abandonner sans avoir le sentiment de céder sur un aspect essentiel de sa position, ce qui suppose de hiérarchiser les positions des plus accessoires au plus essentielles.
- Les points irréductibles : ceux qui restent au cœur du débat et n’acceptent pas de renoncement.
Quatrième étape : Il s’agit de la phase de compromis. Réduits à leur strict minimum, les désaccords subsistants font alors l’objet d’explicitations, le but étant de bien comprendre la position des uns et des autres. La volonté partagée de « faire ensemble » – préalable nécessaire à toute gestion des désaccords – suppose alors d’élaborer un compromis. Le compromis est ici aux antipodes du consensus. Ce dernier repose sur une illusion d’accord alors que le compromis met en exergue les désaccords. Dans le compromis, chacun sait ce qu’il a dû abandonner pour permettre le projet commun. Mais le compromis n’est pas toujours envisageable. Il est alors possible de chercher ensemble un « point haut » de sortie du clivage qui permettra provisoirement et conjoncturellement de dépasser les antagonismes. C’est le concept philosophique de vertu qui transcende les positions opposées en ouvrant une troisième voie, une « éminence » de perfection (Aristote, 2008).
La construction des désaccords est au cœur d’un projet de direction qui cherche à comprendre le point de vue de l’autre, de se mettre à sa place, de situer d’où il parle et quelles sont ses motivations. Elle permet de mieux discerner les choses et de rendre plus « entendable », plus acceptable, les positions adverses sans automatiquement abandonner les siennes. Finalement, se mettre d’accord sur les points de désaccord les enrichit « de telle manière que le ‘’désaccord de sortie’’ est plus riche que le ‘’désaccord d’entrée’’.[2] » Encadrer, c’est diriger un processus de construction des désaccords et c’est, sans renier ses prérogatives et ses visées, trouver le point d’appui le plus consistant de sa légitimité.
Conclusion
Le propos était de tracer les grandes lignes d’une stratégie d’encadrement des équipes des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette stratégie se fonde sur trois refus :
- Refus de la tentation inhérente à toute institution de devenir totalisante, c’est-à-dire de répondre à tous les besoins, de tout faire pour et à la place de l’usager ;
- Refus de l’illusion du consensus qui laisse croire qu’il vaut mieux être d’accord alors que le consensus n’est qu’un malentendu partagé qui laisse libre cours à la loi du plus fort.
- Refus précisément de cette loi du plus fort qui tend à ignorer les désaccords et les minorités.
Cette stratégie repose sur un trépied, parce qu’un plan passe toujours par trois points – règle de géométrie qui explique la stabilité du trépied :
- Assumer le manque pour en faire une dynamique ;
- Développer une culture de la conflictualité pour utiliser les divergences comme énergie structurante ;
- Construire les désaccords dans une pratique d’encadrement qui permet d’atteindre les deux premiers objectifs.
Il apparaît, au terme de cette réflexion, que la position de chef de service, située comme nous l’avons dit en introduction dans un contexte d’incertitude, d’instabilité et de complexité, trouve là des points d’appui consistants mais inspirés par une éthique de la fragilité :
- Reconnaître l’altérité comme la condition de la rencontre de l’autre ;
- Résister au désir du « plein » pour ouvrir des espaces à la circulation des débats ;
- Et donc, construire sa légitimité de cadre hiérarchique sur de l’ouvert, en creux, et non du plein ;
- Mettre en scène les conflictualités pour développer le pouvoir d’agir de tous les acteurs ;
- Faire des établissements et services sociaux et médico-sociaux des laboratoires du vivre ensemble sur des bases démocratiques.
[1] Cf. Pacte Civique, Rapport annuel de l’observatoire citoyen de la qualité démocratique, Annexe 8, 2013.
[2] Viveret Patrick, Pourquoi ça ne va pas plus mal ?, Fayard, 2005, p.253..
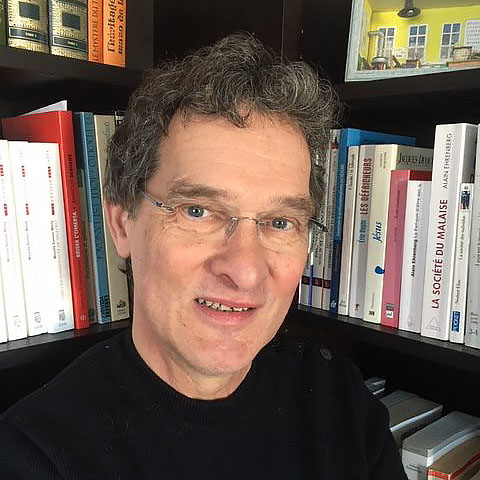
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.


