La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, crée un lien étroit et implicite entre le droit des usagers – qu’elle entend promouvoir – et la qualité des prestations qui leurs sont destinées – qu’elle entend améliorer par des évaluations internes et externes.
Ce lien, qui relèverait de l’évidence, mérite d’être interrogé car il ne va pas de soi :
- Comment la notion de qualité articule-t-elle les sphères de l’économie et du travail social ?
- A quelles conditions la qualité des prestations représente-t-elle une garantie pour les droits fondamentaux des personnes accompagnées ?
- Qu’entend-on par qualité au regard du droit des usagers ?
- Quelle pourrait être la place des usagers dans un processus d’évaluation ?
Face au risque d’une irruption violente de « l’économique au cœur du social », le droit des usagers représente une opportunité pour refonder, sur d’autres logiques, la légitimité de l’action sociale. C’est ce postulat que je souhaite défendre, sous forme de contribution à un débat loin d’être clos, en tentant de répondre à ces quatre questions.
Comment la notion de qualité articule-t-elle les sphères de l’économie et du travail social ?
Si « qualité des prestations » signifie « marchandisation du travail social », nous pouvons formuler l’hypothèse que la qualité serait alors potentiellement toxique pour les usagers. Elle impliquerait l’abdication des professionnels devant la tyrannie de l’usager-client[1], ce dernier devenant le seul évaluateur légitime de la valeur de la prise en charge ou de l’accompagnement dont il bénéficie. Cette dénaturation de l’intervention provient, semble-t-il, d’une part d’une simplification diabolisante de ce qu’est l’économie et d’autre part d’une diabolisation simplificatrice de ce qu’est le travail social.
L’économie a joué longtemps un rôle secondaire dans l’organisation de sociétés où l’ordre symbolique, la tradition ou l’au-delà étaient jugés plus essentiels. Les Grecs définirent cet espace intermédiaire entre la politique – tâche noble dévolue aux hommes-citoyens – et le travail – besogne déshonorante dévolue aux esclaves – où les femmes « s’occupent de l’intendance pendant que leurs époux débattent sur l’agora.[2] » Il aura fallu le passage par le siècle des lumières pour affirmer l’indépendance de l’individu et l’autonomie de la raison, affranchir le jeu politique de tout principe transcendant ou supérieur au débat démocratique et enfin pour consacrer la logique du progrès technique comme facteur de réussite personnelle et collective. Cette triple révolution fondatrice dont parle Patrick Viveret[3] ouvre la voie à l’hégémonie de l’économie, érigée au rang de science mais présentée comme seule lecture valable des échanges. La logique devient économique (« Il n’y a pas d’autre choix ») faisant disparaître par un tour de passe-passe les choix politiques qui sous-tendent toujours les orientations prises. Devant cet « économisme », des voix se lèvent, celles des altermondialistes, par exemple, qui tentent de développer d’autres réponses, mais aussi des voix de scientifiques qui s’opposent au modèle unique d’un libéralisme économique exacerbé : « La seule finalité légitime de l’économie est la qualité de vie des hommes et des femmes, à commencer par celle des plus démunis.[4] » Nous ne pouvons pas réduire l’économie au visage difforme que nous en donne le néolibéralisme. L’économie c’est l’approche complexe des échanges qui ne peuvent se réduire à de simples indicateurs de flux financiers ou au seul étalon de la monnaie. D’autres paramètres doivent être pris en compte : environnementaux, qualitatifs (tant individuels que collectifs et planétaires), de bien être, de développement, de contribution démocratique, etc.
Le travail social, quant à lui, est passé d’une fonction réparatrice au rôle de « corriger les effets [5]» de l’exclusion. En cela il suivait le mouvement de la société. Durant les années de croissance qui ont suivi la seconde guerre mondiale, chacun pensait que le progrès finirait par garantir le bonheur de tous. Le travail social venait alors compenser l’impossibilité d’une croissance équivalente pour tous les citoyens, sont but était de permettre à chacun de rattraper le train du développement. A l’issue des crises économiques de la fin du XXème siècle, l’illusion de la croissance partagée s’est envolée. Le travail social s’inscrit désormais dans une fonction plus durable, et plus difficile, de contenir les effets sociaux des inégalités et du refus d’un partage équitable des richesses produites. Son but est de traiter les exclus, ceux qui ont définitivement raté le train … Cette révolution copernicienne des orientations de l’intervention sociale n’est pas sans effets sur la représentation qui s’en construit, risquant de la diaboliser. L’existence même d’un dispositif d’action sociale signe l’échec des principes républicains fondateurs (liberté, égalité, fraternité). Le coût d’un tel dispositif limite l’emballement des profits et interpelle l’Etat dans des fonctions régaliennes dont certains acteurs économiques aimeraient le libérer.
Pour promouvoir la qualité des prestations, nous ne pouvons pas nous contenter d’une simplification outrancière de la logique économique, pas plus d’un enfermement réducteur de la mission de l’action sociale. Dans la perspective intégrative du travail social, la notion de qualité se complexifie et réarticule logique économique et logique sociale en permettant à la seconde d’interpeller la première sur ses valeurs et son sens.
C’est au prix de ce débat entre logique économique et logique sociale que la notion de qualité des prestations sera une garantie pour les droits fondamentaux des personnes accompagnées.
A quelles conditions la qualité des prestations représente-t-elle une garantie pour les droits fondamentaux des personnes accompagnées ?
Il y a une façon de garantir une certaine qualité des prestations qui enferme le « bénéficiaire » dans un rapport de soumission, de conformité. Pour illustrer cet aspect du débat, prenons exemple dans la sphère marchande. La qualité des produits de grande consommation n’a pas de lien direct avec la qualité du comportement des consommateurs. Au contraire, la grande qualité des produits, qui vise in fine à accroître l’acte d’achat, induit des comportements stéréotypés de la part des clients. Nous ne pouvons pas tirer de cet exemple la conclusion simpliste que l’accroissement de la qualité des prestations d’action sociale aurait pour effet de développer des attitudes consuméristes des usagers. Ce serait faire injure à l’intelligence et au professionnalisme des acteurs qui mettent en œuvre ces prestations. Par contre, une réflexion trop standardisée sur des critères qualitatifs peut avoir pour effet de promouvoir des attitudes stéréotypées des usagers. Car les critères qui vont être valorisés sont dans le registre de la délivrance d’un produit fini, bien élaboré et achevé. La condition de la qualité est contenue dans la possibilité de maîtriser le processus, donc d’en réduire les aléas. Et cette légitime réduction du risque peut se dévoyer en une volonté de maîtriser les comportements de l’usager. Cette conception de la qualité, directement héritée de l’économie « dure », suppose préalablement que l’usager ait été catégorisé dans des comportements, « typologisé » dans des représentations préétablies (de la même façon que sont construites des catégories de consommateurs).
En opposition à ce « copier / coller » du modèle marchand, nous pouvons postuler que la qualité repose plutôt, dans l’action sociale, sur une « approche processus [6]» qui s’attache au parcours de l’usager. Le « produit » ne peut alors être pensé en dehors de la relation avec le destinataire. La prestation s’inscrit dans un mouvement interactif qui constitue l’essence même de sa qualité. Est-il alors opportun de parler de la qualité de la prestation ? Non si cela revient à la traiter comme un objet distinct de la dynamique relationnelle. Dans cette perspective, la qualité réside dans la capacité de l’intervenant à personnaliser le lien ce qui se situe aux antipodes d’une catégorisation anticipatrice des comportements de l’usager. Ce dernier est saisi dans ce qu’il a d’imprévisible, de singulier et la qualité revient à savoir prendre en compte ces données dans un projet d’action. Le point d’attention se déplace de l’acte à l’action, de la prestation à la relation.
Ce qui fait qualité dans cette seconde perspective, c’est la reconnaissance de l’autre dans ses besoins spécifiques, sa situation particulière, ses demandes plus ou moins formulées, ses attentes. C’est la capacité de l’intervenant à reconnaître l’usager dans sa dignité.
Qu’entend-on par qualité au regard du droit des usagers ?
C’est au prix de ce déplacement de la chose (l’acte même de la prestation) vers le sens (ce que la prestation signifie dans la relation) que la notion de qualité garantira les droits fondamentaux des personnes. Mais cela ne suffit pas. Il faut faire un détour par la question du rapport normatif qu’induit inévitablement le concept de qualité.
Cette question est d’autant plus d’actualité que la loi introduit les notions de « procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles ». Comment les professionnels vont-ils composer avec ces nouveaux cadres qui risquent de normer à outrance les façons de faire ? L’action sociale n’est-elle pas en train de s’enfermer dans une standardisation des pratiques à partir d’une définition trop étroite des comportements professionnels attendus ?
Ces questions esquissent un risque sécuritaire qui délimite les choses par le régime de l’autorisation : seules les « bonnes » pratiques professionnelles seront acceptées. Cela nous replonge dans une conception de la qualité visant à standardiser les prestations et, par-là même, les comportements des usagers. La rationalisation des actes techniques entraînerait celle des conduites. Pour pousser plus loin : la normalisation de l’intervention sociale entraînerait la normalisation des comportements sociaux.
Ce n’est pas de cette qualité là qu’ont besoin les usagers pour être affermis dans leurs droits ! Il est donc nécessaire que les équipes professionnelles définissent des critères qualitatifs qui, au-delà des moules du prêt-à-penser et du prêt-à-agir, signifient en actes leurs références, leurs valeurs, leur déontologie afin que leurs pratiques soient « bonnes » ou, plus modestement, les moins mauvaises possible.
Dans une visée émancipatrice au service de la promotion citoyenne des usagers, il n’est pas sûr qu’il y ait, dans l’absolu, de « bonnes pratiques professionnelles ». Par contre, il est certain qu’il y a des pratiques interdites. Définir la qualité par des pratiques interdites (celles qui sont attentatoires aux libertés fondamentales, aux droits de l’homme, aux droits des usagers énoncés par la loi) c’est laisser ouvert le jeu démocratique dans lequel le sens commun est toujours à inventer collectivement. C’est refuser de fermer l’avenir par des réponses définitives.
Quelle pourrait être la place des usagers dans un processus d’évaluation ?
Les perspectives ouvertes dans ces lignes modifient l’approche spontanée de surface, voire épidermique, que pourraient avoir les travailleurs sociaux. Le chemin proposé passe par la volonté de réarticuler économie et travail social, par l’instauration d’une conception plus interactive de la prestation et le refus d’une normalisation moralisante des références professionnelles. Mais le terme de cet itinéraire nous amène à envisager les postures respectives des professionnels et des usagers dans ce processus.
La question de la qualité ne peut être confisquée par les professionnels. Elle concerne, au premier chef, les usagers eux-mêmes. Il est donc indispensable que ces derniers disposent d’un droit d’expression sur ce sujet. Cependant, nous l’avons déjà dit, l’usager ne peut être seul évaluateur en matière de qualité. Ce serait pousser le curseur trop loin dans l’essai de corriger les dérives du passé. Bref, faire de la qualité et de son évaluation l’apanage exclusif d’un groupe d’acteurs reviendrait à annihiler la notion d’interaction que nous avons définie comme l’essence même de la prestation. Clarifier les postures ouvre une perspective de travail vers la notion d’usager participant.
Participant à l’action, à son élaboration, à sa mise en œuvre et à son évaluation, l’usager apporte sa contribution et en retire un bénéfice. Il limite ainsi les effets nocifs d’une position d’assistance qui menace toujours de le laisser en situation de dette. La notion de contre-don est à rechercher du côté de la figure de l’usager co-producteur qui invente une forme inédite de côte à côte avec l’intervenant.
Donc, dans l’action sociale et médico-sociale, aucune qualité n’est possible sans interaction (co-production) et aucune évaluation ne peut se faire sans l’usager lui-même. Cela revient à réhabiliter la position citoyenne de l’usager. Parce qu’il est citoyen, il ne peut se désintéresser de la qualité du fonctionnement du service public dont il est le bénéficiaire, et donc de sa production.
Conclusion
Dans le champ de la production de services, la qualité ne peut être conçue selon le modèle de la production de biens. Dans le domaine encore plus spécifique de la production de services sociaux ou médico-sociaux, la qualité devrait être plutôt conçue comme co-production, signifiant en cela que rien ne se réalise valablement sans le bénéficiaire. C’est « La participation directe [de l’usager] (…) à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui [le] concerne. » prévue par l’article L. 311-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Nous venons de démontrer que la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale peut ne pas nous enfermer dans une approche trop marchande de l’intervention. Cette ouverture repose sur la capacité des professionnels à produire de l’analyse, à élaborer leurs pratiques et, surtout, à redéfinir leur place et celle des usagers. Ce projet pragmatique repose sur la volonté stratégique d’éviter les positions défensives au bénéfice d’une attitude offensive visant à occuper le terrain et à y affirmer une culture professionnelle décomplexée face à la dictature des « économismes ».
Roland JANVIER[7], Février 2004
[1] Il conviendrait plutôt de dire monarchie en lieu et place de tyrannie car, chacun le sait, « le client est roi ».
[2] Patrick Viveret « Reconsidérer la richesse » Rapport au secrétaire d’Etat à l’économie solidaire – Documentation française – 2002. « oikos, nomos, « la loi de la maison ».
[3] Op. cit.
[4] Jacques Généreux « Manifeste pour l’économie humaine » – Esprit – Juillet/août 2001.
[5] Cette expression est contenue dans l’article 2 de la loi 2002_2.
[6] F. Charleux et D. Gaquère « Evaluation et qualité en action sociale et médico-sociale » ESF, 2003.
[7] Directeur général de la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille et Vilaine – Co-auteur avec Yves MATHO de « Mettre en œuvre le droit des usagers dans les établissements d’action sociale » – Dunod, 2002.
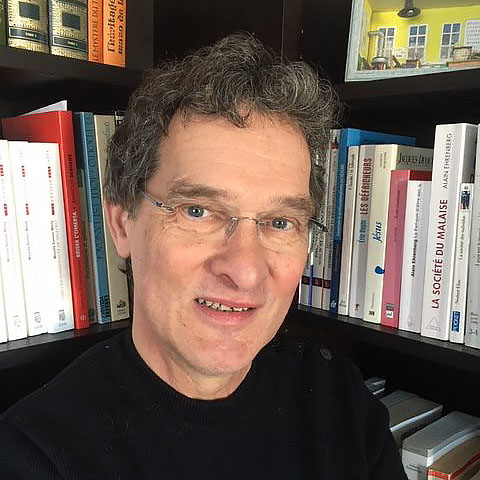
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.


