- L’autorité n’est pas un pouvoir de contraindre
- Les faux semblants du discours managérial
La pensée dominante en matière de management se réfère plutôt au paradigme simplificateur de la rationalisation. Le discours managérial, sous un vernis prônant la mobilisation de chacun dans l’intérêt de tous, ne parvient pas à masquer une logique mécanique de causalité élémentaire : il suffirait de savoir ce que l’on vise pour créer les conditions d’un management efficace et performant. Cette conception représente une approche positiviste qui fait l’impasse sur la complexité des relations qui existent entre causes et effets.
Le management est marqué par les conditions d’émergence de cette, soi-disant, science et par le milieu dans lequel elle s’est développée. Au plan des sources théoriques, nous retrouvons pêle-mêle les stratégies de l’art de la guerre, du gouvernement des hommes, un peu de sciences humaines, l’influence de la psychopédagogie et de la psychologie sociale. Les différentes approches qui vont de Taylor à Mayol ont ceci de commun : elles se sont déployées dans un milieu marqué par le libéralisme économique. L’enjeu était de concilier une manière de faire avec les salariés et des exigences de production et de rentabilité. La question reste inchangée. Comment faire avec les hommes pour qu’ils donnent le maximum de leurs capacités productives ? Ce qui s’est modifié, c’est la conception de l’homme qui sous-tend les réponses à cette question. La lutte des classes avait contraint le patronat à ne plus voir les ouvriers selon leur seule force de travail mais comme des acteurs sociaux avec lesquels il fallait compter. La radicalisation des théories de l’économie libérale en néo-libéralisme a brisé les équilibres sociaux qui s’étaient négociés dans l’ère post-industrielle. Le néolibéralisme est à interpréter comme une pensée simplificatrice qui a eu un effet extrêmement réducteur sur les acquis des conceptions humanistes. C’est en ce sens que l’on peut parler de retour du positivisme.
Le paradigme de la pensée simplifiante tente de minorer le facteur humain et toute la complexité qui l’habite. Il se diffuse dans les écoles de commerces où les principes de Milton Friedman ou de Friedrich Hayek font encore référence. Il sourd dans les théories les plus modernes du management. L’homme est une charge. Il convient donc de trouver les stratagèmes pour qu’elle pèse le moins possible sur la logique de profit. Il faut « dégraisser » les entreprises. Ce discours managérial ne trouve plus tout à fait à se dire avec cette rudesse, propre aux années 80 qui ont connu les règnes de Bush et Thatcher. La théorie, au fond, n’en reste pas moins la même.
Simplement, le propos s’est enveloppé d’une rhétorique plus acceptable. Mais le facteur humain est toujours un problème qu’il faut savoir contourner pour en tirer le meilleur profit. Autrement dit, la complexité humaine n’est pas perçue comme un atout pour penser l’entreprise, ce qui oblige à imaginer des moyens de contrainte pour l’empêcher de s’exprimer. L’art de manager, c’est de savoir faire simple, là où c’est complexe, selon le principe « il n’y a pas de problème, il n’y a que des solutions ».
- L’impensé des conflits d’intérêts
Cette conception ne parvient pas à intégrer la réalité des rapports de travail marqués par des jeux de forces à la fois complémentaires et antagonistes qui subvertissent constamment l’ordre de l’institué. Les théories contemporaines du management se trouvent ainsi profondément handicapées par cet impensé des conflits d’intérêts. La pensée simplificatrice tend à cliver le réel. Il ne peut être analysé qu’en termes de bon ou mauvais, bien ou mal, conforme ou non-conforme. C’est ainsi que l’intérêt des acteurs est trop souvent repéré comme opposé à celui de l’entreprise. Cette vision binaire ne permet pas d’envisager autrement les rapports de forces au sein de l’entreprise. Cette conception enferme tout salarié comme étant naturellement paresseux, mu que par son intérêt égoïste qu’il va monnayer selon une stratégie du moindre effort et de l’évitement de toute responsabilité.
C’est ainsi que se développent des manières de faire inadéquates pour mobiliser l’énergie humaine : Un système de rémunération et de primes qui limite la reconnaissance à un échange monétaire alors que toutes les enquêtes sérieuses montrent que les salariés attendent d’autres formes de gratification. Une généralisation des principes de compétition entre les agents, soit disant pour stimuler leur créativité, alors que chacun sait que la coopération est beaucoup plus productive. Une hiérarchie contraignante et omniprésente qui vise à empêcher les déviances et induit des rapports de méfiance, de soupçon et, en réaction, des tactiques d’échappatoires des subordonnés. Une mise en procédure excessive des modes opératoires à laquelle on prête la vertu de garantir l’excellence des conduites alors qu’elle produit la stérilisation des pratiques. En fait, toutes ces pratiques, dont la liste exhaustive serait longue, visent à limiter ou contourner l’expression des conflits d’intérêts puisqu’ils sont perçus comme des freins à la production.
La difficulté, c’est qu’ignorer le réel n’empêche pas qu’il produise ses effets. Chercher à empêcher l’expression des intérêts des personnes et des groupes n’a pas, pour résultat, d’éteindre les conflits qu’ils génèrent. Mettre le couvercle sur la marmite de lait n’empêche pas le liquide bouillant de déborder.
L’accusation que l’on peut porter à des formes de management qui s’enferment dans la volonté de maîtrise des comportements en tentant de simplifier les phénomènes à l’œuvre dans l’entreprise, c’est que non seulement ils sont stressants, voire maltraitants, pour les salariés, mais qu’en plus ils privent l’organisation d’une énergie qui pourrait être utilisée autrement.
- De la soumission au pouvoir d’agir
Dévoiler ces flux énergétiques qui traversent sans cesse les organisations pour les reconfigurer semble être une entrée pertinente pour envisager une autre perspective managériale : passer de la soumission des agents au pouvoir d’agir des acteurs. L’objectif est ambitieux. C’est une révolution copernicienne qu’il faut alors réaliser dans les théories managériales.
Selon cette visée à contre-courant, le jeu de forces – manifestant les rapports d’intérêts en présence – n’est plus perçu comme une gêne mais comme une énergie disponible pour la bonne marche du système. Cela décale complétement les points de vue. Par exemple, la résistance au changement est habituellement analysée comme un empêchement à la conduite des projets. Selon la perspective inversée qui est proposée, la résistance au changement devient une force qui permet la bonne conduite du projet. Elle n’empêche pas, elle enrichit. Elle apporte un éclairage qui va permettre d’affiner le projet, d’en préciser plus finement la nature, de mieux définir les objectifs, d’aller plus loin dans sa justification et de vérifier sa réelle pertinence. La résistance au changement n’est plus un contre-feu à vaincre ou à contourner mais une position avec laquelle il faut compter et qui permet d’enrichir le projet, de lui donner plus de consistance, quitte à en réviser la trajectoire et les modalités.
Cela suppose d’intégrer aux pratiques managériales une autre dimension : la conflictualité. Alors que la contrainte et la volonté de maîtrise génèrent le conflit, l’art de prendre en compte les différents points de vue et d’intégrer toutes les forces en présence génère la conflictualité. Dans le premier cas, il faut vaincre, dans le second il faut combiner, composer. Le conflit induit la soumission : le management est réussi quand il est parvenu à dépasser les divergences d’intérêts, à interdire leur expression, au profit de l’intérêt supérieur de l’entreprise (érigée ici en entité personnalisée ce qui laisse croire que l’intérêt de l’entreprise ne serait l’intérêt de personne en propre…), qui ruine tous les autres intérêts en présence. La conflictualité induit le compromis : dans ce cas de figure le management remplit une fonction métabolique qui absorbe et transforme les intérêts particuliers pour générer un intérêt commun qui ne résulte pas de la soumission des uns au pouvoir des autres mais comme résultant d’une délibération au cours de laquelle chacun a accepté de faire des concessions pour permettre la réalisation d’un but commun à partir d’un compromis. La conflictualité est la condition de ce type de management. Elle permet aux positions de se frotter les unes aux autres, elle dévoile les intérêts en présence et les met au travail, le tout dans un climat de respect et non de volonté de vaincre l’autre.
Alors que le management classique vise à soumettre les exécutants aux desseins des dirigeants, un management fondé sur la conflictualité des rapports de forces a pour effet de promouvoir les agents dans un rôle d’acteurs. Ce qui est attendu de chacun dans ce système, c’est sa contribution, son point de vue, ses attentes, sa compétence, son énergie, son engagement. Tous ces éléments ne sont pas jaugés à l’aune d’un clivage moralisant entre ce qui est jugé positif et ce qui serait négatif. Tous ces apports sont considérés comme des ressources qui seront transformées, avec celui qui les apporte, dans un projet commun. C’est bien le pouvoir d’agir de l’acteur qui est convoqué. Plus ce pouvoir d’action sur l’organisation est important, plus il participe à l’élaboration du projet partagé.
- Le management n’est pas une manipulation
- Manager, c’est prendre soin
L’inversion paradigmatique proposée ici en appelle à la liberté des acteurs. Elle repose sur la conception selon laquelle l’homme est naturellement ouvert aux autres et aux coopérations. Il a besoin d’une motivation qui dépasse ses intérêts personnels pour avoir le sentiment de contribuer à une œuvre collective.
Pour atteindre cet objectif, il convient de refonder une conception du management – inspirée par l’idée de ménager – selon le principe que diriger, c’est d’abord prendre soin des personnes. Cela suppose, non pas de définir des protocoles fermés de pratiques, mais d’aménager des espaces de créativité, au cœur même de l’organisation de travail. Prendre soin, c’est s’assurer que l’acteur va être dans les meilleures conditions possibles pour mener à bien sa mission. Le bien être est la condition de la créativité professionnelle. Cela suppose de prendre en compte l’ensemble des facteurs personnels et interpersonnels. Bien entendu, en premier lieu, cela concerne les conditions de travail (aménagement du lieu, ergonomie, prévention des risques…) en élargissant cet aspect aux dimensions relationnelles (ambiance du groupe, qualité des échanges, supports de communication, espaces et instances de travail collectif…). Il convient également de penser l’organisation du travail afin qu’elle soit la mieux adaptée aux salariés en termes de charges (tant en volume qu’en stress), de rythmes (horaires et cadences), de facilités (souplesse et adaptabilité de l’organisation). Mais la bientraitance des salariés ne se limite pas au strict cadre de l’entreprise. Prendre soin suppose également de travailler sur les articulations, complémentarités, congruences et cohérences à établir entre la vie privée du salarié et sa situation professionnelle. Il ne s’agit pas ici de s’immiscer dans l’intimité des personnels. Ce dont il est question c’est d’intégrer les paramètres privés de chacun afin de penser l’adéquation à construire entre sphère privée et sphère professionnelle. Ces deux espaces doivent être délimités pour que l’un n’envahisse pas l’autre. Mais il faut aussi avoir conscience qu’ils ne sont pas strictement séparés. Il existe une porosité entre eux qui amène à toujours les considérer ensemble, comme deux espaces interagissant dans la vie du salarié. Prendre soin, enfin, c’est accompagner le parcours professionnel des personnes tout au long de leur vie. Cette dimension intègre les enjeux de qualification, de formation au cours de la carrière, de perspectives de mobilité, d’adaptation aux évolutions ainsi que la prise en compte des projets et envies personnelles, voire des attentes de progression dans la hiérarchie.
L’objectif n’est pas de soumettre l’organisation à la dictature du salarié qui imposerait ses vues au projet entrepreneurial mais de placer l’intérêt de chacun, et donc le bien être, comme la première condition concourant à l’intérêt global de l’entreprise.
- Œuvrer avec l’aléa
La conception du management-ménagement exposée dans ces lignes, rejetant les relents positivistes, s’oppose à une conception rationalisante de la vie. Intégrer la conflictualité des intérêts, promouvoir la bientraitance des salariés comme levier favorisant leur propre pouvoir d’agir suppose de se départir d’une vision idéalisée de l’organisation de travail. La projection d’un modèle idéal de ce que devrait être la « bonne » entreprise est un leurre et un danger. Elle menace à la fois d’engendrer des pratiques autoritaristes puisqu’il n’y a plus rien à négocier sur le but à atteindre et le moyen d’y parvenir et, dans le même temps, elle expose les acteurs à une grande déception. L’idéal n’étant jamais atteint, la désillusion guette et menace de renforcer des logiques répressives.
Plutôt que de s’épuiser à avancer coûte que coûte vers une perfection irréaliste, il convient d’imaginer des manières de faire avec l’imparfait. L’imperfection est un caractère central de la nature humaine. L’humanité de l’homme tient sans doute plus à ses défauts qu’à ses qualités. C’est au prix de ses dérives que la civilisation humaine est parvenue à progresser, tentant sans cesse de s’arracher à l’atavisme de la barbarie sans jamais y parvenir complètement. Toutes les sociétés qui ont tenté de s’ériger selon une configuration idéale ont rapidement atteint les limites de leur fantasme en générant des effets contre-productifs qui les ont ruinées. Or, diriger des hommes, c’est d’abord assumer le fait que rien n’est jamais achevé, qu’il y a toujours un écart entre ce qui est visé et ce qui est réalisé, que des écarts caractérisent les conduites et les pratiques, des failles des manquements, des erreurs, des défauts se glissent au cœur de toute activité humaine. Diriger c’est l’art de combiner des imperfections pour avancer ensemble, pour faire avec ce qui est plutôt que de faire en fonction d’un idéal qui n’est pas.
Finalement, diriger suppose d’accepter que tout ne peut pas être prévu d’avance. Certes, la qualité du projet permet de limiter les aléas, mais jamais de les supprimer. Sinon, le projet se dégrade en programme, c’est-à-dire en gestes mécaniques à reproduire selon un modèle préconçu indiscutable et infalsifiable. Mais alors, il ne s’agit plus de manager des hommes mais de simples robots. Manager, c’est donc travailler avec l’imprévu. Non pas comme un handicap à l’action mais comme un élément constitutif du travail. Cela suppose d’inventer les moyens de faire avec l’incertitude afin que la souplesse adaptative ne se transforme pas en faiblesse mortifère. Là encore, il faut convoquer l’intelligence des acteurs. C’est parce que chacun disposera d’un espace de liberté qu’il pourra réagir à l’aléa, s’y adapter, voire le transformer en opportunité.
- La question des marges de manœuvre
C’est donc la question des marges d’autonomie laissées à chaque acteur qu’il faut envisager. Un système contraint, rationnalisé à l’extrême, se trouve enfermé dans des rigidités que l’imprévu menace. Là où il faudrait ployer tel le roseau, l’organisation rigide est menacée de se rompre devant les aléas qu’elle rencontre inévitablement. Le professionnel, contraint par des procédures fermées, ne dispose pas des souplesses nécessaires à son adaptation aux anicroches du quotidien. Quand le réel ne correspond pas à l’idéal projeté il n’a comme seule alternative que de tenter de le faire entrer dans les cases qui lui étaient prescrites ou d’appliquer des réponses inadaptées. Dans les deux cas, il est en faute. Les écarts entre les projections de la réalité et la configuration concrète des choses ou encore entre les modèles théoriques d’action et la réalité des pratiques rappellent que « la carte n’est pas le territoire » et que la raison n’a rien de rationnel.
La capacité d’une organisation de travail à s’adapter à la topographie de son terrain d’action est une condition essentielle de sa fiabilité. Cette adaptabilité est antinomique avec un dispositif rigide et fermé. La flexibilité de l’organisation et son ouverture reposent sur la malléabilité des espaces de travail – il s’agit des fiches de fonction, de l’organigramme hiérarchique, des liens fonctionnels – et donc de l’autonomie de ceux qui les occupent – il s’agit des interdépendances organisées entre les acteurs qui délimitent des zones d’action sécurisées et qui sont fondées sur la délégation, l’autorisation et le rendu compte.
La marge de manœuvre est une réalité proportionnelle au niveau hiérarchique. C’est-à-dire que plus on descend dans la hiérarchie, plus elle tend à se réduire. C’est pour cela que, dans la chaîne des liens de subordination, le sommet managérial doit garantir des marges importantes à ses assistants. C’est la condition pour qu’en bout de chaîne subsiste encore un peu de latitude pour les acteurs de terrain.
L’autonomie n’est pas un blanc-seing laissant libre cours à l’initiative individuelle. Elle n’est pas synonyme d’indépendance. Dans un système managérial conçu comme la mise en rapport des intérêts de chacun, l’autonomie est plutôt un mode de gestion des interdépendances. Là où un dispositif autoritaire et centralisé est menacé par les stratégies d’évitement des acteurs, les constructions de féodalités ou les velléités individualistes, un système interactif privilégie au contraire les principes de décentralisation et de subsidiarité. L’autonomie de chaque espace d’action est articulée aux autres du fait, notamment, de la qualité et de la quantité des interactions que produit le système. Un système autocentré génère l’isolement des acteurs dans des stratégies d’individualisation alors qu’un système réticulaire génère la coopération et la collégialité entre des acteurs individués[1].
- La décision n’appelle pas l’obéissance
- L’art de la délibération
Une caractéristique centrale d’une organisation de travail décentralisée au profit de l’autonomie des acteurs réside dans la cohérence de l’ensemble du système. Le terme système est utilisé à dessein. Chacun des éléments de l’organisation interagit fortement avec tous les autres. L’organisation fait système. Et c’est cette dimension systémique qui garantit la cohérence d’ensemble puisque chaque élément est, d’une manière ou d’une autre, sous contrôle des autres et les contrôle en même temps. Il ne s’agit pas ici du seul contrôle hiérarchique mais de tous les effets d’actions/rétroactions qui caractérisent les échanges entre des entités ouvertes. La cohérence dont il s’agit est à entendre comme un véritable continuum de l’action, à tous les niveaux de l’organisation, dans toutes ses dimensions et tous ses espaces. Cela revient à dire que la fin est assujettie aux moyens et que réciproquement les moyens sont tout entiers déterminés par la finalité visée.
Cette exigence d’un continuum des logiques d’action préserve la fonction de direction de la dérive manipulatoire. Diriger, c’est s’adresser à des acteurs responsables de leur action. Cela suppose de créer les conditions d’un véritable débat démocratique au sein des instances professionnelles. L’entreprise n’est pas, en soi, une démocratie. A l’exception notable des coopératives ouvrières de production, les dirigeants ne sont pas élus et les orientations n’appartiennent pas aux seuls salariés. Cependant, inscrite dans une société démocratique, l’entreprise ne peut s’affranchir des grands principes qui régissent le vivre ensemble au nom d’un idéal laïc et républicain. D’abord, l’entreprise est soumise aux lois de la République, elle ne peut être un espace de non-droit. La responsabilité civile et pénale des dirigeants est sans cesse engagée, c’est une garantie pour le droit des personnes qui y travaillent. Ensuite, l’entreprise est inscrite dans un jeu d’échanges socioéconomiques. Elle enrichit les territoires qui lui apportent leurs ressources. Elle s’inscrit dans un marché qui régule les intérêts et les profits. Elle contribue aux échanges culturels et symboliques qui font société. Mais l’entreprise s’inscrit également dans un processus démocratique par son fonctionnement interne.
A l’instar de la manière dont se construit la société, l’entreprise est un espace qui se structure par la délibération. C’est une façon de redire autrement le propos qui ouvrait cet article : l’entreprise est le lieu de combinaison des rapports de forces, des jeux d’intérêts de ses parties prenantes. Cela ne résulte pas de la volonté de ses dirigeants, c’est une réalité intrinsèque à toute organisation humaine. Cependant, la conception du management qui va y être développée ne prendra pas en compte de la même manière les rapports de forces qui traversent l’entreprise. Selon une visée rationalisante, le but sera d’en limiter les effets. Dans ce cas les débats sont réduits au strict minimum (conseil des actionnaires, instances représentatives du personnel). Selon une conception ouverte du management, les espaces de débat seront recherchés comme leviers de régulation du projet commun.
- Inverser le sens de la pyramide hiérarchique
C’est la logique hiérarchique elle-même qui se trouve renversée ! La hiérarchie n’a plus comme fonction première de limiter et contrôler l’activité des professionnels, elle vise, au contraire, à accroître leurs possibilités d’action. Le cadre hiérarchique n’est plus celui qui contraint et empêche mais celui qui permet et soutient. Cette conception d’un management ouvert, promouvant la responsabilité des acteurs invite à concevoir un système décentralisé d’action qui inverse le sens de l’édifice hiérarchique : il s’agit de penser des fonctions de cadres qui sont à l’étayage, de ceux qui agissent au « front office ».
Les conséquences, pour l’organisation de travail, de dessiner sur sa pointe l’organigramme sont considérables en ce que cela signifie de basculement des légitimités. Le schéma met alors au premier plan, en haut, les acteurs qui réalisent la partie la plus concrète et la plus palpable de la production de l’entreprise. Dans une société de production de biens matériels, le front office est l’atelier. Dans un commerce, c’est la relation client. Dans une entreprise de services, il s’agit des professionnels qui sont au contact des bénéficiaires. C’est là que se joue la pertinence, l’efficience, la performance et l’efficacité de l’organisation. Tout le reste – ce qu’il est convenu d’appeler la superstructure et qu’il faudrait nommer l’infrastructure – n’est que la fonction support qui permet l’excellence de ce niveau essentiel.
Cette vision a une conséquence majeure sur la production des décisions. Quels sont les espaces où se prennent les décisions les plus déterminantes pour la fonction de production. Selon la dynamique mise ici en valeur, le regard se porte immédiatement vers le front office. A condition d’être en mesure de dévoiler les signaux faibles qui organisent par en dessous, subrepticement, l’entreprise, il apparaît que c’est dans l’atelier, au contact des produits, dans le magasin, en face du client, dans la production du service, là où se noue la relation avec le bénéficiaire, que se jouent les éléments les plus importants de la production. C’est donc logiquement là que se prennent les décisions les plus essentielles. Non pas celles qui sont les plus valorisées socialement mais ces petits riens du quotidien qui font qu’une organisation de travail fonctionne.
- L’autorité en établissement ou service social ou médico-social
En quoi cette mise en perspective d’une autre conception du management, applicable à toute forme d’entreprise, présente-t-elle un intérêt particulier pour les établissements sociaux et médico-sociaux ? L’hypothèse défendue dans ces lignes est qu’un management travaillant sur la conflictualité des rapports d’intérêts est particulièrement adapté aux organisations particulières que sont les établissements sociaux et médico-sociaux.
Les établissements sociaux et médico-sociaux ont ceci de spécifique qu’il s’agit d’entreprises – des lieux organisés de production – et plus précisément d’entreprises de services – des organisations délivrant des prestations – mais, de plus, inscrites dans une mission d’intérêt général et d’utilité sociale définie par l’Etat dans le cadre d’une politique globale d’aide et d’accompagnement de personnes vulnérables. C’est-à-dire qu’au rapport basique du management entre des cadres et des salariés s’ajoute une troisième catégorie : les usagers. Il ne s’agit ni de subordonnés, ni de simples clients, ni de donneurs d’ordre mais de personnes contraintes par une situation (handicap, difficultés sociales, dépendance…) qui s’engagent dans une relation d’aide. Cette configuration détermine une singularité remarquable des entreprises d’action sociale. Et c’est cette singularité qui rend encore plus essentielles la mise en œuvre d’un management différent, tel qu’exposé plus avant.
La conflictualité des intérêts est une réalité encore plus sensible que dans l’entreprise classique car elle met en jeu, outre le rapport entre dirigeants et salariés le rapport d’intérêt avec les usagers eux-mêmes. Les enjeux sociaux de ces divergences d’intérêts sont au cœur du travail social.
Le développement du pouvoir d’agir des acteurs, s’il peut être un objectif du dirigeant d’entreprise constitue la substantifique moelle de la relation d’aide. Cela induit donc la nécessité d’établir une continuité forte entre le pouvoir d’agir de l’entreprise, celui des salariés et celui des usagers. C’est cet alignement qui va de l’ambition du projet d’établissement ou de service à l’empowerment de l’usager qui fonde l’art de manager une organisation d’action sociale.
Si manager c’est prendre soin de ceux qui travaillent, manager une organisation d’action sociale, c’est prendre soin de ceux qui prennent soin des usagers. Chacun sait que les conditions de travail dans un internat éducatif, un service de milieu ouvert ou d’intervention à domicile, une structure pour personnes handicapées ou un établissement accueillant des personnes lourdement dépendantes sont difficiles, parfois pénibles. Les professionnels y rencontrent à la fois la pression des rythmes, des tensions que vivent les usagers, parfois leur souffrance, toujours leur vulnérabilité et cela doit être pris en compte. Prendre soin de ces fantassins de premier rang est une exigence managériale.
Manager, c’est se départir d’un modèle idéal d’organisation pour faire avec l’aléa. Laisser place à l’imprévu dans la direction des établissements sociaux et médico-sociaux est une manière de laisser s’inventer la relation d’aide au cœur de la rencontre de l’autre, ce que toute forme d’autoritarisme rend impossible. Travailler avec l’imparfait inhérent à toute organisation humaine prend un relief particulier dans des institutions dont la mission est d’œuvrer auprès de personnes en difficultés. Il ne s’agit pas de viser l’idéal mais de faire avec ce que sont les personnes, avec ce qui fait problème.
Manager, c’est travailler la question de l’autonomie des acteurs. Là aussi, l’application de ce principe aux organisations d’action sociale est plus que pertinent parce que la visée du travail avec et pour autrui est justement de ne pas l’enfermer dans un dessein conçu pour lui mais sans lui pour promouvoir sa capacité de choix, sa faculté à prendre en main son destin. En ouvrant la question des marges de manœuvre laissées aux acteurs du travail social, nous renouons avec le sens même de l’autorité : une manière d’autoriser celui qui agit.
Finalement, cette conception de l’encadrement s’appuie et se situe en continuité de la volonté d’émancipation recherchée avec les usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux. L’art de la délibération, s’il est un attribut centra d’un management renouvelé ouvre la perspective du fonctionnement démocratique des établissements sociaux et médico-sociaux. Plus que bien d’autres lieux de vie sociale, ils sont des petits laboratoires du vivre ensemble parce qu’ils associent, au cœur d’une délibération démocratique, des personnes très diverses qui portent des regards très différents sur la société et sur son fonctionnement.
Cela donne un sens encore plus fort à l’idée de pyramide inversée. Le front office des établissements sociaux et médico-sociaux est réellement le lieu où se passent les choses les plus déterminantes de l’action des organisations de l’action sociale. C’est là, dans la rencontre entre professionnels et usagers, que se noue ou se dénouent les destins individuels et collectifs.
En conclusion de cette démonstration, nous pouvons affirmer que cette conception renouvelée du management semble particulièrement adéquate aux formes et au contenu du travail social. Il y a une véritable congruence entre la volonté de développer le pouvoir d’agir des personnes accompagnées et de garantir une autonomie d’action des professionnels. Cette visée refonde une conception de l’autorité qui convoque des auteurs, non des exécutants, des acteurs, non des agents. C’est de cela dont le management pourrait être le nom.
[1] Cf. R. Janvier, « Penser les institutions du seuil », in J. Lavoué, R. Janvier, M. Jézéquel, Transformer l’action sociale avec les association, Desclée De Brower, 2013.
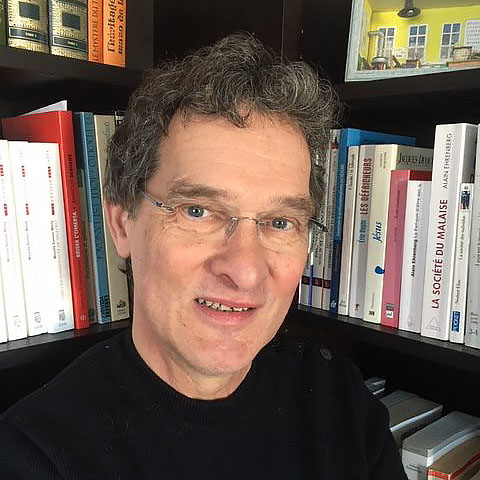
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.


