Introduction :
L’effet combiné de la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale (loi 2002-2) et de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (loi 2005-102)
« Préparer l’excellence … » Quelle ambition dans le titre de cette rencontre ! J’ai cherché dans mon Larousse la définition qui est couramment donnée de l’excellence :
« Degré éminent de qualité, de valeur de quelqu’un ou de quelque chose. »
Qualité, valeur, les grands mots sont lâchés !
Je vous propose de peindre un tableau :
Prenons ces deux mots « qualité » et « valeur » pour les placer dans un décor : celui de l’action sociale et médico-sociale.
Pour peindre une toile, il faut commencer par le fond, c’est ce qui pose le décor.
Depuis 2002, et encore plus depuis février 2005, le nouveau décor de l’action sociale, c’est la qualité des prestations délivrées par les établissements et services. Cette qualité est liée à une valeur centrale : la mise en œuvre du droit des usagers.
L’effet combiné de la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale (loi 2002-2) et de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (loi 2005-102) peut se résumer à quatre points de fuite, ces points qui, dans un dessin, permettent de tracer la perspective :
- Premier point de fuite : Les droits et libertés fondamentales. Ils doivent, absolument, être garantis à toute personne prise en charge ou accompagnée par un établissement ou un service social ou médico-social (respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité fixé par l’article L.311-3 du CASF).
- Second point de fuite : Un nouvel outillage pour garantir ces droits. Il s’agit du projet d’établissement, du livret d’accueil, du contrat de séjour (pour les ESAT[1], le contrat de soutien et d’aide par le travail), du règlement de fonctionnement et enfin des instances de participation (pour les ESAT le conseil de la vie sociale).
- Troisième point de fuite : Des pratiques fixées par la loi. La « personne accueillie » doit être respectée dans ses choix et bénéficier d’un accompagnement personnalisé fondé sur son consentement éclairé. La confidentialité protège l’usager qui dispose d’un droit d’accès aux informations le concernant. Celui-ci participe directement à la conception et à la mise en œuvre de son propre projet.
- Quatrième point de fuite : le droit commun. Tout en tenant compte de ses besoins spécifiques, tout usager doit pouvoir accéder au droit commun, directement ou par des passerelles adaptées. C’est la philosophie de la charte des droits et libertés, c’est le principe du droit à compensation, c’est le sens des réformes apportées aux ESAT : réforme des conditions de rémunération, accès à la formation et à la validation des acquis de l’expérience, etc.
Citoyenneté :
Pour que notre tableau soit beau, il faut un bon premier plan. Je vous propose de mettre devant la citoyenneté.
Reconnaissons que c’est un joli mot … mais qu’il est un peu encombrant quand il s’agit de garantir des droits effectifs à des personnes lourdement entravées dans leurs capacités de participation à la vie de la cité. Ce d’autant que ladite cité, au-delà des effets d’annonce et des affichages politiques, se montre en fait très frileuse quant à l’intégration des personnes « différentes ».
La révolution française a réussi à imposer l’idée de Nation autour de la figure du citoyen. Cette allégorie s’est construite au détriment des identités particulières : régionales, ethniques et culturelles. Le statut de citoyen s’acquiert en perdant ce qui distingue les individus les uns des autres. L’insertion « à la française » repose sur la notion d’une République une et indivisible. Nos conceptions uniformisantes de la citoyenneté ont, en ce sens, été facteurs d’exclusion. C’est au nom de ces principes, fondateurs de notre unité nationale dans un contexte d’Etat centralisé, que notre système d’action sociale a catégorisé les populations et les situations de détresse ou de dépendance. L’appel généreux et général à la citoyenneté ne suffit pas, n’a jamais suffit, à garantir les droits des plus faibles, des laissés pour compte, de ceux qui n’arrivent pas à suivre le rythme. C’est ce que rappelle, en creux, la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. Son article 1er indique qu’aucun salarié ne peut être victime de discrimination « en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. »
Cette citoyenneté pose donc problème dans notre tableau de l’action sociale et médico-sociale :
- Soit nous la dessinons comme une enluminure, simplement destinée à « faire joli », sans trop se préoccuper de ses effets concrets. Déclaration lyrique qui évite d’interroger politiquement la place effectivement laissée aux usagers pour leur participation à la construction de la société (donc à la vie et au fonctionnement des organisations du travail social).
- Soit nous en faisons un élément central de l’œuvre, mais alors il nous faut réviser toutes les manières de faire car cette citoyenneté des usagers vient bousculer les postures professionnelles – qui doivent s’appuyer sur de nouvelles manières d’être – ainsi que les légitimités institutionnelles – qui se trouvent liées à la capacité d’associer les usagers.
Compensation ou individualisation ?
Dans notre tableau, la citoyenneté ne peut pas être mise là comme si elle flottait dans les airs, elle doit s’appuyer sur quelque chose. Dans le domaine du handicap, la loi du 11 février 2005 nous propose, comme socle, le droit à compensation.
Les analyses de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées mettent en lumière l’inversion qui, à l’instar des travaux de l’Organisation Mondiale de la Santé, marque le rapport entre la personne handicapée et son environnement. Pour faire simple : avant c’était la personne qui n’était pas, du fait de son désavantage, adaptée à son environnement ; maintenant, c’est la société qui n’est pas adaptée à la personne porteuse de handicap et qui lui doit une compensation.
Paradoxalement, cette inversion de la responsabilité provoque une individualisation de la question du handicap. L’ancienne perception, naturalisée, du handicap (au-delà de ces effets négatifs qu’il n’est pas question de défendre ici) appelait la solidarité en réponse aux « incapacités » dont la personne était porteuse. La nouvelle définition du handicap qui semble s’imposer présente le risque de renvoyer la personne à rechercher, pour elle-même, des solutions dans une société qui se dédouane par le versement d’une indemnité de compensation. Véritable « prestation sac à dos » : on met ce qu’il faut d’argent dans le sac avant d’envoyer la personne dans le dédale des dispositifs d’aide et d’accompagnement. Autrement dit, l’obligation d’assurer l’offre se trouve levée par la solvabilisation de la demande. Ici s’accomplirait le rêve du Médef, formulé dans un rapport célèbre de juillet 2002[2]
Ce point d’appui de la compensation pose donc un nouveau problème à la construction de notre tableau :
- Soit nous le laissons dériver vers la position libérale de l’individualisme mais dans ce cas, le droit à compensation est un socle mou et instable qui ne supportera qu’un leurre de citoyenneté ;
- Soit nous trouvons les moyens d’en faire un droit opposable pour les personnes handicapées qui permet d’interférer dans le débat public afin de contraindre la société à garantir, encore aujourd’hui, l’article 21 de la constitution du 24 juin 1793 qui déclare : « Les secours publics sont une dette sacrée, la société doit la subsistance aux citoyens malheureux… »
Qualité :
Notre toile avance, nous devons ajouter un élément qui va donner du liant entre le fond (le droit des usagers) et le premier plan (la citoyenneté appuyée sur une conception solidaire du droit à compensation). Ce liant, c’est la qualité, terme qui s’impose dans toutes les sphères de l’activité sociale : des entreprises aux administrations sans oublier l’action sociale.
C’est, en effet, la qualité des prestations qui garantira le droit des usagers dans les organisations sociales et médico-sociales. Mais de quelle qualité parle-t-on ? Y aurait-il une définition unique et universelle de la qualité ? Une seule façon de l’envisager ?
Les directeurs d’ESAT sont particulièrement bien placés pour savoir qu’il peut y avoir des approches antagonistes de la qualité :
- La qualité de la production d’un établissement d’aide par le travail peut porter atteinte à la qualité des conditions de travail adaptées des travailleurs handicapés ;
- La qualité de l’accompagnement médico-social peut entraver la qualité financière de la structure en réduisant sa rentabilité.
Il y a donc des qualités qui s’opposent, des visions de la qualité qui sont relatives au contexte, des conceptions de la qualité qui dépendent de valeurs différentes. Et pourtant, c’est la « Qualité » – avec un grand « Q » – qui devrait garantir le respect de la personne accueillie, de ses besoins.
Frédérik MISPELBLOM écrit que « la « qualité » en général est une fiction politique, une version moderne du bonheur offert par les produits et les services qui en forment le support matériel.[3] » Une fiction[4] n’est pas une construction sans effet, c’est une représentation du monde ayant un impact puissant sur la réalité.
Marquée par les rapports sociaux, la « Qualité » signe une conception des liens sociaux, du bien-être des individus, de la consommation des produits, des rapports à la norme et de conformité des comportements. Disant cela, nous ouvrons une perspective très « politique » de la qualité qui place à nouveau le débat sur le terrain des conceptions que l’on se fait de la place des personnes, de leurs rapports entre elles, des perspectives du « vivre ensemble », bref de questions proches de la citoyenneté !
La qualité, si elle apporte une profondeur intéressante à notre tableau de l’action sociale, pose à l’artiste peintre un dilemme supplémentaire :
- Soit nous acceptons la qualité dans sa forme mystifiée : un concept consensuel, indiscutable qui introduit, insidieusement, une forme de conformité à des normes établies par des rapports de domination culturelle. A ce jeu, il y a fort à parier que les usagers de l’action sociale seront soumis à des contraintes non-voulues ;
- Soit nous tentons d’esquisser la qualité comme un enjeu social, nécessairement soumis au débat démocratique, débat dans lequel les usagers doivent prendre toute leur place.
Procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles :
Poursuivons notre œuvre picturale : la qualité à un ombre portée, posée par la loi :
«Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles.[5] »
Cet article de la loi 2002-2 fait le lien entre la qualité des prestations et des « procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ». Qu’en est-il ?
Tout d’abord, la définition des attitudes professionnelles par les « bonnes pratiques » pose question. La définition des conduites attendues par le « bien » – telle par exemple la notion de « bientraitance » – fixe définitivement, et de manière étroite, le rapport à la norme. Cette norme devient unique, univoque, fixée et sans évolution possible. Tout comportement décalé par rapport aux bonnes pratiques est jugé mauvais et renvoie son auteur dans l’enfer du « mal ». C’est le principe du pouvoir dictatorial qui définit les comportements autorisés : tout ce qui n’est pas autorisé est réputé interdit. Alors qu’en démocratie, c’est l’inverse : l’interdit étant fixé, il délimite l’espace des possibles qui laisse une marge d’autonomie et de créativité aux acteurs, tout ce qui n’est pas interdit étant, par nature autorisé.
Cette précaution étant posée, non pour nous dédouaner de la loi mais pour se préserver de certaines dérives, il nous faut répondre à l’obligation posée et définir ces fameuses procédures, références et recommandations pour les pratiques. Ce sont elles, en effet, qui vont contribuer à garantir le droit des usagers.
Nous pouvons penser que les « bonnes pratiques professionnelles » seront référées à deux grands axes :
- Premier axe : les pratiques professionnelles garantissent la personnalisation des prestations. Le « sur-mesure » est l’effet immédiat des lois de 2002 et 2005 qui réforment les deux lois du 30 juin 1975. Cela en est fini du « prêt à porter » du social – autrement dit de la logique de dispositifs – il faut développer un principe d’action orienté vers la singularité des besoins et attentes des bénéficiaires.
- Second axe : Les pratiques professionnelles qui garantissent la participation des bénéficiaires. Le meilleur moyen de garantir la personnalisation, c’est de transformer le bénéficiaire – jusque là simple « réceptacle » de l’intervention – en coauteur du projet et cela tant au plan individuel que collectif :
® Au plan individuel : l’usager participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de son projet personnalisé, sur la base de son consentement éclairé et d’une véritable démarche contractuelle ;
® Au plan collectif : les usagers sont associés à la vie et au fonctionnement de l’établissement ou du service par diverses formes de participation (de l’enquête de satisfaction au conseil de la vie sociale en passant par les groupes d’expression[6]).
Plus globalement, les bonnes pratiques sont celles qui s’inspirent et concrétisent les dispositions de la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Nous percevons ainsi que les « procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles » se réfèrent aux grands principes déjà contenus dans le cadre légal.
Cet élément supplémentaire du tableau peut donc être ajouté, selon le choix de l’auteur :
- Soit comme un facteur contraignant visant à « mettre au pas » des salariés suspectés de ne pas être conformes à un ordre préétabli des choses ;
- Soit comme un enrichissement de l’œuvre par l’ajout d’une dimension résolument éthique qui finalise les pratiques professionnelles.
Evaluation :
C’est enfin l’évaluation qui constitue le rehaut[7] final du tableau. En effet, l’article L.312-8 du CASF que nous venons de lire institue ce double dispositif d’évaluation – interne et externe – qui permet de mesurer la qualité.
Ce n’est pas le lieu de développer la question de l’évaluation, déjà abordée lors de ces journées. Notre attention se portera sur la place des usagers dans cette évaluation. Sur ce point, la loi est relativement muette. C’est donc par l’interprétation de la philosophie des textes qu’il faut chercher des repères sur ce que pourrait être la place des usagers dans les procédures d’évaluation de la qualité des prestations.
Premiers destinataires des prestations, directement associés à leur élaboration, co-acteurs de leur mise en œuvre, on ne voit pas comment les usagers pourraient être écartés de l’évaluation.
A quelles conditions une parole des usagers peut-elle contribuer à apporter une contribution efficace à un processus d’évaluation ?
Concernant l’évaluation externe, conduite par un organisme habilité indépendant de l’établissement, le cahier des charges (en préparation) rendra incontournable la consultation des usagers. Nous ne nous étendrons donc pas sur cet aspect.
Concernant l’évaluation interne, les instances de participation des usagers peuvent être utilement mobilisées pour recueillir un avis des usagers qui contribue à la démarche globale et continue d’amélioration de la qualité par l’évaluation. Cependant, ces espaces de débat sont constitués du croisement des expressions des différents acteurs (professionnels, gestionnaires, familles et usagers), pas uniquement de celle des usagers.
Ne serait-il pas souhaitable de favoriser une parole autonome et collective des usagers entre eux, vécue comme un apport indispensable à toute évaluation. Cette approche repose sur une conception de l’évaluation interne vue comme le croisement de différents regards, la confrontation de plusieurs points de vue. Cette vision multidimensionnelle de l’institution, de son fonctionnement, de ce qu’elle produit est d’autant plus riche que le multiple est élevé.
Si cette affirmation ne semble pas discutable au plan théorique, elle pose un problème stratégique et méthodologique sérieux : Comment développer une organisation autonome des usagers afin qu’ils puissent formuler une parole indépendante à propos de l’établissement ou du service ? Cela suppose des usagers jouissant déjà d’une certaine autonomie, d’aptitudes d’expression et de théorisation, de capacités à prendre du recul, etc.
N’est-ce pas là le résumé de l’ambition de toute intervention sociale, mais aussi son paradoxe : permettre à des personnes en difficulté de prendre toute leur place dans la vie sociale ? En relevant ce défi, les institutions d’action sociale refusent la résignation qui reviendrait à reléguer les « personnes accueillies » dans des lieux de sous-citoyenneté.
Les équipes disposent déjà d’un savoir-faire considérable en ce domaine qui permet de dépasser les limites, notamment celles du handicap et de l’exclusion, pour favoriser l’expression, individuelle et collective, des usagers.
C’est sur cette perspective que je vous propose d’achever ce tableau.
Roland JANVIER
[1] Etablissements et Services d’Aide par le Travail tels qu’ils ont été rebaptisés par la loi 2002-2 et confirmé par les dispositions de la loi du 11 février 2005.
[2] Marché unique, acteurs pluriels : pour de nouvelles règles du jeu : « Afin de permettre aux citoyens d’accéder à l’action sociale, ce qui nécessite l’engagement de fonds publics nationaux et/ou locaux, il faut privilégier le principe de la solvabilisation de la demande pour rendre aux citoyens la liberté de choix du prestataire. Une telle approche, outre qu’elle met sur un pied d’égalité les différents acteurs, permet aux personnes défavorisées de bénéficier de structures d’accueil et de prestations non-différenciées, tout en respectant la confidentialité sur les aides qu’elles perçoivent. »
[3] « Au-delà de la qualité, Démarches Qualité, conditions de travail et politiques du bonheur », La Découverte et Syros, alternatives économiques, Paris, 1999. p.25.
[4] « Fiction : Ce qui n’a qu’une valeur, qu’une réalité de convention. » Larousse.
[5] Art. L. 312-8. du CASF.
[6] Cette diversité des formes de participation des usagers, leur complémentarité et leur souplesse ont été renforcées par le décret du 2 novembre 2005 (JO du 4/11/2005) portant modifications de certaines dispositions du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles.
[7] « Rehaut : (de rehausser) Touche claire ou brillante destinée, dans une peinture ou un dessin, à faire ressortir certaines parties » »Larousse.
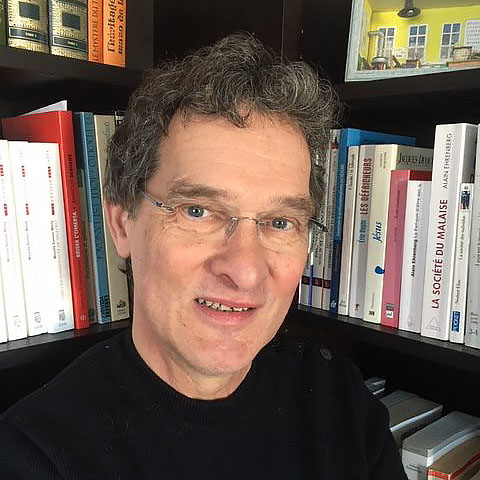
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.


