Introduction
Qu’a modifié la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale quant à la posture des usagers ? Les professionnels ont accueilli diversement cette révolution qui consistait, disait-on à l’époque, à « mettre l’usager au centre du dispositif ». Certains dénonçaient cette évolution, y voyant l’atteinte aux droits des professionnels et la réduction de leurs marges d’initiative. D’autres tentaient d’interpeler sur ce que représente la convocation de l’usager sur des responsabilités que, précisément, sa situation lui empêche d’assumer pleinement. Enfin, les derniers se sont engouffrés dans la promotion de droits égocentrés sans mesurer toutes les conséquences de cet engouement. Une transformation fondamentale s’est cependant insinuée autour de la question de la citoyenneté des usagers…
Entre les effets d’annonce d’une loi ambitieuse tendant à consacrer une vision consumériste de l’intervention sociale et les résistances d’un champ d’activités qui s’est professionnalisé en repoussant les usagers à la périphérie des lieux de décisions, je vous propose deux pistes dans cet exposé :
· Quelle analyse pouvons-nous faire des débats de société qui traversent les enjeux de l’action sociale et médico-sociale à partir de la place des usagers ?
· Quelles perspectives d’action pouvons-nous ouvrir aujourd’hui, après 10 ans de (trop) lentes évolutions des pratiques ?
Une conception de l’homme
Hobbes ou Rousseau ?
Devoirs ou droits ? Il est habituel d’entendre que, si l’homme dispose de droits, il doit aussi, en exacte symétrie, être soumis à des devoirs : les devoirs compensent les droits !
Cette insistance sur les « devoirs de l’Homme » relève d’une conception ontologique : « A l’état de nature, l’homme est un loup pour l’homme. » Donc, pour limiter cette puissance destructrice mue par le seul intérêt personnel, l’homme doit être limité, contenu, contrôlé : « Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tient en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, la guerre de chacun contre chacun. » (Thomas Hobbes, Le Léviathan).
C’est pour cela qu’il faut limiter l’affirmation des droits : s’il n’a que des droits, l’homme va en abuser, les utiliser comme une arme pour son instinct naturel de domination et de prédation.
Selon une toute autre orientation, Jean-Jacques Rousseau développe l’idée que « L’homme est naturellement bon ». Autrement dit, ce n’est pas l’état de nature de l’homme qui lui confère des visées guerrières mais les conditions sociales de son existence. Selon cette perspective, le contrat social qui fonde le « pouvoir commun » dont parle Hobbes, porte une toute autre finalité. Il n’a pas pour vocation de limiter la faculté de nuisance de chacun mais de permettre l’association de tous dans un but commun. La force de l’État rousseauiste ne repose pas d’abord sur sa capacité disciplinaire – le bio-pouvoir décrit par Michel Foucault – mais sur son aptitude à associer les citoyens à la délibération collective, à développer la participation de tous.
L’affirmation des droits ne met plus en danger l’équilibre social, elle en devient la condition. Ces droits étant de portée universelle – donc attachés de manière identique et absolue à tout être humain – ils contribuent à la juste régulation des rapports sociaux.
Hobbes ou Rousseau ? Quelles conceptions ontologiques traversent les débats sur le droit des usagers ?
L’usager versant « devoirs »
Abordé selon le versant de ses devoirs, l’usager issu de la loi 2002-2 se réfère plutôt à la « théorie X » de Douglas Mac Gregor, qui, en ressources humaines, fonde un management autoritaire. L’individu est sans goût de l’effort, il a besoin d’être contrôlé. Seule la menace de la punition stimule son effort puisqu’il n’a naturellement aucune appétence pour la responsabilité. Son seul but est de rechercher la sécurité, donc de rejeter a priori toute perspective de changement.
Selon cette option, l’usager doit faire la preuve de sa volonté d’améliorer sa situation, d’être méritant des efforts que fait la collectivité pour lui venir en aide. La condition de ses droits – car ils deviennent ainsi, insidieusement, conditionnels au lieu d’être universels – c’est le mérite qu’il conquiert par sa capacité à assumer ses devoirs[1].
Les débats qui environnent l’accès à la citoyenneté française pour les étrangers sont symptomatiques de cette conception. Une liste de devoirs est imposée qui ne possède aucune correspondance pour les autres citoyens. Le même raisonnement peut être tenu pour les mineurs délinquants. Autrement dit, on charge du côté des devoirs ce que l’on peine à donner du côté des droits selon un calcul discutable qui comptabiliserait une sorte de résultat entre produits et charges. C’est ainsi, par exemple, que les mineurs placés par mesure judiciaire dans un établissement éducatif, s’ils représentent la majorité des jeunes confiés, ne possèdent pas les mêmes droits que les autres en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil de la Vie Sociale[2].
L’usager soumis à ses devoirs est convoqué à être conforme, à entrer dans une norme définie en dehors de lui dans une société marquée par la distinction des responsabilités dans le registre de la faute.
L’usager titulaire de droits
La position inverse, plus appuyée sur Rousseau que sur Hobbes, se réfère à la « théorie Y » que Mac Gregor a développée en matière de management et qui promeut des pratiques participatives. Selon cette vision, l’effort est naturel à l’homme qui souhaite accomplir des objectifs et se mobiliser pour les atteindre. Son activité est empreinte d’imagination et de créativité. Il cherche les responsabilités qui le valorisent et en tire une satisfaction sociale faite de reconnaissance et d’accomplissement personnel.
Ici, nous trouvons les valeurs de la coopération et de la participation. La mobilisation de l’usager dans le projet le concernant devient possible. Elle est même la condition nécessaire à la réussite de l’action. Il ne s’agit plus de protection mais de promotion et ce processus s’appuie sur les droits reconnus de la personne. C’est un jeu de reconnaissance et de valorisation qui s’instaure en lieu et place d’un dispositif de contrôle et de surveillance.
L’usager titulaire de droits est appelé à la liberté et à la réalisation de soi dans une société de semblables.
Ces deux conceptions de l’homme ont des conséquences sur la conception de l’action. Nous avons l’habitude de les opposer selon les théories du workfare et du welfare.
Une conception de l’action
Welfare ou workfare ?
Le workfare est une théorie néolibérale apparue aux Etats-Unis dans les années 70 pour contrecarrer les politiques d’aide sociale (Welfare) jugées trop laxistes et incitatives à l’oisiveté. Pour bénéficier de prestations, l’individu doit travailler, c’est-à-dire prouver sa volonté de participer à son insertion, de rendre ce qu’on lui donne. Ce fut déjà l’intuition des ateliers généraux, en France, au XIXème siècle et ce qui inspirera le remplacement du RMI par le RMA en 2004…
L’intervention d’aide est envisagée selon un rapport dette/don qui repose sur une conception de la personne assistée. Celle-ci est dépendante du soutien qui lui est apporté. C’est ce qui autorise d’exiger d’elle une contrepartie. Cette contrepartie devient même la condition de l’aide. Nous quittons ainsi le principe d’inconditionnalité qui a fondé le système français de solidarité pour revenir aux modèles charitables de l’ancien régime. Le pauvre doit être méritant.
Ce grand retour de la morale au cœur des politiques d’action sociale n’est pas aussi massif et caricatural que le laisse entendre mon propos. Il s’agit d’un mouvement insidieux qui met en débat les tenants et aboutissants de l’action sociale à un moment où la dépense publique ne peut être à la hauteur de l’inflation quantitative et qualitative des besoins. Il y a fort à parier que le projet de loi annoncé sur la dépendance sera éclairant sur ce point. L’alternance politique a déjà montré que l’oscillation entre un principe universel de protection sociale et un principe individuel d’assurance résultait de projets politiques divergents.
Workfare ou welfare induisent deux conceptions de l’action sociale : une intervention sociale subsidiarisée dans le premier cas, une action sociale d’utilité collective dans le second.
Une intervention sociale subsidiarisée
La tendance actuelle est de développer des politiques sociales ciblées qui, progressivement, s’éloignent des principes d’universalité qui ont caractérisé la construction de l’action sociale en France.
Tendanciellement, l’action sociale quitte son ambition de répondre aux « besoins et attentes des membres de tous les groupes sociaux » (article L116-1 du CASF) pour se réduire à des dispositifs particularistes concernant des catégories spécifiques d’individus. A cette tendance s’ajoute une distinction entre les personnes qui peuvent agir sur l’aide reçue par leur pouvoir économique et celles qui ne disposent pas des moyens d’aller chercher sur le marché les services qu’elles souhaitent. Les premières disposent de la solvabilité nécessaire pour assurer la qualité de leurs prestations dans le jeu concurrentiel, les secondes sont soumises aux aides publiques et n’ont pas de liberté de choix.
Ce principe de subsidiarité d’une action sociale qui n’interviendrait qu’à défaut de la possibilité de recourir au secteur lucratif est déjà en train de s’installer, il a été introduit dès la loi 2002-2 – qui fut trop timide à valoriser les acteurs non-lucratifs de l’action sociale et médico-sociale – et renforcé par les lois qui ont suivi[3].
Une action sociale d’utilité collective
L’enjeu est, aujourd’hui, de réhabiliter une action sociale reposant sur les principes d’utilité sociale et d’intérêt général. La loi 2002-2 a failli être encore plus radicale sur ce point. Un rapport préparatoire à la réforme, réalisé par Pascal Terasse en mars 2000, proposait d’instaurer à l’action sociale et médico-sociale le statut de mission de service public. Cette option n’a pas été retenue : l’action sociale est trop politique pour n’être qu’une simple délégation de service public.
Cependant, le niveau et la place conférés à l’action sociale et médico-sociale restent en suspens. Qu’entend faire, aujourd’hui, l’État de cette « dette sacrée » qu’est la solidarité nationale telle que nous l’héritons de nos ancêtres révolutionnaires ?
Au niveau d’ambition où nous voulons la réhabiliter, l’action sociale ne peut se réduire à une simple fonction réparatrice destinée à colmater les brèches d’une société qui peine à remplir son obligation d’inclusion. Elle ne peut pas plus être investie d’une fonction de contrôle des populations déviantes, ni même chargée d’assurer une paix sociale en maintenant à l’écart des personnes hors norme.
A ce niveau d’ambition, l’action sociale est la condition de la démocratie, porteuse d’un principe d’accès de tous à une « citoyenneté de plein exercice » (expression utilisée par Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés lors de la présentation du projet de loi rénovant l’action sociale et médico-sociale à l’Assemblée Nationale le mercredi 31 janvier 2001).
Nous voyons que deux conceptions divergentes de l’Homme appellent deux conceptions opposées de l’action sociale. Pour évaluer les effets de ces clivages résultant, 10 ans après la loi 2002-2, des évolutions récentes, je vous propose d’achever mon propos en allant voir ce que cela produit du côté des organisations d’action sociale.
Une conception de l’institution
Opérateurs ou acteurs ?
Deux conceptions s’opposent quant à la place et au rôle que doivent jouer les institutions d’action sociale. Dans cet exposé, je m’intéresserais spécifiquement aux associations d’action sociale.
Une première tendance se réfère à un usager d’abord convoqué sur ses devoirs, pris en charge dans le cadre de politiques sociales qui n’interviennent qu’à défaut de ressources individuelles suffisantes. Dans cette configuration, l’usager apparaît quand le client n’est plus solvable. Globalement, cela signifie que le « marché du social » s’organise en deux ensembles : d’une part ce qui peut relever des règles de la concurrence lucrative et qui implique le moins d’intervention possible de l’État ; de l’autre l’aide sociale relevant du financement public, fortement administrée et contrôlée. Le premier ensemble consacre la figure du client avec ce que cela suppose de liberté pour évoluer dans un marché non-contraint. Le second ensemble convoque la figure du bénéficiaire soumis aux conditions d’octroi de l’aide.
Ces deux figures induisent l’une et l’autre une configuration identique des organisations d’intervention sociale s’adressant soit à des clients, soit à des bénéficiaires. Configuration identique parce que l’organisation est sous emprise soit du client – dont on sait qu’il est « roi » –, soit de la puissance publique. Dans un cas comme dans l’autre, elle ne dispose pas de l’autonomie nécessaire qui permet d’articuler l’instituant et l’institué dans un rapport qui fait institution, c’est-à-dire espace de droit et de relations, espace de construction sociale.
Des associations instrumentalisées
Toute l’évolution législative depuis 10 ans tend à inféoder les associations d’action sociale aux logiques exclusives de l’État. Ces logiques s’inspirent à la fois – et cela n’est pas aussi contradictoire qu’il y paraît – de la visée néo-libérale du new public management et de la volonté administrative et technocratique toujours plus prégnante qui s’exerce sur les « offreurs de services ».
C’est le contrôle qui prédomine : contrôle des personnes selon le principe de la société disciplinaire décrite par Gilles Deleuze ; contrôle des modes d’intervention sous l’empire de la technocratie ; contrôle des organismes qui mettent en œuvre les politiques sociales. Ce qu’il faut voir ici, c’est le parfait continuum qui s’établit entre la conception qui circule de l’usager (inféodé, dépendant, incapable, irresponsable) et la conception qui circule de l’organisation qui s’adresse à lui (contrainte, assujettie, contingentée…). Ce continuum en cache un autre, bien plus redoutable encore : la figure de l’usager identifié comme un consommateur comme celle de l’usager identifié par ses devoirs sont deux figures aliénées qui estompent totalement celle du citoyen.
Finalement, la montée en puissance de l’usager a doublement affaibli les institutions d’action sociale : D’une part elles se trouvent subordonnées à la satisfaction de leurs clients ; d’autre part, elles sont instrumentalisées par la commande publique qui ne les considère que comme de simples exécutantes. Et finalement, c’est l’usager-citoyen qui est instrumentalisé soit sous forme de client, soit par le retour de la vieille figure de l’indigent.
Des associations laboratoires de nouvelles solidarités
Pour que les associations d’action sociale passent du statut d’opérateur – agent soumis au diktat du client ou aux injonctions de l’État – à celui d’acteur, il faut faire un déplacement qui va de l’individu au sujet, du contrôle social à la promotion de la citoyenneté.
C’est sans doute là que l’héritage de la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale est à cultiver. Car, finalement, ce qui apparaît ici, c’est l’injonction paradoxale qui résulte de 2002 : d’une part l’annonce d’objectifs ambitieux de promotion de la citoyenneté des usagers ; d’autre part, la mise sous tutelle des organisations chargées de mettre ces principes en œuvre. Ce hiatus a pour effet d’isoler l’usager dans ses droits et d’instrumentaliser les établissements et services sociaux et médico-sociaux et surtout les associations qui les gèrent. Le premier phénomène entraînant l’autre et réciproquement. C’est ce cercle vicieux qu’il convient de rompre.
Il nous faut œuvrer à refonder les associations d’action sociale en les appuyant sur :
· Des usagers-citoyens pleinement titulaires de droits et mis en condition de les exercer totalement et sans discrimination ;
· Une action sociale et médico-sociale visant la promotion des personnes au nom du bien commun, de l’utilité sociale et de l’intérêt général ;
· Des institutions conçues comme acteurs à part entière de la construction d’une société de justice et d’intégration pour tous.
Cela suppose de repenser à nouveaux frais les postures professionnelles afin qu’elles se situent aux côtés des personnes, en solidarité avec elles, au soutien de leurs initiatives et compétences. Il s’agit là d’aller rejoindre les habitants sur les territoires, non pour leur apporter des solutions à leurs problèmes mais pour participer à la construction, par eux-mêmes, des réponses à leurs besoins. Cette association « laboratoire de nouvelles solidarités » que j’appelle ici de mes vœux a besoin de professionnels engagés et responsables qui s’adressent à des usagers qui vont engager leur responsabilité avec eux dans une relation de reconnaissance réciproque. A ce jour, le chemin ouvert en ce sens par la loi 2002-2 n’est pas encore abouti.
Cela suppose également que les associations d’action sociale ouvrent un vaste débat sur les finalités de l’action sociale dans la société, sur le statut du travail social et de ses institutions dans l’action publique, sur la place de chacun dans la construction d’une République démocratique et solidaire. Autrement dit, les associations d’action sociale doivent pleinement investir une fonction tribunitienne pour porter sur l’espace public une critique constructive fondée sur leurs observations de terrain.
Cela suppose enfin que les associations d’action sociale cessent de faire reposer leur légitimité sur la seule mise en œuvre des politiques publiques. Si, historiquement, c’est en mettant en place les dispositifs d’intervention, qu’elles ont conquis leurs lettres de noblesse, elles y ont perdu la puissance de leur projet politique, c’est-à-dire leur capacité à participer à la vie de la cité. Il devient urgent que les associations d’action sociale complètent les assises de leur validité en s’inscrivant délibérément dans le registre politique. Il convient ici que les associations politisent les questions sociales, parce qu’elles sont des sociétés de personnes qui portent un projet citoyen. Repolitiser l’action sociale[4] suppose d’ouvrir, au sein même des associations, de vastes espaces de délibération collective ouverts à tous, et en premier lieu, aux usagers.
Conclusion
Le titre de mon intervention était : « Droits, devoirs : sortir de l’individualisme ! » Nous avons vu que :
· Les devoirs appellent une conception étroite et enfermante de l’homme qui implique une action sociale clivée entre marché et administration et des organisations inféodées à la dictature du client-roi et à l’injonction technocratique.
· Les droits ouvrent des perspectives plus riches où l’usager est conçu comme acteur de sa vie, pleinement citoyen, et l’action qui s’adresse à lui vise la promotion d’un projet démocratique qui convoque des organisations qui sont à penser comme des laboratoires de solidarités.
L’analyse montre que la loi 2002-2 a ouvert ces hypothèses d’évolution, laissant béants les paradoxes liés à ces oppositions de conceptions. Les évolutions législatives durant ces dix années qui nous séparent de la publication de la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale vont plutôt dans le sens d’une action sociale subsidiaire au marché visant des usagers discriminés et appuyée sur des organisations fortement instrumentalisées.
Cependant, les dés ne sont pas jetés. C’est par leur capacité à se mobiliser, à mobiliser leurs professionnels, à mobiliser les usagers, que les associations d’action sociale peuvent créer les conditions d’une nouvelle citoyenneté (c’était un des termes clef de la circulaire de Nicole Questiaux, ministre de la solidarité nationale, en 1982, soit il y a trente ans !), au service d’une action sociale fondée sur le principe de solidarité, portée par des institutions démocratiques. C’est à ce prix que nous sortirons de l’individualisme au profit de la solidarité.
[1] Cf. R. Janvier, « Droits et devoirs, un équilibre trompeur », ASH, n°2506, 4 mai 2007.
[2] Cf. R. Janvier et Y. Matho, « Ne videz pas la loi 2002-2 de sa substance », ASH, n°2365 du 25 juin 2004.
[3] Nous pouvons notamment citer :
· La loi du 26 juillet 2005, dite loi Borloo relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : mise en concurrence des services à domicile lucratifs et non-lucratifs ;
· La loi du 21 juillet 2009, dite loi HPST, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui introduit les appels à projets comme instrument de régulation concurrentiel des offres de services ;
· Etc.
[4] Cf. DUBREUIL Bertrand, JANVIER Roland, PRIOU Johan et SAVIGNAT Pierre, « Repolitiser l’action sociale », ASH n°2737, 16/12/2011.
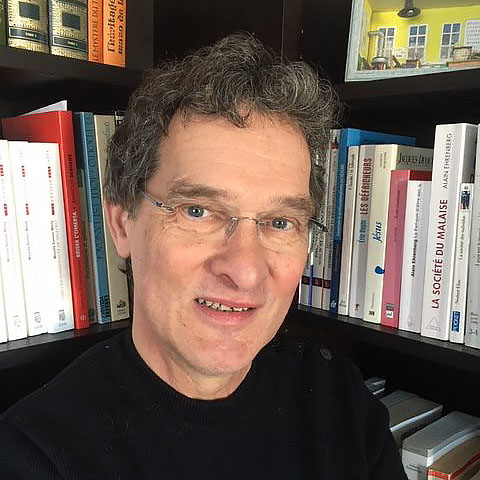
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.


