INTRODUCTION :
Aujourd’hui, l’homme serait menacé !
Je ne parle pas ici du virus A-H1-N1 mais d’une menace bien plus sourde : l’homme serait menacé de rationalisation.
Je ne parle pas ici de faits comme le brevetage du vivant, le retour de pratiques esclavagistes, le clonage ou le fantasme de l’homme bionique. Ce ne sont là que des chimères mercantiles ou diaboliques qui alimentent, peut-être à juste titre, nos phobies. Non, il s’agit ici d’une menace bien plus sourde : le retour d’Auguste Comte transformé en superman. C’est-à-dire avec la force en plus et l’intelligence en moins. Le retour d’un positivisme fondamentaliste qui croit que l’homme est réductible à de simples équations (sans inconnue) à des liens basiques de cause à effet : Bref il s’agit de la tentation de rationalisation de l’humain.
Quelques faits pour illustrer cette attraction sournoise :
- L’avatar du fichier « EDVIGE[1] » : sans entrer dans les détails, ce fichier repose sur l’idée que plus on en sait sur quelqu’un plus on maîtrise ses comportements et plus la sécurité publique est garantie. Il découle de cette pensée simpliste des mises en lien surprenantes : par exemple, l’orientation sexuelle de quelqu’un avec ses options politiques…
- Autre avatar, celui de l’expertise collective de l’INSERM[2] sur le dépistage précoce des troubles de conduite. La thèse de ce rapport radicalement contesté par le comité national d’éthique est simple : Un lien prédictif peut être établi entre les troubles comportementaux manifestés précocement par un sujet et la commission d’actes délinquants à l’adolescence. Lien de cause à effet débile qui justifie une traçabilité des comportements pour un « marquage » des publics.
- La tentative, loi à l’appui, de remettre en question l’irresponsabilité pénale pour cause de troubles psychiatriques (ces tendances ont trouvé leur apogée suite au meurtre d’une infirmière et d’une aide-soignante à l’hôpital psychiatrique de Pau). Michel Foucault doit se retourner dans sa tombe. Ses travaux sur la folie (Foucault, 1975) n’auguraient pas d’un tel retour en force des logiques répressives. La rationalisation de l’humain dont il s’agit ici porte sur la volonté de maîtrise de tous les comportements humains par la menace de la répression.
- Dernier exemple, la récente révision de l’ordonnance du 2 février 1945 en voie de codification dans un Code de la Justice Pénale des Mineurs. Incidemment, au travers des révisions plus que régulières de la justice pénale des mineurs, se glissent des mesures de plus en plus répressive autour du thème de la « tolérance zéro ». La rationalisation s’intéresse donc aussi à l’élevage des petits d’hommes : elle nous fait passer de l’éducation au dressage. L’éducation est un appel au développement de l’humanité de l’homme, le dressage n’est que contrainte et formatage.
La promotion de l’idée de qualité et de l’évaluation trouve naturellement sa place dans cette vaste tentation de rationalisation de l’humain. C’est à bon droit que nous devons nous méfier de démarches qui visent à simplifier la vie. Comme si la simplification était le bon moyen d’aborder les situations complexes. La simplification – qui n’est qu’une déclinaison camouflée de la rationalisation de l’humain – rôde autour de nous, dans nos pratiques de management d’organismes sociaux et médico-sociaux :
- Quand des méthodes de management sont transposées sans intelligence (c’est-à-dire sans être comprises) du monde de l’entreprise marchande à des organisations de l’économie sociale ;
- Quand les principes de certification sont implantés dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux en oubliant qu’ISO, cela veut dire « standard international ». J’ai pu lire ici ou là que la certification ISO permettrait de mieux personnaliser les prestations…
- Quand l’évaluation apparaît dans un texte de loi qui, par ailleurs, tente de mettre au pas un secteur d’activité jugé trop hermétique au changement, trop dispendieux et trop opaque au regard des décideurs politiques.
- Quand, à plus forte raison, les recommandations de bonne pratique sortent du bois en même temps que les indicateurs de convergence tarifaire, les tarifs plafond, la remise en cause des conventions collectives et autres entourloupes à forte coloration « néolibérale » (mot épouvantail s’il en est !).
Bref, la tendance serait à la rationalisation en s’accrochant à des repères simples, tangibles, indiscutables, voire même à prétention scientifique ! Analysées sous cet angle, qualité et évaluation se révèlent être de redoutables pièges qui enferment l’humain dans une raison inhumaine.
Il me semble cependant que la tentative de rationalisation de l’humain – que l’on a pu connaître en d’autres époques de l’histoire de l’humanisation de l’homme – est une entreprise vouée à l’échec :
- L’Homme ne peut se réduire à un fichier numérique, ni être circonscrit à ses comportements ;
- La répression est un cercle vicieux qui n’a jamais produit les effets vertueux de l’éducation et de la prévention ;
- La déraison continue à nous renvoyer à une dimension ontologique essentielle qui échappe à toute conformité préétablie ;
- La société a précédé l’Homme et continue aujourd’hui à lui donner un sens qu’il n’aurait pas s’il était isolé, s’il devenait radicalement un « individu ».
C’est dans cette tension entre la menace de rationalisation de l’humain et l’irrationalité persistante de la vie que je propose d’esquisser une perspective stratégique en forme de pari : «Evaluer pour prendre en compte l’humain dans toute sa complexité ».
Cette posture, résolument stratégique, c’est-à-dire entendant saisir les opportunités de la situation, prend appui sur quatre enjeux pour conduire l’amélioration de la qualité dans les établissements et services relevant de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale :
- Enjeux de communication d’abord : parce qu’une démarche d’amélioration continue de la qualité n’est rien d’autre qu’une vaste entreprise de communication qui relie les acteurs – tous les acteurs – entre eux, qui relie chacun à l’objectif visé, qui relie le projet et les pratiques.
- Enjeux de management ensuite : parce que les formes de gouvernance et les modalités de dirigeance qui découlent de cette ambition communicationnelle doivent être en cohérence, en alignement, avec la visée poursuivie et pour ce faire mobiliser tous les acteurs.
- Enjeux d’organisation également : parce que des formes participatives de management impliquent des configurations organisationnelles particulières, marquées par quelques mots clefs tels que : collégialité, coopération, transversalité, etc.
- Enjeux opérationnels enfin : parce que la qualité ne peut se payer de mots, sauf à nous exposer à la disqualification définitive de ce que nous faisons. La qualité est mise au défi des actes, de ce que ça produit concrètement dans la relation entre professionnels et usagers.
ENJEUX DE COMMUNICATION
La première opportunité qui s’offre à nous c’est que le terme « Qualité », en matière d’intervention sociale, est problématique. Quand on dit « LA Qualité » (au singulier et avec une majuscule s’il-vous plaît !) dans une usine de moulins à café (il s’agit d’un clin d’œil à Jean Baudrillard, 1978) on voit à peu près de quoi il s’agit : un appareil qui marche, qui fait ce qu’on attend de lui (réduire les grains en poudre) dans des conditions satisfaisantes (maniabilité, bruit, longévité…). Nous parvenons ainsi à nous mettre assez rapidement d’accord sur ce qu’est un moulin à café de qualité. Cela devient un peu plus compliqué si, au-delà des aspects pratiques, nous introduisons des dimensions plus subjectives de forme, de couleur, de « design », de nom… Il est alors plus difficile de se mettre d’accord (Mispelblom, 1999).
Partant de cet exemple simple d’un objet technique précis, chacun peut comprendre – même les non travailleurs sociaux d’origine – qu’une définition univoque de la qualité devient complexe, sinon impossible, quand il s’agit de « travail sur autrui » (Dubet, 2002). Cette impasse est une opportunité : la qualité, au lieu d’être une notion imposée de l’extérieur selon des normes exogènes au champ de l’action sociale devient un espace de débat.
Selon cet axe stratégique, la qualité ouvre une dimension délibérative qui mène tout droit au projet. Nous pouvons risquer l’hypothèse qu’en matière d’intervention sociale, c’est le projet (article L. 311-8 du CASF[3]) qui définit l’ambition qualitative d’un établissement ou d’un service. Qualité et projet seraient les deux faces d’une même réalité.
L’amélioration continue de la qualité revient donc à mettre et remettre sans cesse le projet sur le métier. Cela suppose d’instaurer des espaces de débat, des instances de délibération, des processus d’élaboration dudit projet.
La qualité ne peut être confisquée par aucun, ni par un groupe, la qualité est un enjeu central qui reste en tension entre les divers intérêts qui composent l’institution. La qualité, c’est comme le ballon au milieu d’un terrain de jeu, personne ne l’emporte mais on le fait circuler entre les joueurs. C’est au prix de cette circulation que la qualité ne devient pas un dogme fossilisé et qu’elle reste un « actif circulant » (l’expression parlera aux stagiaires Cafdes qui préparent leurs épreuves techniques). Active, la qualité l’est parce qu’elle est une énergie structurante de l’institution et de son projet. Circulante, la qualité l’est aussi parce qu’elle ne se fixe pas (sauf confiscation du pouvoir par quelqu’un – le directeur par exemple), elle est un fluide qui irrigue l’organisation, qui la finalise, qui lui donne sens.
C’est donc l’ensemble des parties prenantes qui doit être associé à la délibération sur ce qui fait qualité dans l’établissement ou le service. Parmi elles, les usagers. Ce sont souvent ceux qui sont les grands oubliés de la participation (Janvier, Matho, 2004). Par exemple, quand on parle d’associer les usagers à l’évaluation, on se satisfait trop souvent de leur distribuer une simple enquête de satisfaction. Je suis désolé, quand mon concessionnaire automobile m’adresse avec la facture de vidange-graissage de mon véhicule un questionnaire pour savoir si je suis content, cela ne me donne pas l’impression d’avoir participé à la réparation de ma voiture. L’enquête de satisfaction n’est pas un acte délibératif en lui-même. La participation à l’évaluation – qui n’est rien d’autre qu’une contribution au projet par le jugement porté sur la valeur des prestations – pour les usagers, doit prendre les formes d’une véritable coopération. Les usagers doivent se coltiner la question de la qualité, pour eux-mêmes et avec les professionnels.
Associer toutes les parties prenantes (cadres, salariés, gestionnaires, usagers, familles des usagers) à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la qualité est un acte central – et fondateur – de communication. Premier enjeu.
ENJEU DE MANAGEMENT
Le management, c’est notamment l’art de trouver un équilibre entre la stabilité de l’institution et le mouvement, entre l’ordre et le chao. Pour tenir cet équilibre, le directeur dispose de l’évaluation, un des moyens pour conduire le changement, et le contrôle, un des moyens pour maintenir l’ordre. J’ai montré, en introduction, que la logique répressive participait de cette tentation de rationalisation de l’humain. La répression a son ombre portée : une certaine conception du contrôle. En fait, il y a deux approches du contrôle :
- Le contrôle comme instrument de maîtrise des comportements : ce contrôle là est un piège qui repose sur la défiance, la suspicion, le doute.
- Le contrôle comme instance de régulation des fonctionnements : ce contrôle là est une sécurité à la fois pour l’organisation et pour ses acteurs.
Le risque est grand de confondre évaluation et contrôle. L’évaluation, prétextée par la volonté d’améliorer la qualité, peut devenir l’outil insidieux et sournois d’un contrôle à visée répressive. Dans ce cas, le système qualité n’est qu’un dispositif de renseignement, d’espionnage et de délation.
Pour que le « contrôle régulation » se distingue de l’évaluation de la qualité, il faut que l’un et l’autre existent, soient clairement identifiés et différenciés. Sinon, les institutions ayant, comme la nature, horreur du vide, l’un prendra la place de l’autre. Cette distinction déterminante entre contrôle et évaluation passe par la séparation des instances, des garanties éthiques, des différenciations temporelles, des distinctions terminologiques (les mots de l’évaluation ne sont pas ceux de l’audit). Nombre des productions actuelles sur l’évaluation dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux font preuve, sinon d’imprudence, du moins de négligence sur ces clarifications préalables indispensables.
Une fois réglée cette question du contrôle, l’enjeu managérial porte sur la mobilisation des acteurs, de tous les acteurs. Une démarche d’amélioration continue de la qualité qui ferait l’impasse sur une des parties prenantes serait menacée d’une perception faussée des choses, comme ce groupe d’aveugles indiens qui arrive sous les pattes d’un éléphant.
Le premier, qui tâte la patte déclare : « C’est une colonne que je touche, il s’agit donc d’un temple ! », le second fouetté par la queue dit : « c’est un balai ! », le troisième, frôlant l’oreille annonce : « c’est une feuille ! », le quatrième, palpant le ventre, affirme : « c’est une barrique » et enfin le dernier, caressant la trompe, s’exclame : « c’est un tuyau ». Chacun dispose d’une part de la vérité, aucun d’une vue d’ensemble de la réalité. C’est la confrontation de chaque point de vue qui permet d’approcher le fait qu’il s’agit d’un éléphant. Il en est de même pour la perception de cette réalité complexe et multiforme qu’est un établissement ou un service. Seule la confrontation des différents points de vue des parties prenantes permet d’avoir une vision panoramique de ce qu’il est. Cette complémentarité des regards est particulièrement précieuse pour le cadre hiérarchique (dont la vision est souvent très parcellaire).
Un management qui repose sur la mise en tension permanente des intérêts en présence et des points de vue qu’ils génèrent sur l’organisation, s’appuie, naturellement, sur les grands principes de la démocratie. Le modèle démocratique est en effet le modèle qui apparaît comme le plus abouti pour associer l’ensemble des intérêts particuliers qui composent un groupe autour de ce que nous appelons « l’intérêt général ».
J’emploie l’expression « s’appuie naturellement sur les grands principes démocratiques », non pour créer un lien d’évidence, mais pour mettre en valeur le fait, déjà montré ci-avant, que délibérer sur la qualité est un acte démocratique et qu’évaluer est un processus de délibération. Ce sont là deux éclairages essentiels de la démarche. C’est là une prise de position stratégique déterminante. Résumons-nous :
- La qualité, est ici conçue comme un espace de débat qui contribue à la construction sociale au travers d’une large controverse qui bouscule les évidences. Cette posture prend le contrepied de l’idée positiviste qu’il existerait une vérité toute faite, immuable et que cela autoriserait l’imposition de normes définitives.
- L’évaluation, est quant à elle envisagée comme la construction collective d’un jugement partagé sur la valeur de ce qui est fait, la cohérence des actes avec le projet. Cette posture s’oppose à une vision simpliste de l’évaluation qui se résumerait à la mesure des écarts entre ce qui devrait être fait et ce qui est réalisé.
- C’est à ces deux conditions stratégiques (débat + délibération) que l’amélioration continue de la qualité contribue à résister à la tentation de rationalisation de l’humain. Si nous abandonnons ces positions – tel le général qui bat en retraite sur le champ de bataille – nous laissons s’introduire, dans le champ de l’action sociale, des pratiques dangereuses qui reviennent à scier la branche sur laquelle les professionnels prennent appui.
ENJEU D’ORGANISATION
Chacun est d’accord, surtout parmi les cadres, il faut changer, faire évoluer nos institutions, s’adapter à l’évolution des besoins, mieux répondre aux attentes des usagers, s’adapter aux mutations de la commande publique. C’est une évidence ! Comme toutes les évidences, cela mérite d’être interrogé : changer oui, mais pour quoi ? Dans quel sens ?
Le guide de l’évaluation interne du CNESM[4] (décembre 2005), insiste lourdement sur le fait que l’évaluation est un élément central de la conduite du changement. Mais elle n’est pas qu’un simple instrument au service de ce changement. L’évaluation est à la fois le moyen d’un processus d’évolution et le processus lui-même. Elle est sans doute l’exemple même de ce qu’est le constructivisme. Pour résumer cette ligne épistémologique, nous pouvons citer le poème de Machado :
« Marcheur, il n’y a pas de chemin,
le chemin se construit en marchant…
Marcheur, il n’y a pas de chemin,
seulement des sillages sur la mer.[5] »
Le constructivisme repose sur l’idée que la réalité se construit au fur et à mesure que nous tentons de la décrire. Chaque pas accompli pour la saisir la fait fuir un peu plu loin sur la ligne d’horizon. Il n’y a de vérité que celle qui émerge de nos controverses, laissant constamment ouvertes toutes les interprétations disponibles à nos esprits.
Pour revenir à notre sujet, l’évaluation n’est donc pas la vérification d’une conformité à une réalité donnée une fois pour toute, l’évaluation est un processus de construction de cette réalité, d’une réalité commune, résultant d’un processus de débat inspiré de quelques grands principes démocratiques. Changer, selon cette perspective, n’est pas aller vers un horizon fixé mais évoluer ensemble dans un univers mouvant. S’adapter n’est alors pas « mieux répondre à la commande » mais construire ensemble des perspectives nouvelles pour l’action. Il n’y a pas de chemin pour guider nos pas vers le dessein d’un « grand horloger », « seulement des sillages sur la mer » qui nous permettent de constater, a posteriori, les hésitations de nos migrations. Il y a ainsi quelque chose de profondément humain dans l’évaluation :
- L’évaluation est humaine parce qu’elle n’est pas prédéterminée ;
- L’évaluation est humaine parce qu’elle intègre la complexité ;
- L’évaluation est humaine parce qu’elle « se construit en marchant. »
- L’évaluation est humaine parce qu’elle ne formate pas le changement mais le fait émerger de l’expérience de la vie.
Bien entendu (encore une expression qui signale une évidence), l’amélioration continue de la qualité vise l’amélioration des prestations. C’est-à-dire qu’il n’est pas question que tout ce bruit (ce « buzz ») ne conduise pas à des résultats concrets. Mais, là encore, il y a processus d’amélioration et processus d’amélioration. Une première vision de l’amélioration, celle que dénoncent les opposants à tout discours sur la qualité (ceux qui pensent que c’est par le refus pur et simple que l’on évitera la dérive de la rationalisation), correspond à une démarche de conditionnement. Améliorer la qualité revient alors à former de bons petits soldats qui exécuteront au mieux les consignes en suivant des protocoles stricts : pour aller du point A au point D, il faut, dans l’ordre passer par B et C.
Une autre conception de l’amélioration s’appuie sur les compétences des acteurs, leur intelligence des situations, vécue au plus près, leur capacité réflexive sur ce qu’ils font. Ici, ce n’est pas l’obéissance qui est convoquée mais l’intelligence et la responsabilité. L’amélioration n’est pas conformité à un protocole pensé de l’extérieur mais adaptation à une réalité en constante évolution qui oblige l’intervenant à s’approprier des processus : peu importe de l’ordre qui permettra d’aller du point A au point D, l’important c’est que ça ait un sens pour l’intervenant et pour le bénéficiaire.
Vous le devinez à travers mon propos, la posture stratégique que je défends ici n’appelle pas la docilité mais la compréhension (l’art de prendre ensemble). L’enjeu organisationnel qui se pose à nous est donc plutôt du côté de l’intelligence collective : concevoir une organisation qui mobilise l’intelligence collective.
Le manageur, dans cette perspective, va s’occuper en priorité de knowledge management et des concepts qui lui sont associés : distribution des connaissances (ou cognition distribuée), apprentissage organisationnel, communautés de pratiques, institution apprenante, etc. Le principe de cette ligne managériale se résume simplement : l’intelligence collective d’un groupe d’acteurs est toujours supérieure à la somme arithmétique des intelligences individuelles qui le composent.
ENJEU OPERATIONNEL
Dernier enjeu : tout cela ne doit pas rester au niveau des mots. L’amélioration continue de la qualité, ce n’est pas du baratin mais des actes, concrets, palpables.
A ce point de notre réflexion apparaît la menace d’une normalisation rampante des pratiques professionnelles. En effet, malgré tout ce qui vient d’être dit, la qualité et son évaluation représentent tout de même une vaste entreprise de formalisation des pratiques. Preuve en est : l’ANESM publie des « recommandations de bonnes pratiques professionnelles ». Plus normatif tu meurs !
La encore, deux voies s’opposent :
- Soit les recommandations de bonnes pratiques professionnelles représentent un cadre : dans ce cas, elles enferment les professionnels de terrain dans une alternative, une problématique binaire. Un cadre, on ne peut qu’être dedans ou dehors, aucune nuance n’est possible. Sous cet angle, les recommandations de l’ANESM seraient un cadre contraignant qui compromet la spontanéité de la rencontre, la subjectivité de la relation, l’inédit de la créativité humaine.
- Soit les recommandations de bonnes pratiques professionnelles sont un repère : dans ce cas, elles sont comme un amer pour le marin, un point qui permet de se situer, de prendre position. Par rapport à un azimut, nul ne peut être dedans ou dehors, mais chacun peut par contre noter sa position, avec toutes les nuances qu’il convient, sans la culpabilité moralisante du bien et du mal.
Les bonnes pratiques dont il est question ne sont donc pas à envisager comme des carcans mais comme la tentative d’énoncer, à un moment donné, l’état des connaissances sur une question, les représentations dominantes dans un champ professionnel. Ce que l’on pense être le « mieux[6] ». Cette « prise de position » (au sens maritime du terme) relève :
- D’un inventaire des pratiques en cours dans le champ professionnel sur le sujet concerné ;
- D’une délibération plus que d’un arbitrage qui met en valeur les lignes forces qui structurent les conduites ;
- D’une tentative, datée et limitée[7], de formalisation en vue d’une large communication au secteur.
L’essentiel ne réside pas dans le texte lui-même mais dans la manière dont les équipes de terrain se saisissent de ces réflexions pour les incorporer dans leurs pratiques. Certes, les recommandations ont une dimension normalisante. Mais les repères normatifs en train de se faire – nous vivons en ce sens un moment historique tout à fait remarquable et passionnant pour le travail social – n’imposent pas une norme « en surplomb », une norme exogène. Il s’agit d’introduire ici toute la différence que font les scientifiques entre les normes de proscription (les interdits posés par la loi) et les normes de prescription (les injonctions positives portées par les mœurs). Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles s’inscrivent délibérément dans la prescription, l’émergence de repères directement issus des pratiques.
C’est en ce sens qu’il me paraît intéressant de parler de « normes d’usage »[8], c’est-à-dire d’un « ensemble de règles validées par les interlocuteurs. [9] » Cet ensemble reflétant la disparité des pratiques : « l’usage lui-même n’est pas une donnée homogène, il est, au sein d’une même collectivité, très diversifié selon les différents groupes et sous-groupes.[10] »
Dans l’extrême complexité qui caractérise le travail social, la norme d’usage est une réponse particulièrement adéquate. La norme d’usage est rendue possible par l’ambiguïté des autres normes. C’est parce que les normes de droit, les normes éthiques ou encore les normes de marché ne clôturent pas totalement et de manière définitive les comportements que des conduites d’acteurs restent possibles et ouvertes. Même si l’ANESM, dans une sorte de délire dictatorial, voulait faire des recommandations de bonnes pratiques l’alpha et l’oméga des pratiques, elle n’y parviendrait pas. Parce que les professionnels composent sans cesse avec ces normes pour en faire usage.
Le premier enjeu opérationnel consiste donc à ne pas s’enfermer dans un système normatif clos. La démarche d’amélioration continue de la qualité ne formate pas les pratiques, elle les interroge, ce qui n’a rien à voir.
Du point de vue du manageur, l’opérationnalité d’une démarche d’amélioration continue de la qualité passe donc par quelques conditions que vous ne trouverez pas souvent dans les référentiels qualité, vendus ici ou là :
- Permettre aux professionnels de décrire leurs pratiques. C’est un chantier énorme qui débute seulement et se trouve largement entravé par les cultures dominantes dans le travail social (l’indicible de la relation duelle en référence au modèle psychanalytique, la culture de l’oral…).
- Créer des espaces de mise au travail des pratiques (groupes de parole, supervision, analyse de pratique…).
- Instaurer un dispositif d’identification des facteurs de non qualité qui ne devienne pas un système de délation.
- Anticiper les situations à risque afin de ne pas être dépourvu dans les moments de crise tout en laissant ouverte l’inventivité et la créativité inhérente à toute rencontre intersubjective.
- Sécuriser les postures professionnelles pour permettre à chaque salarié de donner le meilleur de lui-même, sans appréhension.
CONCLUSION
L’urgence d’évaluer pour résister à la tentation de rationalisation de l’humain…
Le rapide parcours que nous venons d’accomplir, au travers de quatre enjeux pour conduire la qualité dans l’action sociale, a voulu démontrer l’intérêt de saisir les opportunités offertes par l’introduction, via la loi 2002-2, des notions d’évaluation et de qualité des prestations.
A ceux qui dénoncent la manœuvre rampante d’une « mise au pas » incompatible avec les missions du social et qui prônent la résistance et le refus, je dirai : vous devriez voir le potentiel offert par le terrain. Ne pas prendre les enjeux à bras le corps vous expose à ce que d’autres règlent à votre place ces questions.
A ceux qui foncent tête baissée dans ces nouvelles modes de la rationalisation – et payent parfois très cher des consultants et des référentiels qui leur volent leur âme – je dirai : méfiez-vous des sirènes de la simplicité. Ne pas prendre les enjeux à bras le corps vous expose à ce que tout devienne simple, au grand dam de la complexité qui caractérise l’humain et le « travail sur autrui ».
Roland JANVIER
Mai 2009
[1] Exploitation Documentaire et Valorisation de l‘Information Générale.
[2] Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
[3] « Art. L. 311-8. – Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation. »
[4] Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-sociale qui a fonctionné de 2005 à 2007 avant d’être remplacé par l’Agence Nationale de la qualité et de l’Evaluation Sociale et Médico-sociale.
[5] Antonio Machado, Chant XXIX « proverbes et chansons ».
[6] Il s’agit donc plutôt de best practices que de good practices.
[7] La preuve en est que, sur un sujet où la doctrine n’est pas encore stabilisée, l’évaluation interne, le CNESM, puis l’ANESM ont publié successivement trois documents de référence. Visiblement, rien n’est gravé dans le marbre.
[8] Je décline ce concept dans un ouvrage à paraître aux éditions de l’EHESP qui traite du rapport d’usage dans l’action sociale.
[9] Cecilia Serra, Introduction à la Linguistique Générale 2006/07 Cours n 1 : http://www.unil.ch/webdav/site/ ling/shared/cours_n.1.pdf .
[10] Ibid.
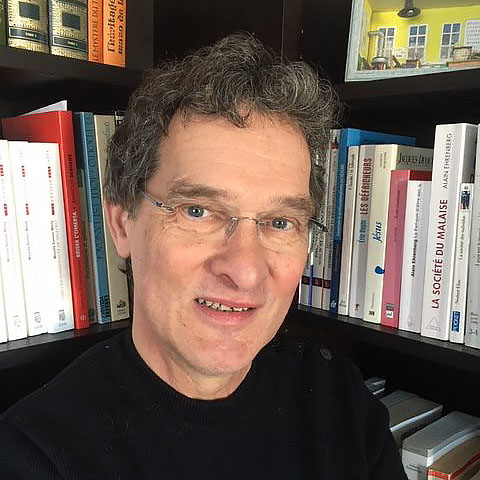
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.


