De l’héritage libéral…
La loi Le Chapelier (14 juin 1791) proscrit les organisations ouvrières, les corporations professionnelles…, bref, entend mettre un terme aux corps intermédiaires qui, aux yeux de Montesquieu étaient pourtant garants de la liberté. La Révolution française instaure ainsi une démocratie qui, pense-t-on alors, n’a besoin d’aucune médiation entre l’État et le Citoyen.
C’est sur ces bases que s’est construite la conception moderne du rôle de l’État. C’est selon cette matrice fantasmatique d’un lien direct entre chaque citoyen et l’État que s’est forgée la culture des pouvoirs publics et de ceux qui les servent.
Ce n’est qu’en 1901 que la loi sur les associations officialise le fait que des initiatives de citoyens, regroupés entre eux par contrat, participent effectivement de la dynamique démocratique de notre République. Ce n’était peut-être pas un revirement culturel, juste une concession.
Dans le domaine spécifique de l’action sociale, l’État avait repris à son compte, dès 1792, la « dette sacrée » assurée principalement jusqu’à la Révolution par l’Eglise catholique à l’égard des « citoyens malheureux ». Les pouvoirs publics tentaient ainsi de rompre avec le modèle caritatif. Cependant, ils n’ont pas été en mesure d’assumer sans relais les actions nécessaires auprès des membres les plus fragiles de la société. Les congrégations, les institutions religieuses, les initiatives philanthropiques ont perduré hors de la compétence publique.
C’est à bas bruit que le secteur de l’action sociale s’est développé, dès le début du vingtième siècle, sous forme d’initiatives privées par le truchement de sociétés diverses, œuvres de bienfaisance ou patronages. Puis, dans les années de fort développement qui ont suivi la seconde guerre mondiale, ce sont des associations qui sont venues à la rescousse, multipliant les initiatives, faisant preuve d’une réelle créativité. Les corps intermédiaires avaient été chassés par la porte d’une législation contraignante, ils sont revenus par la fenêtre d’une initiative locale en réponse aux besoins immédiats.
… à la confiscation professionnelle
Mais la légitimité des associations d’action sanitaire et sociale ne s’est pas fondée, à ce moment de leur histoire, sur la nécessité de constituer des espaces de médiation sociale entre le peuple – le lieu d’émergence des besoins – et les gouvernants – le lieu de décision des réponses à apporter. La régulation s’est jouée sur une autre scène que celle, très politique, de la confrontation des demandes et de l’offre. C’est l’émergence d’un corps professionnel qui a fait le travail. C’est par une technicisation des réponses que la reconnaissance des associations s’est construite progressivement. Se sont ainsi constitués des métiers, des diplômes et, surtout, des pratiques qui ont légitimé le travail social, lui ont conféré ses lettres de noblesse.
La professionnalisation du travail social a eu trois conséquences essentielles pour le développement des associations :
D’une part, la prédominance de la régulation professionnelle a affaibli la dimension politique des associations. L’excellence associative a progressivement glissé d’une fonction d’analyseur des situations sociales à la réponse concrète aux besoins sociaux. Autrement dit, alors que le contrat associatif initial reposait sur l’analyse critique de la société, à travers l’invention de réponses pragmatiques, le système a évolué vers des interventions mises en place par des équipes de plus en plus spécialisées tendant à enfermer la question initiale dans des réponses instrumentales. De politique, le débat est de venu technique. Au lieu d’interroger les choix de société, les associations s’interrogeaient plutôt sur les références théoriques soutenant leur intervention (pédagogie institutionnelle, antipsychiatrie, autogestion…). Débats, certes utiles, qui perdurent encore aujourd’hui, mais qui ont estompé le fond politique du travail social.
D’autre part, la professionnalisation a eu pour effet de repousser les usagers à l’écart des espaces de travail et en dehors des instances délibératives. Selon les filiations historiques[1], les bénéficiaires des actions n’ont pas les mêmes places, ni les mêmes rôles, ni encore les mêmes représentations au cœur du projet associatif. Mais un trait commun traverse l’histoire des associations de l’action sociale : le processus de professionnalisation a repoussé les bénéficiaires de l’intervention hors des lieux d’expertise. Pour le dire autrement, l’expertise a été confisquée par les spécialistes et les savoirs impliqués des publics ont été minorés, voire ignorés. Dans le même mouvement, les instances délibératives des associations ont fonctionné sans les bénéficiaires. Cela n’a jamais choqué personne. Pourtant, pour établir une comparaison provocante, imaginons ce que serait le secteur sportif en France si, à l’origine des clubs amateurs, s’était imposé un modèle qui interdise à tout pratiquant d’une discipline sportive d’être administrateur ou même simple adhérent de l’association qui gère l’équipe…
De plus, la montée en puissance des logiques professionnelles a eu une incidence forte sur les modes de financement des associations d’action sociale. La professionnalisation avait un prix : celui des salaires à verser aux salariés. Progressivement, au nom de la solidarité nationale, les fonds publics sont venus répondre aux besoins des associations. Ces subsides furent d’abord larges (les trente glorieuses !), puis ont fait l’objet de rationalisations (Rationalisation des Choix Budgétaires) et enfin, ont été fortement contenus par des encadrements de moyens (Objectif National de Dépenses de l’Assurance Maladie, coûts cibles, prix moyens à la place, État Prévisionnel des Dépenses et des Recettes…). La manne, providentielle au départ (c’est l’adjectif que l’on accolait alors à l’État), est subrepticement devenue le cordon ombilical des associations, signant leur dépendance définitive à la puissance publique et réduisant du même coup sa capacité critique à l’égard des politiques sociales publiques. Mais il fallait bien payer les salaires…
Ne nous méprenons pas, il n’est pas question ici de dénoncer comme responsable de tous les maux associatifs la présence de personnels qualifiés dans les associations, bénéficiant de statuts reconnus, sécurisés par des dispositifs conventionnels intelligents. Il est juste question d’en mesurer les incidences, non par excès de ce que certains dénoncent comme un « confort des professionnels », plutôt par carence des associations à assumer leurs autres rôles qui, au-delà de la fonction employeur, les amènent à occuper une fonction tribunitienne dans les débats de société.
Par ces effets historiques de vidage de la teneur politique des projets associatifs, de mise à l’écart des citoyens bénéficiaires des actions et de mise en dépendance d’un financement public exclusif, les associations d’action sociale se sont réduites à des fonctions de plus en plus instrumentales.
Quid des espaces et des moyens de médiation sociale ?
La maturation du projet démocratique de nos sociétés modernes met en évidence la nécessité de corps intermédiaires dans les relations entre les décideurs politiques et les citoyens. L’Europe ne pourrait fonctionner sans les groupes de pression qui orientent ses décisions. Les lobbys qui interviennent à Bruxelles sont la condition même de l’efficacité du système. Sur un plan plus large, les Organisations Non Gouvernementales jouent un rôle déterminant auprès des instances internationales et mondiales et contribuent de manière irremplaçable à la construction d’un droit international dans des domaines aussi variés que les droits de l’Homme, le droit pénal ou le commerce.
La France n’échappe pas à cette logique et le mythe révolutionnaire d’un État pouvant se passer de corps intermédiaires pour gouverner a vécu. Cependant, notre culture politique peine encore à reconnaître et valoriser le rôle des espaces de médiation dans la construction sociale. Un des lieux sensibles de ces tensions est le secteur de l’action sanitaire et sociale pour ce qui est des relations entre les pouvoirs publics et les associations. Combien de fois constatons-nous auprès de l’administration publique ou des collectivités locales que le rôle des associations n’est conçu que comme un rôle de prestataire ?
C’est comme si les décideurs politiques voulaient oublier que l’action sociale n’a pu se construire en France que grâce à ces espaces intermédiaires qu’ont été, et que sont encore, les associations. Jamais elles n’ont été de simples courroies de transmission de politiques sociales vers des publics. Elles ont toujours été, parfois à l’insu de leurs dirigeants, des interfaces entre les lieux de décision et les bénéficiaires. Elles ont « traduit » les politiques en dispositifs d’action et ce travail de traduction n’est pas une simple opération de conversion : c’est une œuvre créatrice qui ouvre de nouveaux possibles, qu’on le veuille ou non. C’est en cela que nous pouvons parler d’associations de solidarité parce qu’au-delà de l’action sanitaire et sociale qu’elles développent, elles recréent du lien social. A cela, une raison essentielle : la société, pour vivre et se développer a besoin d’interstices, d’espaces, de lieux où ça circule, de passages qui font transition.
La principale difficulté ne tient-elle pas à ce manque de lucidité sur le rôle effectivement joué par les associations dans l’intervention publique d’action sociale ? Cet impensé permet aux administrations publiques d’envisager l’instrumentalisation des associations comme une perspective sérieuse, gage de meilleure performance du système. Elles confondent alors la fonction subsidiaire des associations de solidarité avec un rôle subalterne dans lequel elles voudraient les enfermer. Si elles ne sont que des prestataires, inutile de leur attribuer trop de subsides. C’est alors le règne des budgets standardisés – parce qu’exclusivement centrés sur les prestations – et la remise en cause de plus en plus fréquente des frais liés à la vie statutaire de l’association.
Derrière cette mise à mal du fait associatif dans l’action sociale, c’est la question du contrat social qui est en cause. Les compromis issus de la Révolution française et de l’évolution qui s’en suivit (des droits politiques vers les droits sociaux) ne tiennent plus aujourd’hui. Ou plutôt, ces équilibres fragiles ne peuvent plus tenir de la même façon parce que le contrat social – qui lie les citoyens à l’État et donc entre eux – s’est profondément modifié sur fond de crise : crise de confiance des citoyens envers leurs élus, crise de la démocratie représentative, crise des institutions républicaines.
Vers une réarticulation des pouvoirs
Il semble donc urgent de repenser les liens entre les parties prenantes du projet démocratique qui ne peuvent plus être pensés de manière binaire et clivée. Décideurs politiques, citoyens-usagers et associations se sont, dans l’histoire récente, utilisés les uns les autres, deux à deux, pour s’opposer au troisième. La parole des usagers a été récupérée par les pouvoirs publics pour opposer aux associations un programme de remise en ordre. Les associations elles-mêmes se sont approprié les usagers en s’autorisant à parler en leur nom.
Ce serait peut-être sur le mode d’une triangulation (décideurs politiques – usagers citoyens –associations de solidarité) qu’il faudrait tenter de refonder un contrat social d’un nouveau genre dépassant les limites héritées du siècle des lumières. Dans ce nouveau système, la qualité du lien entre deux parties dépend de la qualité des autres interactions. Cette schématisation repose sur la différenciation des places, condition même de l’ouverture de l’espace démocratique.
Sans que les rôles ne soient totalement exclusifs les uns des autres, nous pouvons repérer des dominantes liées à chaque acteur :
- Les usagers citoyens sont légitimes à revendiquer les réponses à leurs besoins ;
- Les décideurs politiques sont investis de la légitimité à décider des actions (utilisation des fonds publics) ;
- Les associations de solidarité ont, quant à elles, la légitimité à agir, à conduire les interventions sociales.
Le risque que court actuellement notre système démocratique, c’est que l’État s’attribue tous les rôles. Cela paraît particulièrement sensible en action sociale. Pour exemple, analysons rapidement ce qui se produit avec la mise en places des Agences Régionales de Santé (ARS) issues de la loi de 2009 « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » (HPST). Ces agences régionales sont d’abord, contrairement aux apparences, le symptôme d’une recentralisation technocratique de l’État. Ensuite, sous couvert de « démocratie sanitaire », elles récupèrent les représentations des usagers dans des instances participatives qui, de fait, entérinent un mode de gestion du sanitaire et du médico-social qui est décidé ailleurs… et sans les bénéficiaires. Par ailleurs, la montée en puissance de la représentation des usagers a pour effet induit, sans doute voulu, de mettre à distance les associations gestionnaires qui n’auraient plus de légitimité à partager leurs diagnostics et analyses des phénomènes sociaux. Finalement, les ARS concentrent tous les pouvoirs : en amont, celui de définir les besoins à partir de constats effectués en interne ; celui de définir et de financer les actions à partir de procédures d’appels à projets qui instrumentalisent les opérateurs de terrain dans des jeux concurrentiels ; en aval, le pouvoir d’évaluer la pertinence des actions réalisées.
L’issue démocratique à cette impasse technocratique et gestionnaire est de réarticuler en les séparant les fonctions sociales de revendication – posture citoyenne – de décision – légitimité des décideurs politiques – et d’action – savoir-faire des associations de solidarité.
Revendiquer
La souveraineté populaire ne peut rester mythique. Elle doit s’enraciner dans toutes les dimensions de la vie sociale comme capacité d’agir des citoyens : individuellement, comme pouvoir de prendre en main son destin, collectivement, comme aptitude à délibérer sur le projet de société. Cela vaut tant pour l’activité économique, que pour les choix d’aménagement du territoire et des infrastructures ou qu’en ce qui concerne les enjeux de santé et d’éducation et, particulièrement en l’occurrence, les actions sanitaires, sociales et médico-sociales.
Cette posture citoyenne d’usagers de l’action sanitaire et sociale faisant valoir leurs besoins et les réponses qu’ils attendent suppose l’organisation de collectifs[2]. La fonction de revendication – entendue ici comme une contribution à la construction sociale et non comme une opposition ou un dénigrement systématique – est inhérente à la citoyenneté qui n’est pas une qualité exclusivement individuelle. Cela signifie que cette posture revendicative peut être occupée par des individus et des collectifs.
La bonne dynamique de cette fonction où des citoyens, seuls ou en groupe, demandent des réponses aux besoins sociaux suppose qu’elle soit correctement distribuée dans tous les espaces de la vie sociale. Autrement dit, elle ne peut être l’apanage des seuls individus, risquant de les enfermer dans une sorte de réclamation consumériste attendant toutes solutions en dehors d'eux et cultivant une position passive. Elle ne peut pas plus être confisquée par le jeu politicien des appareils de pouvoir qui transformeraient la fonction revendicatrice en clientélisme électoral. Elle ne doit pas être non plus happée par les administrations qui transforment alors les rapports de forces qui structurent la vie sociale en une instrumentalisation technocratique des acteurs. Elle ne peut enfin être appropriée exclusivement par les associations qui, en aucun cas, ne peuvent parler en lieu et place des usagers en confisquant l’autonomie de leur parole.
La bonne dynamique de cette fonction revendicative suppose que toutes les places soient occupées et différenciées. C’est donc en premier lieu les citoyens, à titre personnel et organisés en collectifs qui doivent porter une parole critique sur la construction de la société. Cela n’empêche pas que le débat sur les orientations à prendre concerne aussi les organisations politiques, les administrations et les associations mais jamais à l’exclusion usagers.
Décider
La décision, dans notre démocratie représentative, relève, légitimement, de la représentation Nationale. Ce sont les élus du peuple qui décident de ce qu’il convient de faire, des réponses à apporter aux revendications citoyennes. C’est à eux, sur la base d’un projet politique qui fait l’objet d’un quasi-contrat électoral, que revient la tâche d’orienter la dépense publique.
Cette posture n’est pas une position de toute puissance car elle est soumise au contrôle populaire et toujours menacée par le verdict des urnes. Les orientations se réfèrent au programme qui a justifié l’accession des élus aux fonctions représentatives.
Cette posture est parfaitement incompatible avec la scandaleuse expression « qui paye décide ». Ce n’est pas parce qu’ils payent que les élus décident des orientations. Ils payent parce qu’ils sont autorisés à dépenser l’argent public, l’argent des citoyens, en référence aux orientations qui ont amené le peuple à leur confier un mandat. Ce qu’ils payent, ce ne sont pas leurs envies mais les réponses qu’ils choisissent d’apporter à la revendication populaire.
Cette manière d’envisager les choses ne rend plus possible, au pouvoir politique, de confisquer la fonction d’expertise qui reste, et doit rester, le fait des citoyens : expertise de l’expérience vécue, là où naissent els demandes.
Agir
Enfin, après avoir distingué et réarticulé les fonctions de l’expression des demandes et de la décision d’agir, il faut repérer les caractéristiques de la réalisation de l’action. C’est là qu’interviennent les associations de solidarité. Leur aptitude à mettre en œuvre des réponses sociales, planifiées, autorisées et financées par la puissance publique s’appuie sur leur professionnalisme, dont nous venons de montrer le potentiel et les limites.
A ce stade de notre raisonnement, ces associations pourraient n’être que des exécutantes. Le débat entre les citoyens et les pouvoirs publics débouche sur des choix d’intervention pour lesquelles il suffit de trouver des prestataires : les meilleurs au moindre coût. Suivre ce raisonnement – qui correspond à une réalité dans nombre d’administrations – c’est introduire un clivage dangereux entre les termes de la triangulation schématisée plus haut. C’est céder à l’illusion technocratique qui consiste à croire :
- Que la réponse aux besoins sanitaires et sociaux s’inscrit dans une simple logique de cause à effet (stimuli/réponse, action/réaction) ;
- Que la forme et les modalités de la réponse n’ont pas d’incidence sur l’expression du besoin et son évolution (autonomie de l’action au regard des causes) ;
- Que la réponse peut se concevoir indépendamment des conditions de la demande (standardisation des prestations).
Alors qu’en réalité toute intervention sanitaire et sociale :
- S’inscrit dans un effet systémique qui relie tous les termes du dispositif depuis la demande jusqu’à la réponse en passant par les modalités d’inscription sur l’agenda du décideur ;
- Instaure des boucles rétroactives dans lesquelles les parties prenantes interagissent selon des liens d’interdépendance très forts ;
- Suppose une adaptation singulière aux spécificités de la situation (contexte socio-économique, conditions d’émergence du besoin…).
Les associations de solidarité ne peuvent donc, sauf à passer à côté de l’essentiel de leur efficience, n’être que des instruments des politiques sanitaires et sociales. Elles sont les outils du dispositif d’intervention, mais des outils intelligents, interagissant d’une part avec les lieux de la demande citoyenne et d’autre part avec les lieux de la décision publique.
L’interaction avec les usagers doit s’organiser tant à l’externe qu’à l’interne de leur organisation. A l’externe, les associations de solidarité ont tout à gagner à entretenir un lien régulier avec les organisations d’usagers, à les reconnaître et, ainsi, à favoriser leur développement. A l’interne, les associations de solidarité doivent développer des modes de gouvernance qui incorporent les usagers au cœur même des lieux de décision. Tant en ce qui concerne les décisions d’action (associer l’usager au plan d’aide) que les lieux d’orientation (associer les usagers, ou leurs collectifs représentatifs, à la gestion politique de l’association).
L’interaction avec les lieux de la décision publique suppose la présence offensive des associations de solidarité dans le débat public, qu’elles y occupent une véritable fonction tribunitienne, aux côtés des usagers, pour la défense des réponses aux revendications citoyennes.
C’est parce qu’elles prennent part à la délibération démocratique, fortes de leurs liens avec les usagers et leurs organisations collectives, que les associations de solidarité joueront leur rôle d’espace intermédiaire, de lieu de médiation sociale, indispensable au renouvellement démocratique de notre société.
[1] Par exemple s’il s’agit d’une association de parents d’enfants handicapés ou d’une association issue d’une congrégation religieuse, ou encore d’une association créée par des magistrats ou des inspecteurs de l’Education nationale
[2] Le modèle repéré du Collectif Inter associatif des usagers du Système de Santé (CISS) montre un chemin possible.
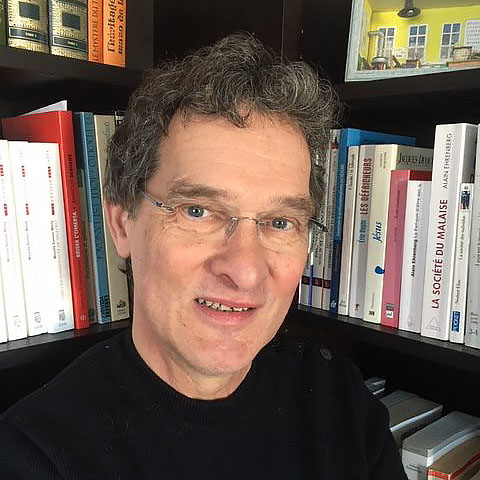
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.



