1. Introduction
« L’action sociale est sous tension ! Contraintes budgétaires croissantes, inflation législative et réglementaire, publics dont les besoins évoluent ou les difficultés s’accroissent, commande publique incertaine, parfois chaotique, désarroi des professionnels et des fonctionnaires dans l’exercice de leur mission… les signes d’inquiétude se multiplient, le climat se détériore en profondeur, un processus de délitement semble à l’œuvre. » C’est ce que nous déclarions dans les ASH sous le titre « Repolitiser l’action sociale » avec Bertrand Dubreuil, Johan Priou et Pierre Savignat (Dubreuil et al., 2011).
Repolitiser l’action sociale suppose d’analyser le contexte sociétal dans lequel elle s’inscrit et de redéfinir des perspectives d’action. Pour ce qui concerne cet exposé, il s’agit d’aller un peu plus loin et de s’interroger sur les formes d’organisations associatives d’action sociale qui pourraient participer à cette refondation politique de l’action sociale.
2. Eléments de contexte
Parmi les nombreuses évolutions qui caractérisent aujourd’hui l’action sociale, et qui impactent les organisations qui la portent, nous pouvons en retenir trois, particulièrement déterminantes : l’extension et la radicalisation de la référence au marché ; la fragmentation des espaces sociaux et le retour d’un positivisme radical.
2.1. Une société néolibéralisable
L’extension et la radicalisation de la référence au marché porte un nom : le néolibéralisme. Cette matrice idéologique se traduit, dans le champ de l’action sociale, par la diffusion de quelques notions qui ébranlent les fondements historiques de ce secteur (Savignat, 2012) : la marchandisation des prestations, la représentation véhiculée à propos des dépenses d’action sociale, l’organisation d’un système concurrentiel entre les opérateurs.
2.1.1. La marchandisation des prestations
Le terme de « prestation » symbolise les mutations qui bousculent l’intervention sociale. L’accompagnement de personnes fragiles, la prise en charge de personnes en difficulté, la relation d’aide, l’acte éducatif, le soutien à la résolution de problèmes sociaux, tendent à se résumer dans ce concept fourre-tout de « prestation » (Karsz, 2004). Expression que le dictionnaire définit comme la fourniture d’un bien ou d’un service. C’est une vision réductrice : toute la complexité du travail avec autrui qu’est l’intervention d’aide est estompée et avec elle le rapport d’altérité, l’intersubjectivité, l’alliance et le chemin parcouru l’un vers l’autre pour permettre une rencontre et le chemin parcouru ensemble pour initier un compagnonnage.
Cette simplification alimente et est alimentée par une idée simple : La relation d’aide peut être mise sur le même plan que n’importe quelle autre activité sociale. Elle peut ainsi s’inscrire sans distinction dans le jeu des échanges sociétaux. Ce qui, in fine, permet de l’intégrer à des logiques de marché, au même titre que les activités de commerce. Cette banalisation qui va de l’intervention sociale à la prestation de service participe de ce processus de « chalandisation » (Chauvières, 2007) où tout peut être ou devenir objet marchand.
Cette réduction de la prestation à sa seule dimension utilitariste semble mortelle pour le fait associatif. En effet, « les rapports d’association ne peuvent être analysés par le seul prisme utilitariste, ils appellent une référence à la solidarité. » (Laville, 2010, p.24).
2.1.2. La représentation véhiculée à propos des dépenses d’action sociale
Dans un contexte de crise économique, les financements socialisés de l’action collective se crispent. La réduction des moyens de la puissance publique met en tension les dépenses consacrées à la solidarité nationale. Les charges de l’action sociale paraissent ainsi d’autant plus lourdes que l’inflation des besoins se révèle plus fortement du fait des effets sur les ménages d’une économie qui se dégrade. C’est un cercle vicieux : la crise aggrave les situations sociales et ne permet pas d’en financer le traitement à hauteur des besoins, empirant ainsi les problèmes sociaux par défaut de moyens mobilisés ce qui entraîne des coûts supplémentaires, etc.
L’issue à ce dilemme pourrait consister à découpler le financement de l’action sociale du cycle économique de production de richesses à court terme. Autrement dit, il s’agirait de traiter l’action sociale en dehors des comptes d’exploitation de la Nation. C’est le sort réservé aux investissements dans les règles de la comptabilité : ils sont traités dans le bilan et non dans le compte de résultat. Leur temporalité est inscrite dans le long terme ce qui réduit leur impact dans le compte de résultat qui repose, lui, sur le temps court de l’exercice budgétaire.
Plutôt que d’être considérée comme une charge, l’action sociale devrait être traitée comme un investissement. Cette approche rompt avec l’idée que l’action sociale ne peut être correctement financée qu’en période faste et qu’elle doit ainsi rester limitée à la hauteur des moyens disponibles. C’est l’inverse ! En période d’expansion économique, il y a moins besoin d’action sociale qu’en période de crise.
Si l’action sociale est simplement vue comme une charge, les associations d’action sociale ne sont pas perçues comme des investissements d’avenir mais comme de simples consommatrices de ressources improductives. Cette tendance remet en cause le principe d’un financement public des associations de solidarité.
2.1.3. La mise en concurrence des opérateurs
Si l’action est réduite à une prestation et l’opérateur perçu comme une charge pour les finances publiques, il faut alors utiliser des mécanismes qui vont permettre de maîtriser le rapport qualité/prix. La logique libérale ne permet pas d’envisager d’autres régulations que celles qui prévalent dans le système marchand. Dans le système commercial, la demande et l’offre s’équilibrent naturellement par le jeu concurrentiel. C’est donc la concurrence qu’il convient d’introduire dans l’action sociale pour améliorer la qualité des prestations tout en réduisant leur coût.
C’est la loi « HPST[1] » qui va généraliser le principe des appels à projet visant à mettre en concurrence les promoteurs d’actions sociales. Ce dispositif complète les normes européennes (paquet Monti-Kroes, directive Bolkenstein, SSIG, SNEIG…) relatives à la concurrence en matière de services.
Le mythe de la libre concurrence, non faussée par l’intervention de l’État, fait florès au plan européen. Appliqué à l’action sociale, il porte l’idée que ce mode de régulation, issu d’une conception simpliste des échanges, peut impunément s’appliquer à la relation d’aide…
Cette logique concurrentielle a des effets importants sur les associations d’action sociale, tant dans leurs rapports entre elles que dans leurs relations avec les autorités publiques. C’est tout le système de régulation du secteur qui est modifié.
2.2. Une société fracturée
La fragmentation des espaces sociaux, si elle n’est pas un phénomène inédit, semble s’exacerber. Ce contexte, marqué par une explosion tant quantitative que qualitative des problématiques sociales, met en exergue les organisations qui interviennent dans leur traitement, tels des révélateurs gênants, et met en débat les conceptions qui circulent quant à l’action publique en ce domaine.
2.2.1. L’explosion quantitative et qualitative des problématiques sociales
Les problématiques sociales connaissent une explosion, essentiellement du fait de la crise économique déjà évoquée. L’insuffisance de ressources liée à la dégradation globale de l’économie a des effets immédiats sur la pauvreté des ménages mais aussi, plus largement, sur tous les publics de l’action sociale : insertion des personnes en situation de handicap, formation des jeunes, migrations, état de bien être de la population, etc.
A cette inflation volumétrique des problèmes s’ajoute un accroissement qualitatif des besoins avec l’émergence de nouvelles questions : les phénomènes de dépendance liés au grand âge – du fait de l’allongement de la vie ; les nouvelles problématiques liées à l’autisme… mais aussi de nouvelles perspectives d’action : scolarisation des enfants handicapés, accessibilité, etc.
Cette massification des questions sociales hypothèque les perspectives d’avenir de la société et investit les dispositifs d’action sociale de la lourde tâche de contenir les phénomènes, de limiter les effets de l’exclusion ou de l’inadaptation. Ainsi, les associations d’action sociale se trouvent convoquées dans l’opinion publique dans un rôle contenant, voire de contrôle.
2.2.2. Les institutions d’action sociale : des révélateurs gênants
De plus, les organisations d’action sociale, sont, par leur existence même, des révélateurs de l’échec d’une société d’intégration et de justice. Elles témoignent de l’effondrement du mythe promotionnel de l’action sociale. En leur sein, les professionnels du travail social sont des témoins de première ligne des fractures qui traversent la société. Ce rôle est ingrat, il est tentant de le minorer. D’ailleurs, le silence des associations sur ce point est éloquent. Elles semblent avoir mis sous le boisseau cette fonction tribunitienne qui devrait les caractériser (Priou, 2007).
A quelles conditions les associations d’action sociale peuvent-elles retrouver leur capacité à porter sur l’espace public les constats et analyses qu’elles tirent de leur action, à alimenter une critique sociale ?
2.2.3. Dans ce contexte : quelle conception de l’action publique ?
Mais ce débat sur le rôle réparateur ou subversif des organisations d’action sociale remet au premier plan le débat, plus fondamental, de la conception du travail social dans l’action publique (Chauvière, 2004). C’est à l’État qu’il incombe d’apporter une visée politique au « travail du social », de tirer de la délibération démocratique une orientation ambitieuse pour l’action sociale, à l’image de ce que fit Nicole Questiaux dans sa circulaire de 1982[2], dont nous avons fêté les 30 ans et qui, à ce jour, ne semble pas avoir pris une ride. Il n’est qu’à en relire les titres :
– Une action sociale pour une nouvelle citoyenneté :
o Des usagers reconnus dans leurs droits…
o … acteur potentiels du changement de leur cadre de vie
o Promouvoir une autre gestion du travail social
– Un statut des travailleurs sociaux par des missions d’action sociale (…)
– Un pluralisme institutionnel
o Repositionner le mouvement associatif et ses rapports avec les pouvoirs publics
o Des collectivités locales pleinement responsables, l’État garant de la solidarité nationale
L’écart ouvert par le temps montre que le débat démocratique sur le traitement que notre République veut réserver à ses membres les plus fragiles, malades, handicapés, exclus, pauvres, âgés ou dépendants, n’est toujours pas réglé.
2.3. Une société rationalisée
Le fond de tableau des mutations de l’action sociale est, pour ce champ d’activité comme pour tous les autres domaines de la vie sociale le grand retour d’un positivisme radical. C’est le fantasme d’une rationalisation possible de l’humain et de toutes ses œuvres qui sourd de partout avec quelques termes significatifs en action sociale comme « satisfaction » ou « performance » et la réduction des acteurs à un simple rôle de prestataire.
2.3.1. La satisfaction ou la prise en compte ?
L’évolution aboutit à « ce statut de fait de client, dévolu progressivement aux bénéficiaires des actions sociales » qui fait dire à Jean-René Loubat (Loubat, 2007), affirmant une vision positive de cette marchandisation, qu’elle met les usagers-clients : « en position de partie contradictoire, soulignant ainsi leurs droits et leurs possibilités de recours, mais également en position de faire jouer la concurrence et de pouvoir choisir leurs prestataires. » (Ibid, p.4). A quoi répond Michel Chauvière : « Le social n’est pas une prestation vendue, ni même rendue, ni même offerte. Ce n’est donc pas un commerce, mai un droit opposable, générateur d’obligations « au service de », et ces services concrétisent ces obligations. » (Chauvière, 2011, p.157)
Les associations d’action sociale sont prises en tension dans cette opposition entre le modèle prestataire et le modèle des droits opposables impliquant aux institutions des obligations de solidarité.
2.3.2. La performance ou l’intérêt général ?
Dans le droit fil de ce conflit, porté par la visée de rationalisation, l’émergence du concept de performance interroge. L’extension des compétences de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP, dont la mission est « d’apporter un appui concret à l’amélioration des organisations de santé ») au champ médico-social atteste de cette tendance lourde. Comment réduire la complexité de l’intervention sociale à cette notion simplificatrice de performance ? Que deviennent alors les fondements de l’action que sont l’utilité sociale et l’intérêt général ?
C’est sur ce point que nous prenions position dans les ASH : « L’action sociale concerne l’existence de personnes et relève du vécu, du bien-être et de la liberté, non de la rentabilité. Son efficience relève de l’utilité sociale. La performance répond à un dessein de maîtrise technocratique sans latitude, à un double processus de rationalisation et de marchandisation, générateur d’inégalités sociales, classification normative des personnes qui conduit à la relégation et l’exclusion d’une partie d’entre elles en fonction de leurs capacités, leur éloignement de l’emploi, leurs ressources ou leur degré de handicap. » (Dubreuil et al., 2011).
2.3.3. Partenaires ou prestataires ?
Finalement, qu’attendent les pouvoirs publics des associations d’action sociale ? La simple gestion des dispositifs de politique sociale qu’ils décident ? La remontée des besoins locaux ? Une participation à l’élaboration des projets ?
La tendance qu’entérine la loi HPST est d’écarter les associations des fonctions traditionnelles des corps intermédiaires – fonction de traduction ascendante et descendante des politiques publiques entre décideurs et habitants-citoyens – en concentrant, notamment dans les mains des seules Agences Régionales de Santé, les fonctions de diagnostic et d’évaluation des besoins, de construction et de planification des réponses, de financement et de contrôle des mises en œuvre et enfin d’évaluation des actions réalisées. L’association, dans ce montage, n’est qu’un simple prestataire, un « offreur de services » à disposition de la puissance publique.
C’est une autre perspective qu’ouvre l’idée de fonction tribunitienne que devraient assumer les associations. « La fonction tribunitienne peut (…) se définir comme l’ensemble des actions visant, d’une part à faire reconnaître par la collectivité certains besoins des individus comme des besoins collectifs ou sociaux et, d’autre part, à faire contribuer la puissance publique à la satisfaction de ces besoins, voire à modifier les décisions de production des grandes firmes capitalistes. » (Priou, 2007, p.238).
3. Quelle action sociale ?
Ces quelques éléments de contexte étant esquissés, il convient d’aller sur le fond des choses en abordant, même succinctement, la question de l’action sociale elle-même : sur quelles conceptions repose-t-elle en matière de solidarité ? Elle est inscrite qu’elle est dans une société plurielle et mobilise des compétences qui révèlent une conception de l’action conduite.
3.1. Une conception de la solidarité ?
L’action sociale repose sur la solidarité de la Nation fixée dès l’article 21 de la constitution du 24 juin 1793 qui déclare : « Les secours publics sont une dette sacrée, la société doit la subsistance aux citoyens malheureux… » Qu’en est-il de ce principe aujourd’hui ?
3.1.1. Equité ou égalité?
Originellement fondée par la Révolution française, « l’idée d’égalité s’est donc rapportée (…) à une qualité du lien social beaucoup plus qu’à la définition d’une norme de distribution de richesses. » (Rosenvallon, 2011, p.73). Mais, avec la révolution industrielle et l’avènement du capitalisme, « la réalisation d’une société des égaux qui s’était liée à une vision précapitaliste de l’économie devait être repensée sur de nouvelles bases. » (Ibid., p.109).
C’est là que sort du bois, symétriquement à l’effondrement du projet égalitaire, le concept d’équité. Pensée par John Rawls selon une visée libérale de l’égalité dans sa « Théorie de la justice » l’équité peut se résumer au principe « chacun selon ses besoins » ce qui justifie un principe d’inégalité. Cette conception sera critiquée par Amartya Sen qui intègre à l’analyse les aptitudes et habiletés des personnes, résultant, au-delà d’une juste répartition des biens, de nombreux facteurs sociaux et humains. « En fait, la critique rawlsienne de la « justice comme équité » du point de vue de la capabilité est en partie née d’un effort pour prendre en compte directement les difficultés – d’origine naturelle ou sociale – que rencontre un individu dans la conversion des « biens premiers » en vraies libertés d’accomplir. » (Sen, 2000, p.241).
Du principe d’équité inspiré du welfare à celui de mérite inspiré du workfare il n’y a qu’un pas qui peut être vite franchi par une responsabilisation outrancière de l’usager, au nom même de ses droits.
3.1.2. Mansuétude ou fraternité ?
Cet aspect nous invite à repenser ce second élément du triptyque républicain : la fraternité. En effet, une pensée néolibérale peut induire la conception d’un usager isolé dans ses droits associée à une conception de l’aide réduite au strict nécessaire par un principe de responsabilité personnelle. Etre bénéficiaire d’une intervention sociale revient ainsi à s’identifier comme ayant été incapable de réussir par soi-même. La solidarité devient stigmatisante et fait perdre à ceux qui en bénéficient la reconnaissance positive de la communauté. « Pour l’individu, l’expérience d’un tel déclassement social va donc de pair avec une perte de l’estime de soi. (…) Ce qui est ici refusé à la personne, c’est l’approbation sociale d’une forme d’autoréalisation à laquelle elle est péniblement parvenue, grâce à l’encouragement reçu à travers les solidarités de groupe » (Honneth, 2010, p.165).
Axel Honneth refonde ce principe de fraternité en lui donnant toute sa dimension de l’inter-reconnaissance entre sujets à partir du triptyque suivant (inspiré des travaux de Mead) : reconnaissance affective (expérience de l’amour) qui ouvre à la confiance en soi ; reconnaissance juridique qui ouvre au respect de soi ; reconnaissance sociale (expérience de la solidarité) qui ouvre à l’estime de soi.
3.1.3. Subordination ou liberté ?
En arrière-plan de ce débat, c’est la reconnaissance du sujet qui est en cause. Bénéficier d’une aide sociale ou médico-sociale, c’est entrer, sous couvert de la solidarité nationale, dans un jeu complexe de don/contre-don théorisé par Marcel Mauss. Le débat récurent sur le terme même « d’usager » est, en ce sens, tout à fait éloquent. Combien de fois entendons-nous dès que ce mot est lâché : « Je n’aime pas ce terme » ? Il est pourtant le seul à lever définitivement l’ambiguïté et les soupçons qui pèsent sur le bénéficiaire des aides de l’État en action sociale. Parce qu’usager fait explicitement référence au concept de rapport d’usage, il ouvre à une dimension systémique de la relation d’aide. « Le temps de l’usage laisse place à une certaine écologie sociale respectueuse de la nature et de la personnalité de ceux qui sont en situation d’aide. Le terme d’usager ouvrirait donc l’ère d’un traitement écologique du social. » (Bourquin, 2000, p.53).
N’est-ce pas cette dimension écologique qui permet d’échapper à la subordination intrinsèque à la relation d’aide ?
3.2. Une conception de la pluralité ?
L’action sociale n’a de sens qu’au sein d’une société plurielle qui laisse ouverts les jeux d’appartenance, les distances entre le centre et la périphérie du système social. Elle met en débat la question des normes tant dans ses modes d’intervention que dans les pratiques de ses acteurs ou l’organisation du dispositif d’action.
3.2.1. Une intervention sociale de plus en plus normative ?
Depuis la publication par Jacques Donzelot en 1977 de « La police des familles » dénonçant la fonction de contrôle social des institutions d’action sociale, la critique ne cesse d’alimenter ce débat.
Le travail social a toujours peiné à assumer sa double vocation de contrôle social et, dans le même mouvement, de transformation de la société. « Double ou entre-deux, gardien de la paix sociale et producteur d’émancipation démocratique, le social est par construction comme un non-lieu, lieu à la place d’un autre. (…) Et c’est d’occuper ce non-lieu qu’il est terriblement efficace. » (Autès, 1999, p.281).
Cependant, la tendance est forte de contenir la production d’action sociale dans des référentiels, des cadres prédéfinis, des modalités procédurales fermées ce qui menace de transformer l’aventure de la rencontre humaine, qui est au cœur de la clinique du social, en une assistance fermée sur elle-même au lieu d’être une coopération ouverte sur d’autres possibles.
3.2.2. Des pratiques professionnelles de plus en plus uniformisées ?
A l’avenant du risque normatif, les pratiques professionnelles font l’objet de définitions de plus en plus pointues, au risque de les enfermer dans des conduites étriquées qui ne laissent plus aucune marge d’initiative aux professionnels qui d’acteurs, deviendraient agents (Janvier, 2009).
La publication par l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité Sociale et Médico-sociale (ANESM) de recommandations de bonnes pratiques professionnelles illustre cette tendance. Même si les acteurs de ces productions tentent d’en limiter l’aspect normatif, voire de le contrecarrer : « Si nous réfutons une vision normative conduisant à des « standards de bonne pratique », il faut appréhender cette notion de façon relative, plus sur le mode de la diffusion de pratiques jugées pertinentes à un moment donné tout en les soumettant en permanence à l’expérimentation et à la critique. » (Savignat, 2009, p.300). La position de Pierre savignat, membre du conseil scientifique de l’ANESM, montre bien l’existence d’un risque d’uniformisation.
3.2.3. Des organisations d’action sociale de plus en plus standardisées ?
Conséquence logique de ce qui précède, les établissements et services sociaux et médico-sociaux s’inscrivent également dans un mouvement de standardisation de leurs pratiques, de leur organisation, voire de leurs projets.
Ce sont là les effets conjugués de plusieurs éléments :
· La convergence tarifaire inscrite depuis la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale (coûts cibles, prix à la place, ratios standards, etc.).
· La standardisation introduite par les cahiers des charges des appels à projet (ou appels d’offre dans le cas de marchés publics) qui uniformise les formes de réponses, les formulations des projets.
· L’évaluation interne et externe des activités et de la qualité des prestations qui, notamment par le biais des référentiels utilisés, conforme une certaine unicité des regards.
· Les modes selon lesquelles s’expriment les projets d’établissement ou de service (langage politiquement correct, mots ou expressions standards, modélisation des références théoriques, etc.).
3.3. Une conception de la compétence ?
Les mutations profondes que connaît l’action sociale impactent les postures : celle des professionnels d’abord mais aussi celles des usagers. C’est le processus de professionnalisation qui est mis en cause au moment où s’articulent à nouveaux frais les enjeux de compétences entre les intervenants et les usagers alors que la toile de fond de ces tensions reste l’hégémonie technocratique.
3.3.1. La professionnalisation au prix de la prise de pouvoir sur la vie des gens
L’histoire du travail social s’est construite sur la professionnalisation des acteurs (Dubreuil, 2009). Ce processus, qui a placé au cœur de toutes les organisations des formes de régulations professionnelles en lieu et place des régulations militantes qui leur avaient donné naissance, a eu pour effet d’éloigner les usagers des lieux de décision les concernant.
Ce serait donc au prix de la prise de pouvoir des travailleurs sociaux sur la vie des gens que le champ de l’action sociale s’est développé. Cette confiscation du pouvoir d’agir des usagers a eu pour effet de priver les personnes accompagnées de la reconnaissance de leurs compétences. Ce n’est donc pas par l’action sociale, censée œuvrer à leur promotion sociale, que les usagers ont investi l’espace public de délibération. Pour agir sur leur vie, ils ont constitué des groupements de pression autonomes, essentiellement dans le champ de la santé. C’est ce genre d’association qui, « transformant un pâtir en agir, une souffrance en mobilisation, et procédant à un véritable renversement du stigmate, illustre assez bien un mouvement plus général : l’avènement dans l’espace public de ceux considérés comme incapables de se prendre en charge. » (Ion, 2012, p.38).
3.3.2. Le conflit entre savoir savant et savoir de l’expérience
Le conflit des compétences est désormais ouvert (Janvier, Matho, 2011). Le mouvement ATD-Quart Monde a considérablement fait évoluer ce conflit au travers de deux programmes de recherche-action – le croisement des savoirs et le croisement des pouvoirs – qui associent des militants issus de la grande pauvreté avec, dans le premier programme, des universitaires, et dans le second, avec des travailleurs sociaux. Les acteurs de ces programmes témoignent d’une complémentarité indispensable entre deux types de savoirs : « D’une part un savoir d’expérience (savoir non reconnu), qui constitue la pensée et le « jardin secret » des personnes parmi les plus pauvres, qui en sont donc les seules détentrices, savoir qui nécessite cependant un travail d’élaboration et de structuration pour devenir communicable et pouvoir ainsi être compris du reste de la société ; Et d’autre part, un savoir d’école, universitaire (savoir commun), plus théorique et général sur le plan de la connaissance et plus structuré sur le plan de la méthodologie, mais ignorant du vécu et donc de la réalité profonde et souvent cachée de la grande pauvreté. » (ATD-Quart Monde, 2008, p.138).
3.3.3. L’hégémonie technocratique
Si les conflits de compétences, très liés à la réhabilitation de la parole des usagers, tend à rééquilibrer les rapports de pouvoir au sein des organisations de l’action sociale, le fond de tableau reste inchangé. La tendance technocratique s’est même peut être renforcée ces dernières années sous les effets provoqués, notamment, par la loi HPST. Les instances de consultation associent désormais pleinement les usagers qui sont consultés, associés, mobilisés sur les schémas d’organisation, les programmes locaux et régionaux, les choix stratégiques à opérer. La représentation des usagers est majoritaire dans la plupart des instances : Conférences Régionales de Santé, conférences de territoire, conseils consultatifs départementaux (personnes âgées, personnes handicapées), commissions de sélection des appels à projet, etc.
Cette omniprésence des usagers, cette référence constante à leur place qui légitime les politiques publiques, ne doit pas nous tromper. Le risque d’instrumentalisation des usagers est lui aussi réel. Leur parole n’est-elle pas utilisée pour justifier des options qui les dépassent, dont leurs organisations ou leurs représentants ne comprennent pas toujours les enjeux ?
4. Repenser les organisations associatives d’action sociale
Dans ce contexte, décrit dans les lignes qui précèdent, il est urgent de repenser les formes d’organisations associatives d’action sociale qui, d’une part ouvriront des alternatives aux tendances actuelles qui mettent à mal l’avenir de l’action sociale, et qui, d’autre part, les mettent en disposition de répondre aux défis sociétaux qui se posent à l’action sociale.
Il semble urgent de modéliser une théorie de l’organisation, conçue à partir des références associatives et des valeurs du travail social, qui prenne le contre-pied de la pensée dominante : néolibérale, centralisatrice, technocratique, rationnalisante, instrumentalisante.
4.1. Concevoir des institutions du seuil
Les « institutions du seuil » seraient une manière de penser autrement que sur le modèle égocentré des organisations exclusivement axées sur leur développement par la captation de nouveaux marchés et leur survie par grossissement.
Pour prendre le contrepied des tendances à la rationalisation, à la performance, à l’analyse par les masses critiques, à la prédation ou à la concurrence, il faudrait concevoir une institution qui repose sur une organisation en réseau fondée sur les échanges, centrée sur les territoires, solidaire des habitants. Nous allons ainsi nous intéresser aux notions de seuil, de périphérie, de polycentrisme, de polyarchie, et de polyvalence, vocabulaire essentiellement emprunté à Edgard Morin et aux théories de la pensée complexe (Morin, 2008).
4.1.1. Une conception liminale de l’organisation
Les institutions autocentrées, autosuffisantes, hyperspécialisées et hypertrophiées nous sont présentées, comme les formes les plus aptes à répondre aux défis de ce temps. Elles sont directement copiées du modèle industriel. Ce sont en fait des colosses aux pieds d’argile. Elles peinent à s’adapter à la finesse des enjeux que nous venons d’analyser et qui se posent aujourd’hui à l’action sociale. Comme les dinosaures en leur temps, elles risquent d’être incapables de survivre dans ce nouveau milieu de vie qui suppose d’aller voir au cœur des réalités locales, au plus près des besoins des personnes dans une démarche de solidarité avec les habitants des territoires, en interaction intense avec les autres acteurs du développement social et dans un rapport renouvelé, partenarial, avec les autorités publiques. C’est en ce sens que l’institution du seuil est une ouverture stratégique.
L’organisation autocentrée se pense en relative autonomie par rapport à son milieu, à partir de son centre qui fonde exclusivement sa légitimité. Inversement, l’organisation liminale se conçoit comme un élément d’un ensemble, interdépendante du système qui la porte.
Dans l’organisation autocentrée, plus un élément est éloigné du centre du système moins il y est identifié, plus son appartenance est relative et plus il se trouve fragilisé. Dans l’organisation liminale, ce n’est pas la distance centre/périphérie (proximité/distance) qui importe mais la qualité des liens et des interconnexions, leur diversité et leur multiplication. Finalement, la structure est envisagée par sa disparité plutôt que son uniformité (qui est l’apanage des organisations autocentrées). Le sens de l’action s’appuie sur la complexité plutôt que sur une réduction simplificatrice de la réalité.
La différence fondamentale entre une organisation autocentrée et une organisation liminale réside dans la localisation du centre de gravité institutionnel :
· Pour les premières il est en son centre au détriment de sa périphérie (de ce qui s’échange avec le milieu) ;
· Pour les secondes, il est en dehors d’elle, sur le territoire, là où sont les habitants, selon le principe du bien commun qui transcende ses intérêts propres.
Dans le premier cas moins il y a de « l’autre » plus l’organisation s’affermit. Dans le second cas, c’est l’existence des « autres » qui est la condition de vitalité de l’organisation.
Les entreprises d’action sociale ne travaillent pas pour elles mais au service de publics, en réponse à des besoins sociaux. En ce sens, les institutions du seuil paraissent plus congruentes avec les missions d’action sociale. A contrario, les organisations autocentrées doivent gérer cette incongruité de poursuivre une mission d’intérêt collectif et d’utilité sociale tout en restant centrées sur leurs intérêts propres…
Qu’en est-il du rapport à l’environnement de ces deux formes d’organisation : égocentrées ou liminales ?
Si l’environnement n’est vu que comme le moyen d’alimenter l’organisation, notamment en le considérant comme un marché, toute demande d’échange réciproque, toute interaction risque d’être perçue comme une menace d’appauvrissement. A l’inverse, si l’environnement est conçu comme un espace d’échanges, ce qui va « compter » pour l’organisation liminale, ce n’est pas exclusivement ce qui « rentre » (et que l’organisation autocentrée va vouloir stocker, thésauriser) c’est ce qui « s’échange ». Ce qui compte, ce n’est pas le volume des stocks mais la quantité, la qualité et la diversité des flux entrants et sortants.
4.1.2. C’est la périphérie qui fait centre
Un système égocentré est une organisation du « milieu » : ce qui le définit, c’est son centre, sa délimitation entre le « dedans » et le « dehors », sa différenciation d’avec son environnement. Inversement, l’organisation liminale se définit par sa périphérie, par ce qui se passe dans les zones d’échange avec l’environnement. Les « bords » de l’organisation n’intéressent pas en premier lieu parce qu’ils dessinent une frontière mais parce qu’ils sont les espaces les plus denses d’interactions. Ce n’est pas la différenciation avec son contexte qui compte mais sa capacité à entretenir et développer la porosité de son enveloppe.
Il y a une homologie des organisations liminales avec l’essence même de l’action sociale. Le travail sur le social porte sur les « bords » de l’espace social. Les personnes auxquelles il s’adresse sont au seuil de la société. L’action sociale ne porte pas sur ce qui est socialisé (ce qui se passe « au milieu » de la vie sociale) mais sur des objets, des personnes ou des lieux problématiques, souffrant d’un déficit de socialité. Cette homologie entre travail au seuil du social et organisation liminale permet d’affirmer que c’est le seuil qui fait sens.
L’organisation liminale concentre son attention sur les flux qui la traversent et qu’elle traite ou qu’elle restitue à son environnement, qu’elle métabolise pour en faire des énergies structurantes du lien social, contribuant ainsi à une démarche de changement social.
4.2. Concevoir des organisations polyvalentes
4.2.1. Une organisation polycentrique
L’organisation liminale repose sur une conception complexe des formes organisationnelles : La modélisation introduite par la pensée complexe (Morin, 1990) nous fait entrevoir qu’il ne peut y avoir un seul centre aux organisations. L’organisation liminale est donc nécessairement pluri-nodale. Elle reconnaît en son sein l’existence de structures dissipatives qui subvertissent toute tentative de construction d’un schéma unifiant du système. Pour être unifiant, un tel schéma doit nécessairement réduire au minimum, voire faire l’impasse, sur les rapports de forces, les dérivations, les incohérences, les discontinuités, inhérents à toute organisation. A l’inverse, dans l’organisation autocentrée, ces dimensions perturbatrices seront perçues comme des obstacles à la cohérence.
L’institution égocentrée se pense comme un bloc, l’institution du seuil se pense comme un tissu.
L’intérêt du projet de l’organisation liminale c’est de pouvoir intégrer les résistances, les conflits, les points faibles, les déviances, les désordres, les dispersions d’énergies, les ruptures comme des éléments constituants de toute organisation humaine. Cette capacité à intégrer la diversité comme fondement de l’organisation suppose que soit fait le deuil du modèle idéal. C’est en se dédouanant de l’idée qu’une forme organisationnelle parfaite existerait et qu’il suffirait de la découvrir pour régler tous les problèmes que nous pouvons accéder à la pensée complexe qui fonde l’organisation liminale. C’est avec l’imperfection de nos formes humaines organisées que nous devons composer. C’est l’imparfait qui est notre matériel disponible pour bâtir une structure fonctionnelle. Les organisations de l’action sociale ne travaillent-elles pas tous les jours avec l’imparfait des situations humaines et sociales qu’elles accompagnent ?
Cela nous amène à interroger les schémas de fonctionnement classiques, plutôt attachés à l’organisation autocentrée, uniquement hiérarchiques et descendants. Il s’agit ici de penser une vision complexe des échanges faite d’actions, d’interactions, de rétroactions, de circularités, de flux descendants, ascendants et transversaux, de tourbillons. Concrètement, il faut penser une nouvelle articulation de la verticalité et de la transversalité qui tend à réduire l’hégémonie de la seule logique hiérarchique. L’organisation liminale ne peut concevoir une circulation à sens unique des flux qui l’organisent.
L’organisation liminale se définit par sa capacité à assembler des éléments diversifiés jouissant, entre eux, d’une certaine autonomie. Chaque élément constituant un « petit centre » à lui seul, participant au polycentrisme du système global. L’image qui vient alors à l’esprit est celle du consortium. Le consortium n’est pas une holding où c’est le capital qui unifie les éléments composites du système en les soumettant à une logique financière centrale. Le consortium ne repose pas d’abord sur une capitalisation unifiée mais sur la poursuite d’un projet commun[3].
4.2.2. Un système polyarchique
Une des conséquences de cette représentation particulière de l’organisation associative d’action sociale concerne les conceptions du lien hiérarchique (Janvier, 2012). Dans l’entreprise autocentrée, la densité du contrôle des acteurs est inversement proportionnelle à la distance qui sépare du centre. C’est une des raisons pour lesquelles les très grosses organisations tendent à développer une hypertrophie du contrôle (procédures pléthoriques, reporting quasi quotidien, audits fréquents diligentés par le siège, etc.) provoquant parfois l’embolie des fonctions productives.
L’organisation liminale est obligée de concevoir un fonctionnement hiérarchique beaucoup plus souple. La densité du contrôle qui y est opéré ne repose pas sur la multiplication des moyens de maîtrise et de sécurisation des procès. La densité de la fonction de contrôle repose sur la densité du niveau de responsabilité de chaque acteur. Ce principe développe un système multiforme fait d’autocontrôle, de contrôle croisé, de contrôle collectif. Bien entendu, il n’évacue pas le contrôle hiérarchique mais celui-ci devient un élément de contrôle parmi d’autres.
Le principe de responsabilité se trouve ainsi étendu. Il se développe à travers la notion de coresponsabilité qui induit que la responsabilité ne repose pas sur un seul mais s’engage dans une dimension collective, ouvrant une voie nouvelle dans la manière d’exercer les fonctions dirigeantes et de penser la gouvernance des organisations : la possibilité de porter une responsabilité partagée et collective que nous pouvons nommer : collégialité. La collégialité repose sur une clarification et une différenciation des places et des rôles. L’idée d’un portage plus collectif des responsabilités ne dédouane pas l’organisation de préciser les fonctions pour mieux les articuler, garantir leur différenciation et leurs complémentarités.
C’est sur les processus décisionnels que la collégialité apporte une différence notable avec les systèmes hiérarchiques autocentrés. Elle se fonde sur les grands principes de l’éthique de la discussion dont nous retiendrons pour faire simple que chacun se trouve personnellement engagé dans le processus de délibération auquel il participe. Engagé veut dire qu’il y parle de lui, de son point de vue, de sa place et qu’il s’apprête à assumer toutes les conséquences de la décision qui sortira des débats, même – et surtout – si cette décision ne correspond pas exactement à ce qu’il aurait souhaité (Janvier, 2011). La collégialité impose au sujet cette solidarité avec l’acte collectif dont il est partie prenante. La collégialité impose également la différenciation. C’est la différenciation qui articule les éléments du système. Cela vaut pour les organisations qui s’enrichissent de leurs différences dans le milieu local où elles sont insérées. Cela vaut aussi pour les personnes qui s’alimentent de leurs spécificités reconnues et valorisées par l’organisation afin de produire une vision enrichie de celle-ci et de ses orientations.
Toute différenciation suppose d’assumer la nécessaire conflictualité qu’elle génère. Les dissensions naissant des différences de positions, d’avis, de points de vue, de rôles ou de fonctions sont inévitables. Les nier alimente un système autoritaire où les plus forts – les dominants – prennent le pouvoir sur les autres. C’est souvent à ce prix que se dégagent des consensus dans les organisations. L’organisation autocentrée est particulièrement exposée à ce risque. Assumer ces dissensions comme éléments constitutifs de la construction institutionnelle nourrit un système réticulaire dans lequel les interactions et tensions sont vécues comme des ressources. La conflictualité assumée est une stratégie qui consiste à rechercher la transformation des blocages en contributions constructives. La pluralité n’est alors pas une menace à l’ordre nécessaire mais une condition de cet ordre qui est le résultat d’un rapport complexe entre ordre et désordre, forces structurantes et déstructurantes, logique de vie et de mort, fermeture et ouverture des frontières organisationnelles. La pluralité est la condition vitale de l’existence et du développement de l’organisation liminale, la conflictualité son carburant.
4.2.3. Des dispositifs polyspécialisés
Fortement articulée à son milieu, l’organisation liminale vit comme évident le fait que les compétences collectives intègrent toutes les compétences à l’œuvre, au-delà du seul cercle des professionnels. Il s’agit en tout premier lieu de celles des usagers, bénéficiant des actions de l’organisation, mais aussi de celles des habitants, des décideurs locaux, des acteurs du territoire. Du fait que les notions d’intérieur et d’extérieur de l’organisation ne sont pas délimitées par des frontières fixes et hermétiques mais par des espaces souples de porosité qui facilitent les échanges, la notion d’appartenance reste ouverte et permet de mobiliser largement les compétences internes et externes, voire celles d’autres organisations liminales avec lesquelles l’institution est reliée sur le territoire.
C’est un véritable enrichissement pour l’organisation que de penser les compétences dans un système de liens ouverts. Cela protège de la tendance au grossissement des organisations autocentrées qui estiment nécessaire de posséder en leur sein toutes les compétences requises pour mener à bien leur projet. Le contexte actuel montre bien la difficulté à internaliser toutes les fonctions. Il n’est qu’à voir les niveaux d’expertise requis en matière de gestion des ressources humaines, de prospective et d’ingénierie financière, de passation de marchés, de vigilance législative, de maîtrise des risques, de veille scientifique, etc. Et c’est sans parler des besoins nouveaux qui émergent pour suivre les appels à projet, constituer les dossiers de réponse aux appels d’offre, de benchmarking (surveillance des meilleurs pratiques des concurrents), etc.
L’organisation de type liminal n’a pas forcément besoin de posséder elle-même toutes les compétences. C’est par le réseau dans lequel elle s’inscrit qu’elle va trouver les ressources nécessaires à son fonctionnement. Il s’agit alors de bâtir des systèmes collectifs de compétences partagées qui permettent de mieux utiliser les expertises locales en les mettant à la disposition de tous. Ce n’est pas une fuite des cerveaux, la mise à disposition de compétences à d’autres organisations crée un jeu stimulant d’échanges, de don/contre-don.
Il n’est pas dit que l’identité des organisations n’a plus d’importance et que le modèle liminal autorise une dilution de chaque entité dans un ensemble confus de « machins » dont la seule raison d’être serait de rouler pour des intérêts qui ne les concernent pas, ou au moins qui leurs sont extérieurs. La mise en synergie d’organisations liminales sur le territoire suppose au contraire que chaque entité existe, soit identifiée et définisse clairement ses articulations avec les autres entités intervenant localement, c’est-à-dire, redisons le, qu’elle lie son destin à celui du territoire et de ses acteurs.
L’organisation autocentrée tend à évoluer naturellement vers la spécialisation. Sa cohérence centrale reposant sur un principe d’unification, son tropisme sera de se développer en constituant une expertise pointue sur un domaine d’activité précis ou quelques domaines connexes afin d’affermir sa position sur un segment de marché et de jouer son développement par l’agrandissement de sa zone de chalandise. Ce destin d’hyperspécialisation constitue une fragilité dans un marché mouvant et incertain. Par exemple, que deviendront les organisations spécialisées dans la prise en charge de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer si les progrès scientifiques trouvent un remède à cette pathologie ?
Inversement, les organisations liminales sont, par nature, polyspécialisées. Leur communauté de destin avec le territoire où elles se développent les amène à répondre aux besoins sociaux qui y émergent. Leur raison d’être n’est pas la spécialisation mais la polyvalence. Une conception essentielle du lien social sous-tend cette posture : les problèmes sociaux ne peuvent être isolés les uns des autres, ils font système. C’est la combinaison des dimensions économiques, sociologiques, historiques, culturelles, géographiques et démographiques qui fait le territoire, lui confère son identité. Vouloir traiter en les dissociant les questions d’emploi et d’insertion, de lutte contre les exclusions et de protection des publics fragiles, de traitement des situations de handicap et d’accompagnement des personnes qui les vivent, de prise en charge du grand âge et de la dépendance, etc. n’est pas réaliste. Cette démarche aboutit à réifier des publics, à découper des problématiques, à rompre des liens à menacer la continuité des accompagnements et à briser finalement les cohérences territoriales.
L’organisation liminale, soit seule soit à travers le réseau d’organisations de même type avec lesquelles elle agit en interdépendance, embrasse l’ensemble des problématiques sociales qui marquent la réalité territoriale. Elle les relie pour les problématiser selon une perspective systémique qui agit sur et par les interdépendances.
Contrairement à une idée reçue, la polyspécialisation ne s’oppose pas à un haut niveau d’expertise. C’est peut-être même l’inverse. L’hyperspécialisation, en matière de questions de société, représente un assèchement de la problématique. En ce centrant sur un seul aspect, l’hyperspécialiste élimine les autres dimensions susceptibles d’impacter l’analyse des causes, des leviers d’action et des effets produits.
5. Conclusion : un essai de construction alternative
Cinq associations bretonnes[4] ont constitué un groupement d’économie sociale nommé « Solida’Cité » qui se veut être une réponse alternative aux modèles dominants, une sorte d’institution du seuil.
Leur projet est avant tout politique, manifesté dans un texte fondateur qui dénonce la banalisation des associations par la concurrence et leur instrumentalisation par les pouvoirs publics : « Ces évolutions compromettent leur capacité de co-construction de l’action publique, leur capacité à repérer les nouvelles attentes sociales et à faire émerger des réponses adaptées assurant le maintien de la cohésion sociale.[5] » Critiquant la réduction du travail social par la déréglementation et l’introduction dans l’action sociale de sociétés de capitaux mais aussi par l’instrumentalisation des associations, elles refusent que la personne soit exclusivement renvoyée à la figure du consommateur, conduisant à la déresponsabilisation du citoyen. Cela revient à dépolitiser la question sociale alors que celle-ci doit rester de préoccupation citoyenne. Les associations engagées ensembles analysent le délitement des solidarités non-monétaires comme un appauvrissement du lien social ouvrant l’espace public d’action sociale au « social business » au détriment d’une ambition de transformation sociale.
« Ces modèles restent très peu adaptés à l’innovation, à la co-construction de réponses sur un mode partenarial entre pouvoirs publics et associations, à la prise en compte des attentes et besoins sociaux émergents, car basés soit sur le principe de la reproduction des réponses déjà connues, soit sur la solvabilisation des demandes.[6] »
Sur la base de ces options communes, elles partagent un diagnostic de leurs atouts et de leurs limites. Elles se réfèrent à l’économie sociale et solidaire, fondée sur des sociétés de personnes qui constituent un modèle alternatif d’entreprise entre le tout État et le tout capital, ce qui impose des conditions de gouvernance « non respectées aujourd’hui dans beaucoup d’organisations en action sociale et qui ont mené à leur disqualification. » Le projet de Solida’Cité réarticule les usagers qui sont acteurs de leurs projets, les professionnels qui sont en recherche de nouvelles alliances et les bénévoles, adhérents, administrateurs qui souhaitent réaffirmer leur place dans les sociétés de personnes.
Les cinq associations définissent un projet politique et social partagé qui s’appuie sur l’affirmation que « l’action sociale relève d’une dimension politique autant que d’une seule dimension technique de mise en œuvre de services. » Celle-ci convoque une conception du vivre ensemble qui suppose l’intégration de tous sur un territoire où la relation d’entraide, d’engagement citoyen, côtoie la relation de service. « Or, nous considérons que, s’il est un domaine dans lequel la dimension civique, l’exercice citoyen, doit trouver sa place c’est bien celui de l’action sociale. »
Le texte d’orientation de Solida’Cité conclut :
« Les organisations signataires de cet engagement sont entreprises associatives :
· Elles développent des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la région Bretagne.
· Elles entreprennent par la collaboration avec les collectivités locales, l’État français et l’Union européenne.
· Elles participent de l’économie des services. A but non lucratif, elles sont un acteur de l’économie sociale et solidaire.
· Elles enrichissent leurs actions, et optimisent leurs moyens par la construction collective entre elles et notamment au sein d’une organisation commune dénommée « SolidaCité ».
· Elles organisent leurs développements au sein de SolidaCité, afin que ceux-ci génèrent non concurrence, complémentarité et cohérence territoriale. »
Roland JANVIER
Bibliographie
ATD-Quart Monde, FERRAND Claude (sous la direction de), Le croisement des pouvoirs, croiser les savoirs en formation, recherche, action. Editions de l’Atelier, Editions Quart-Monde, 2008.
AUTES Michel, Les paradoxes du travail social, Dunod, 1999.
BOURQUIN Guillaume, Le travail social et la dimension d’usage, in HUMBERT Chantal (dir.) Les usagers de l’action social, sujet, client ou bénéficiaires ?, L’Harmattan, 2000.
CHAUVIERE Michel, Le travail social dans l’action publique, sociologie d’une qualification controversée. Paris, Dunod, 2004.
CHAUVIERE, Michel, Trop de gestion tue le social, essai sur une discrète chalandisation, La découverte, 2007.
CHAUVIERE Michel, L’intelligence sociale en danger. La découverte, Paris, 2011.
DUBREUIL Bertrand, JANVIER Roland, PRIOU Johan et SAVIGNAT Pierre, Repolitiser l’action sociale, ASH n°2737, 16/12/2011.
DUBREUIL Bertrand, Le professionnalisme en action sociale et médico-sociale, Des savoir-faire à reconnaître et affirmer, Dunod, 2009.
HONNETH Axel, La lutte pour la reconnaissance, Le Cerf, 2010.
ION Jacques, S’engager dans une société d’individus, Armand Colin, 2012.
JANVIER Roland, La fonction de direction dans les institutions sociales et médico-sociales, L’Harmattan, 2012.
JANVIER Roland, Ethique de direction en institution sociale et médico-sociale, ESF, 2011.
JANVIER Roland, MATHO Yves, Comprendre la participation des usagers dans les organisations sociales et médico-sociales, Dunod, 2011 ?
JANVIER Roland, Conduire l’amélioration de la qualité dans les oranisations sociales et médico-sociales, communiquer, manager, organiser, agir, Dunod, 2009.
KARSZ Saül, Pourquoi le travail social ? Dunod 2ème édition, 2011.
LAVILLE Jean-Louis, Politique de l’association, Le Seuil, 2010.
LOUBAT Jean-René, Promouvoir la relation de service en action sociale et médico-sociale, Paris, Dunod, 2007.
MORIN Edgar, La méthode (tomes 1 à 6), Editions du Seuil –opus, 2008 (réédition groupée).
MORIN Edgar, Introduction à la pensée complexe, Le Seuil, 1990.
PRIOU Johan, Les nouveaux enjeux des politiques d’action sociale et médico-sociale, projet de vie et participation sociale. Paris, Dunod, 2007.
ROSENVALLON Pierre, La société des égaux, Le Seuil, 2011.
SAVIGNAT Pierre. L’action sociale a-t-elle encore un avenir ? Dunod, 2012.
SAVIGNAT Pierre, Evaluer les établissements et les services sociaux et médico-sociaux, Paris, Dunod, 2009
SEN Amartya, Repenser l’inégalité, Le Seuil, 2000.
[1] Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST »
[2] Circulaire du 28 mai 1982, « Orientations principales pour le travail social », Nicole Questiaux, ministre de la solidarité nationale.
[3] Définition Larousse : « association d’entreprises constituée dans le but de réaliser un projet commun »
[4] L’association départementale des sauvegarde de l’enfance à l’adolescence du Finistère, la Sauvegarde du Morbihan, l’association Kan Ar Mor, l’association Don Bosco, la Fondation Massé Trévidy.
[5] Texte fondateur de Solida’Cité, mai 2011.
[6] Ibid.
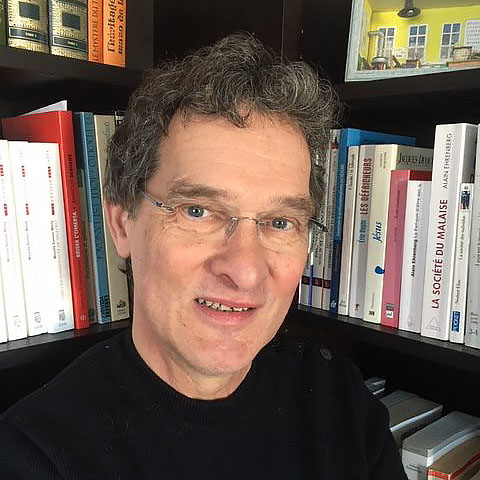
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.


