INTRODUCTION :
« Les droits et devoirs des personnes, plus que des usagers, évoluent dans les faits et les représentations. Quelles que soient les raisons de cette évolution, l’AEMO ne peut se soustraire à une mise en discussion des actes posés, d’une philosophie de l’intervention qu’elle propose, des figures qui l’agissent, en écho aux interrogations et propositions du social. »[1]
Il m’est offert d’introduire vos travaux en situant le travail social dans le contexte créé par l’émergence de droits nouveaux pour les bénéficiaires de l’action sociale. La question n’est plus de discuter sur le bien fondé des droits des usagers mais de savoir comment les mettre en œuvre. La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, n’ouvre pas une controverse, elle clôt toute hésitation et met un terme aux états d’âme des professionnels. La question n’est pas de savoir s’il faut plus ou moins de droit, l’actualité nous met en demeure de clarifier notre rapport au droit, sinon, des rendez-vous avec l’histoire du travail social se prendront sans nous !
Avec Yves MATHO[2], nous introduisons notre recherche sur le droit des usagers en déclinant trois types de rapport au droit[3] :
- Respecter la règle ;
- Utiliser le droit comme levier de changement ;
- Faire société ensemble.
Ces trois niveaux de rapport au droit ne s’excluent pas les uns les autres. Ils sont plutôt comme des poupées gigognes. Autrement dit, ces trois niveaux s’empilent les uns les autres pour passer d’une simple position gestionnaire d’application des règles à des perspectives de changement puis, troisième étage de la fusée, à des perspectives sociétales et politiques. Je propose de reprendre cette déclinaison pour discerner les enjeux qui se présentent à nos organisations.
ETRE EN REGLE :
Une évidence indiscutable qui cache des risques de dérive :
C’est tout d’abord une « évidence » indiscutable. Chacun de nous, chacun de nos services, se doit d’être en règle, c’est-à-dire en conformité avec la législation en vigueur. C’est là une posture légaliste qui n’a pas toujours été très forte dans le monde de l’éducation spécialisée. Les débats post-soixante-huitards ont vécu, plus personne aujourd’hui ne discute le fait que la loi est faite pour être appliquée. Une fois passé ce premier aspect de l’évidence, prenons tout de même le temps de voir les risques de dérives qui peuvent apparaître. J’en vois deux : Le risque, pour défendre des positions acquises, de dénier le droit ; Le risque d’une dérive fondamentaliste.
La « toute puissance » par le déni du droit :
Le droit des usagers, c’est bon pour les autres ! Combien de fois ne sommes-nous tentés de justifier un régime d’exception qui nous permette de déroger à nos obligations légales. Souvenons-nous des arguments avancés, à l’époque, pour démontrer l’impossibilité d’instaurer un conseil d’établissement tel que l’avait prévu le décret de 91. Les responsables d’établissement étaient tous d’accord pour dire que c’était sans doute un bon moyen d’entendre l’avis des usagers mais qu’il ne leur était pas possible de le faire du fait du public accueilli, des rythmes d’accueil, des problématiques pathologiques, de cohabitations inenvisageables, du projet de service, voire même de la mission confiée. Plus des deux tiers des responsables d’établissements ont tenu ce raisonnement puisque seuls environ trente pour cents des établissements étaient dotés d’un conseil d’établissement.
Un autre argument avancé dans le même sens est de dire que notre travail est trop « subtil » pour se laisser altérer par un rapport contraignant aux règles… Ce qui est une façon de déclarer une sorte de hiérarchie qui place les méthodologies d’intervention sociale comme une valeur supérieure à toute autre, y compris aux valeurs républicaines de justice ! Nous ne sommes pas très éloignés des vieux clivages du passé qui ouvrent un fossé entre les approches, transformant ainsi l’usager en un saucisson découpé en tranches : quand il est dans nos services, l’usager est bénéficiaire, c’est-à-dire soumis à la seule logique de nos techniques professionnelles, quand il est dans l’isoloir il est citoyen, s’il a la chance d’occuper un emploi, il est travailleur, il peut être parfois reconnu comme parent…
Cette forme de déni du droit a quelque chose à voir avec la toute puissance qui anime parfois nos institutions, nos équipes, nos pensées…
La dérive « fondamentaliste » :
Le fondamentalisme est cette tendance à se fixer au sens littéral d’un texte. Il existe, à mes yeux, un fondamentalisme juridique qui transforme le droit en une modélisation relationnelle, la loi en dogme. Le droit ne recouvre pas l’ensemble du champ relationnel pas plus que la loi ne balise l’ensemble des rapports humains. Cette dérive du recours systématique au droit évoque des procédures judiciarisées à outrance alors qu’elles pourraient relever d’autres formes de négociation, voire de contractualisation amiable.
Mais il y a une autre dimension à cette dérive qui consiste à « juridiciser » les choses, c’est-à-dire à tout placer sous le regard normatif du droit. Le droit n’est plus alors cette façon particulière et incomplète de définir un projet de « vivre ensemble », toujours en mouvement et en interprétation, il est une matrice garantissant la conformité des comportements à la norme imposée. La loi, qui devient ainsi un texte quasi-sacré, est inquisitrice et dictatoriale, toujours indiscutable, jamais interprétable. Ce fondamentalisme là nous éloigne considérablement des intuitions démocratiques des révolutionnaires français qui déclaraient : « La loi est l’expression de la volonté générale. »
Ces perspectives pessimistes d’un rapport au droit qui nous limiteraient à être « bêtement » en règle comportent le risque majeur de nous placer, nous travailleurs sociaux, dans une position d’exécutants face à des textes pris au pied de la lettre par des autorités dites « de tutelle ». Prendre le texte à la lettre, c’est lui ôter tout esprit ! Par le même mouvement, c’est interdire la pensée. Pourtant, nous avons pu mesurer combien il est fécond de travailler en équipe sur la philosophie d’un texte, d’en comprendre la portée et les limites, les intuitions et les perspectives afin que sa mise en œuvre prenne tout son sens et soit signifiante pour l’action.
Une vision étriquée qui a un effet réducteur pour l’action sociale :
Si les professionnels sont placés dans le simple rôle d’exécutants, il en est de même pour les établissement et services où ils interviennent. Un rapport trop contraint au droit a immédiatement un effet réducteur pour les institutions d’action sociale.
Nous en voyons les pièges avec la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale qui n’est pas exempte des dérives que je viens d’évoquer. Dans le contexte créé pour les établissements et services qui seront limités par des enveloppes budgétaires fermées et des schémas d’organisation imposant uniquement des contraintes descendantes, qui seront également enfermés dans des procédures d’évaluation-contrôle conditionnant l’autorisation de fonctionnement, le rapport au droit se fait contrainte. Ce rapport contraint instrumentalise l’action, ses acteurs et les organisations qui la servent.
Cette vision étriquée du rapport au droit est empreinte d’une vision libérale des rapports sociaux qui aboutit à aliéner toute marge de manœuvre de la personne au bénéfice de la rentabilité immédiate. L’institution d’action sociale réduit alors ses ambitions à la simple gestion d’un rapport quasi marchand avec ses usagers, elle s’enferme dans l’administration d’une double contrainte, parfois contradictoire, d’une part le plus bas coût possible de la prestation, d’autre part la satisfaction de l’usager-client. C’est ce ratio coût/satisfaction qui détermine la qualité.
Cet appauvrissement de la mission de l’institution s’accompagne d’une perte de signifiance des actions. A la contrainte de la conformité s’ajoute alors l’aliénation de la vacuité de sens. C’est dans ce contexte déprimé que peut naître une réaction défensive des intervenants. Car les usagers, titulaires de nouveaux droits, peuvent alors apparaître comme une menace, une atteinte aux prérogatives professionnelles fragilisées.
Finalement, nous pourrions penser que l’usager armé par la nouvelle loi sociale va partir à l’asseau des forteresses assiégées que sont nos établissements et services. Cette perspective alimente toutes les guerres de tranchées que pourrait faire naître une opposition stérile entre droit des usagers et prérogatives des salariés. Nous voyons là comment un rapport trop simpliste au droit conduira à réifier les protagonistes de l’action sociale, renvoyant chacun dos à dos.
LE DROIT COMME LEVIER DE CHANGEMENT
Une autre perspective, le second étage de la fusée, consiste à envisager le droit comme un moyen de faire changer les choses. Le rapport au droit est alors moderniste, inscrit dans une volonté de mouvement et de progression. Cette tendance est, je pense, celle qui a animé les décideurs politiques dans la conduite de la réforme de la loi de 1975. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux n’ont pas suffisamment évolué, il faut affirmer plus clairement le cadre des droits nouveaux dans lequel ils doivent s’inscrire : renforcement du droit des personnes accueillies, clarification des relations avec les instances de contrôle, amélioration des coordinations.
Passer du « public » à la personne accueillie :
Cette évolution est sensible par la volonté du nouveau texte de passer de la notion de « public » à la notion de personne. Le premier terme, qui existait dans le texte de 75 a totalement disparu en 2002.
L’usager est devenu une personne ! Le message est clair, il s’affirme par des dispositions très précises qui ne seront pas sans incidences sur le fonctionnement concret des établissements et services. L’usager est une personne disposant d’une capacité à formuler son avis ! La loi garantit explicitement à toute personne accueillie ou accompagnée « La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. » (art. 311-3, 7° du CAFS). L’usager, en tant que personne, est même reconnu capable de contracter à travers le document individuel de prise en charge qui détaille la liste et la nature des prestations ainsi que leur coût prévisionnel (Cf. art. 311-4).
L’usager est aussi un citoyen ! C’est à ce titre qu’il dispose d’un droit d’accès à nos productions écrites. Nous savons tous que l’accès au dossier est une question de pleine actualité : La loi sur le droit des malades vient d’autoriser l’accès au dossier médical, la loi rénovant l’action sociale pose pour la personne accueillie le principe de « L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge. » et nous attendons, à la suite du travail de la commission Deschamps qu’un décret confirme le droit d’accès direct au dossier d’assistance éducative. Mais l’usager devenu citoyen a également un droit de regard sur nos organisations. C’est essentiellement le conseil de la vie sociale qui concrétisera cette tendance lourde de l’évolution de la place des usagers dans nos institutions. Vous me direz que l’AEMO n’est pas concernée. Elle le sera ! Si ce n’est sous la forme d’un conseil, les services de milieu ouverts devront disposer de moyens adaptés pour « associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement ou du service. » (art. L.311-6 du CAFS)
L’usager est sujet de droit ! Une charte des droits et devoirs de la personne accueillie doit être remise lors de l’accueil dans un établissement ou un service. Un droit de recours est instauré par l’établissement d’une liste de personnes qualifiées auxquelles les usagers pourront faire appel « en vue de [les] aider à faire valoir [leurs] droits. » (art. L.311-5)
Passer d’une logique de dispositifs à une logique d’action :
Cette façon d’utiliser le droit comme stratégie de changement peut porter ses fruits. Elle peut nous permettre de quitter une conception administrative et planifiée de l’intervention sociale au bénéfice d’une dynamique plus centrée sur l’action menée. Les conséquences à prévoir de cette mutation sont importantes.
D’abord, elles modifient les positions d’acteurs au sein de nos organisations. Pour cela, les places et les rôles doivent trouver de nouveaux fondements. Les postures traditionnelles, souvent empreintes de rapports de supériorité, sont réinterrogées. Le professionnel est invité à descendre de son piédestal pour jouer un jeu « gagnant/gagnant » avec les usagers. Sur ce point, il nous faudra évaluer ce que fera bouger l’émergence de la contractualisation dans la relation d’aide. Y compris d’ailleurs dans l’aide contrainte, judicaire, qui ne peut plus faire l’économie d’une négociation sur la forme, avec les bénéficiaires. Un dispositif ne se discute pas, il s’exécute. Une action tenant compte de la personne ouvre, au contraire, à un débat de tous les instants sur ses modalités concrètes.
Les rapports de pouvoir sont également réinterrogés. D’une part le pouvoir des professionnels sur les usagers, mais aussi les rapports hiérarchiques internes à nos organisations. Dans les perspectives citoyennes ouvertes par la nouvelle posture des usagers, le pouvoir ne peut plus se justifier comme quelque chose qui va de soit, il doit s’expliciter. Le pouvoir, pour être légitime, doit s’appuyer sur la compétence, la capacité à tenir compte de l’autre, le respect de règles démocratiques. Il me semble certain que le conseil de la vie sociale ou les autres formes de participation des usagers feront sensiblement bouger les choses en ce domaine.
Les institutions elles-mêmes doivent refonder leur légitimité. Elles sont en effet guettées par un risque de marchandisation de l’intervention (Pour mémoire, rappelons-nous le libre choix entre les prestations prévu par la loi de 2002, ou la possibilité de changer de référent entrevue par le rapport Naves et Cathala). L’action sociale se verrait alors digérée par la mondialisation de l’économie marchande qui engloutit tout projet humain dans des rapports de profit. La relation d’aide devient une prestation de service, quantifiable, mesurable et évaluable selon des critères strictement monétaires : l’usager en a-t-il pour son argent ? Pour échapper à ce risque de marchandisation, les institutions d’action sociale doivent refonder leur légitimité sur l’efficience des actions et leur capacité à répondre effectivement aux besoins des personnes que leur désigne leur mission.
En ce sens, la loi nous incite à passer d’une logique de prise en charge à une logique d’accueil centrée sur la personne accueillie. Le livret d’accueil, comme le document individuel de prise en charge ou la participation active de la personne à l’élaboration du projet individualisé, sont autant d’éléments qui permettent d’atteindre cet objectif. L’individualisation de la logique d’accueil ne doit pas pour autant nous faire perdre la force des projets fondateurs de nos institutions.
On voit ici qu’une approche moderniste de l’action sociale, inscrite dans un rapport au droit qui vise le changement, risque de standardiser les pratiques. C’est la raison pour laquelle nous défendons l’ajout d’un troisième étage à notre fusée :
FAIRE SOCIETE ENSEMBLE
Ce troisième niveau place le rapport au droit au niveau d’un débat de société. Si le droit est porteur des valeurs du « vivre ensemble », il doit être un espace de débat sur le projet de société, il devient un enjeu politique au sens noble du terme.
L’usager, sujet de droit, devient sujet politique :
Cette perspective ne peut plus se contenter d’enfermer l’usager dans son statut de sujet de droit. L’usager devient sujet politique par sa capacité à occuper sa place dans le débat de société.
L’individualité, pas l’individualisme !
Si l’usager n’est plus circonscrit dans des droits formels, instrumentalisés, tout ce qui le concerne doit être relié au collectif. En effet, un usager titulaire de droits au sens égocentrique du terme est emprisonné dans l’individualisme, isolé du lien social, satellisé.
C’est en ce sens que nous rejoignons les propos de Chantal Humbert[4] qui déclare que « Prendre en compte l’individu, c’est en soi un projet collectif. » En effet, l’individualité reconnue vient s’articuler au collectif d’appartenance, elle est le contraire de l’exclusion et de l’anomie.
C’est également en ce sens que nous appuyons les propos de François Noble[5] qui s’insurge contre l’expression « placer l’usager au centre des institutions. » Cette vision des choses est profondément marquée par l’individualisme qui privatise tous les champs relationnels, y compris l’espace public que représente l’action sociale. D’un grand dessein humaniste voulant concrétiser le principe révolutionnaire d’égalité, le travail social devient une sorte de huis clos confidentiel qui isole un intervenant dans sa relation à l’usager. Placer l’usager au centre revient à précipiter les établissements et services dans le désordre des droits égoïstes : le chacun pour soi ! A l’inverse, une institution centrée sur l’usager est une institution qui a su donner une perspective à son action. Au lieu de tourner en rond autour du nombril de l’usager sacralisé, les professionnels se mobilisent vers lui, ce qui me semble être le préalable indispensable pour ensuite se mobiliser avec lui.
Défendre l’individualité de toute personne accueillie ou accompagnée c’est refuser de stigmatiser les personnes dans des catégories génériques : on parle alors de l’Usager avec un U majuscule. Cette sacralisation de la personne en difficulté est une façon de la vider de sa dimension politique. Classé dans une catégorie désignée de population, l’usager devient un sous-citoyen et les droits qui lui sont concédés sont des sous-droits qui n’ouvrent pas au droit commun mais l’enferment dans l’impasse de l’exclusion. Parler des usagers au pluriel, c’est toujours faire référence à la singularité des personnes, de leurs histoires de vie. C’est une façon de rappeler que la vie sociale c’est la diversité, l’impossibilité d’enfermer l’autre dans des figures toutes faites. C’est pourquoi nous parlons du droit des usagers et non des droits de l’usager. Le singulier de « droit » rappelant que ce droit là n’est qu’une déclinaison particulière des droits de l’Homme.
Les droits de l’Homme, pas des droits particuliers ! Pour que notre rapport au droit contribue à construire l’espace public, il faut nous référer aux droits de l’homme qui donnent une perspective claire à nos rapports humains. C’est bien des droits de l’homme que nous parlons, pas des droits de la personne !
Les droits de l’homme se fondent sur la résistance à l’oppression, la dénonciation du despotisme et le combat contre l’arbitraire. Ils impliquent la vigilance de chaque citoyen à l’égard de toute instance de pouvoir. Ils ne sont jamais définitivement acquis. « Ils sont continuellement à défendre, à soutenir, à préserver, à acquérir, à conquérir. Ils sont l’expression d’une revendication toujours recommencée, toujours engagée, envers le pouvoir.[6] »
Les droits de la personne quant à eux sont l’image des visées individualistes qui pervertissent les origines du travail social. Ils réduisent les droits publics à l’horizon individuel et circonscrivent la promotion de l’individu à sa simple protection dans le registre de la soumission.
Pour passer de la logique individualisante au débat citoyen, il nous faut donc retrouver les racines profondément révolutionnaires des droits de l’homme. Cette dynamique nous amènera à quitter la figure emblématique de la victime pour prendre en compte les dysfonctionnements sociaux dont les personnes auxquelles nous nous adressons sont les symptômes.
Faire société ensemble, c’est quitter le faux débat des droits et des devoirs (« Vous dites que les usagers ont des droits, parlons aussi de leurs devoirs ! ») pour entrer dans la dynamique de la responsabilité. S’il est vrai qu’il est extrêmement humiliant pour une personne de ne pas être reconnue dans ses devoirs, c’est-à-dire apte à assumer ses obligations sociales, c’est la réhabiliter dans sa dignité d’Homme et de citoyen que de la convoquer dans sa responsabilité. Etre responsable, c’est reconnaître la paternité de ses actes et savoir en répondre devant la collectivité.
Le travail social devient travail sur la société :
Concevoir son rapport au droit comme capacité à faire société avec les autres confère une dimension ambitieuse au travail social. Le travail social devient travail sur la société en ce sens qu’il interroge, de la place particulière qu’il occupe, la fonction politique de l’action sociale et des professionnels du secteur.
Nous sommes alors bien loin de cette idée de consensus entre professionnels et usagers qu’on voudrait nous faire avaler comme un gage de qualité du travail. Si ce critère de satisfaction est pertinent dans le commerce ou la production de biens matériels, il n’est d’aucun secours dans des professions éducatives et sociales dont les moteurs essentiels sont plutôt la frustration, l’interdit, le rappel de la loi, l’opposition.
Pour que notre action contribue effectivement à construire l’édifice démocratique, il nous faut conflictualiser le rapport usagers / professionnels. Ce terme n’induit pas pour moi des pratiques guerrières mais plutôt des perspectives de débat. Nous devons créer des espaces de régulation sociale et institutionnelle qui favorisent la parole de chacun, permettent de délibérer sur le rapport entre normes et conduites et de négocier des perspectives d’action. C’est en conflictualisant le rapport usagers / professionnels, c’est-à-dire en nommant tout ce qui nous sépare, que nous contribuerons à éclairer ensemble les finalités du travail social et à clarifier les rapports sociaux dans lesquels nous sommes inscrits.
C’est en conflictualisant le rapport usagers / professionnels, c’est-à-dire en définissant les places et les rôles, que nous pourrons ensemble élaborer des principes de vie commune fondés sur la gestion des rapports collectifs au sein de nos organisations.
Roland JANVIER
[1] Extrait du texte inducteur des XXIIémes assises du Cnaémo.
[2] « Mettre en oeuvre le droit des usagers dans les établissements d’action sociale » Dunod, réédition 2002.
[3] Ces trois niveaux se réfèrent à la typologie des associations présentée par Jean Afchain dans son ouvrage « Les associations d’action sociale » Dunod, réédition 2001.
[4] « Les usagers de l’action sociale, sujets, clients bénéficiaires ? » L’Haramattan – 2000
[5] Ibid.
[6] « Droits de l’homme et droits de la personne : réflexions sur l’imprudence d’une indistinction » Geneviève Koubi, revue internationale de psychosociologie, 2000, Vol. VI, n°15.
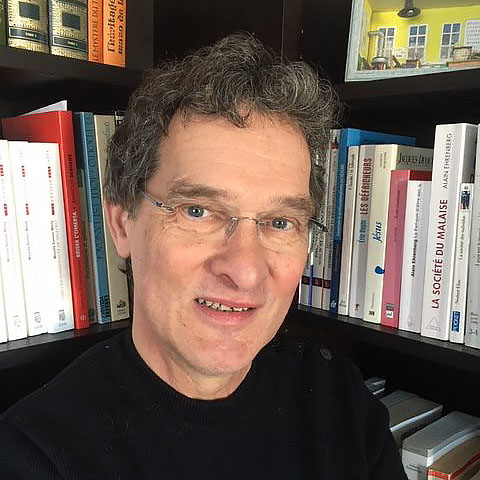
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.


