Plutôt que d’écrire un article didactique sur cette question, nous proposons un échange de réflexions sur ce thème afin de les confronter.
Les travaux que nous avons menés ensemble[1] et que nous poursuivons encore[2], nous ont amenés à adopter une position stratégique qui n’emprunte rien à un quelconque angélisme : la refondation des pratiques et des légitimités qu’impose la nouvelle posture de l’usager dans l’action sociale nécessite une attitude offensive. En fait, c’est lorsque les directions et les équipes se saisissent des enjeux contemporains, au travers d’une « nouvelle alliance » entre professionnels et usagers, que nous contribuons à l’avènement de l’action sociale du XXIème siècle. C’est cette ligne d’action que nous souhaitons approfondir ici.
Malgré notre vieille complicité et nos fortes proximités théoriques, les discussions entre nous sur les différents sujets d’actualité demeurent présentes, c’est tout l’intérêt de cet exercice épistolaire : c’est par la différence que les idées progressent. Il en est de nos discussions intellectuelles comme de la place des usagers dans les institutions sociales, c’est le repérage des différences (divergences d’intérêts, zones de conflits, disparité des places…) qui fait avancer le « système ».
.1. LA GESTION DES RISQUES[3]
Roland JANVIER :
Le petit opuscule passionnant qu’a rédigé Robert CASTEL sur « l’insécurité sociale »[4] montre l’évolution de l’individualisme qui « désenchasse » l’individu des liens de solidarité primaire, l’amenant à trouver seul la manière d’assurer sa sécurité. Ce mécanisme égoïste pousse chacun dans une recherche éperdue de sécurité, du « risque zéro ». Illusion dit-il : « On constate plutôt que, lorsque les risques les plus prégnants paraissent jugulés, le curseur de la sensibilité aux risques se déplace et fait affleurer de nouveaux dangers.[5] » C’est un cercle vicieux qu’il dénonce avec humour : « La recherche du risque zéro en matière alimentaire serait dès lors de s’abstenir de manger[6] »
Dans ce contexte où la demande de sécurité confine au sécuritaire, la montée en puissance du droit des usagers dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux suppose de repenser autrement la gestion des risques. Les modifications sensibles des places et des rôles dans les organisations, l’irruption de nouveaux outils pour garantir les droits des personnes accueillies, l’évolution de la visibilité et de la lisibilité des dispositifs – notamment par la généralisation de l’évaluation – sont autant d’éléments qui ne permettent plus de penser aujourd’hui les risques comme on pouvait les envisager il y a quelques dizaines d’années.
Mais que dit-on en parlant de gestion des risques ? Entend-on cette attente sourde et diffuse des citoyens d’être garantis sur tout, de tout, pour tout et contre tout ? Dans ce cas, R. Castel est clair : « L’homme moderne veut absolument que justice lui soit rendue dans tous les domaines, y compris dans sa vie privée, ce qui ouvre une large carrière aux juges et aux avocats. Mais il voudrait tout aussi absolument que sa sécurité soit assurée dans les détails de son existence quotidienne, ce qui cette fois ouvre la voie à l’omniprésence des policiers.[7] »
La gestion des risques, et la sécurité qui l’accompagne nécessairement, peuvent facilement tourner au dictatorial quand elles sont pensées dans une « société d’individus » isolés : chacun exerçant la tyrannie de ses désirs sur l’autre et tous les autres (c’est ce qui se profile derrière la dénonciation de l’usager-roi)
Pour sortir de l’impasse, il me semble que la question à se poser est la suivante : Comment gérer collectivement les risques dans une société composée d’individualités plus que d’individus (c’est-à-dire de sujets reconnaissant leurs interdépendances) ? Autrement dit, pour éviter de renvoyer tout le poids du risque sur l’individu (par exemple, le directeur d’une institution ou le Président d’une association), quels seraient les supports qui permettraient de collectiviser l’approche des risques ?
Cette question ouvre des perspectives plus intéressantes. La gestion des risques devient une affaire publique, voire politique. En effet, il faut alors délibérer pour savoir quels sont les risques à « assurer », ceux dont il faut se prévenir (faut-il se prémunir coûte que coûte des regroupements de jeunes dans les cages d’escalier ou plutôt des actes de vandalisme forts coûteux des manifestations d’agriculteurs devant les préfectures ? Faut-il se prémunir avant tout d’un mauvais usage des prestations familiales par certains parents ou plutôt des concentrations capitalistiques et de la spéculation ?).
Pour faire le lien avec le sujet qui nous est cher à tous les deux – le droit des usagers – je propose une piste à explorer :
Jusque-là, les professionnels – parce qu’ils avaient quelque peu confisqué le pouvoir aux usagers – étaient les seuls à définir les risques à traiter dans le travail social et éducatif. J’ai déjà tenté d’écrire à quel point l’acte éducatif me semble un acte risqué[8], mais un risque qu’il faudrait fonder sur des pratiques institutionnelles démocratiques. Aujourd’hui, il m’apparaît que le droit des usagers, tel qu’il a été instauré dans la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale, amène les professionnels à confronter leur conception du risque avec celle des personnes auxquelles ils s’adressent. Le pouvoir peut (doit ?) désormais être remis en circulation dans la relation d’aide.
Bien entendu, il est des situations où les usagers mettent les professionnels en position de risque. Mais avons-nous suffisamment conscience que l’inverse existe aussi ? Est-on prêts à entendre les usagers s’exprimer sur les risques qu’ils vivent, du fait de leur situation personnelle, mais aussi du fait des conditions dans lesquelles les placent les dispositifs d’intervention sociale ? Est-on prêts à échanger avec des groupes d’usagers sur la façon dont les uns et les autres vivent les situations à risque ?
Une co-construction entre usagers et professionnels sur le repérage des risques – les choix à faire (les risques que l’on prend en compte et les autres), les réponses à apporter – me semble être une voie largement ouverte par les nouvelles places qu’occupent les usagers dans les établissements et services. C’est aussi une manière de « désindividualiser » la prise de risque pour la réincorporer dans sa dimension sociale et politique.
Est-ce utopique de le dire ainsi ?
Yves MATHO :
Assumer une place de directeur implique, de prendre le risque d’être confronté à la gestion de situations complexes, à des conflits, à des responsabilités, à des interpellations diverses et variées. Tout engagement entraîne une prise de risque certes calculée mais qui n’est pas couverte par une assurance multirisque qui préserverait de tous soucis annexes.
La gestion des risques est donc inhérente à tout poste de responsabilité. L’évolution de notre secteur d’activité comporte des transformations notamment en matière de gestion des risques. La judiciarisation des rapports humains dans l’ensemble de la société, n’épargne pas le social ou le médico-social.
La population accueillie dans les établissements et services est souvent qualifiée comme étant à risque par toute une frange de la société. Toute situation venant conforter ce sentiment crée une réactivation de l’inquiétude et une montée de la tension qui interpelle les conséquences des risques pris. Le regard extérieur vient de plus en plus évaluer le travail accompli et les décisions prises en interne nécessitent débats, négociations, argumentation avant application.
L’évolution de la société et une certaine uniformisation des procédures et des conditions règlementaires entraîne une modification des situations. Ainsi, les situations qui apparaissent comme à risque actuellement ne l’étaient pas nécessairement il y a une ou deux décennies. Prenons le cas des repas de collectivité. Les méthodes HACCP sont venues définir de nouvelles normes visant à rendre le service des repas au moindre risque pour le consommateur. Le directeur se doit donc de passer sous les fourches caudines des réglementations pour ne prendre aucun risque concernant l’hygiène alimentaire. Les contraintes nouvellement formulées ont entraîné des remises aux normes des cuisines de collectivité. Dans la majorité des cas, cette remise aux normes a impliqué une refondation totale du système de repas et le remplacement de la cuisine traditionnelle en sous-traitance alimentaire. Ainsi, la gestion du risque de ne pas être en capacité de respecter les nouvelles normes (associé à des questions de rationalisation budgétaire) a entraîné une modification fondamentale des pratiques institutionnelles en renvoyant sur la sous-traitance la gestion directe du risque. Les bouleversements des pratiques, autour des repas a certes permis des économies financières et un allègement des responsabilités pour le directeur mais a parallèlement modifié profondément les systèmes de communication autour des repas, la dimension éducative qui en découlait et la dynamique institutionnelle tout simplement humaine du quotidien.
L’avis des usagers a rarement été sollicité lors des décisions de cet ordre.
Si cela avait été le cas, il est peu probable qu’ils aient adhéré à l’évolution décrite. Cependant, les êtres humains étant complexes dans leurs relations, il est aussi peu probable que les usagers acceptent les risques encourus au quotidien. Le coupable est vite désigné dans des situations accidentelles et la victime doit être indemnisée des désagréments subis.
Ainsi, le directeur se voit dans une situation complexe et paradoxale devant à la fois gérer le risque d’être à la limite des règlementations toujours plus contraignantes et de pouvoir permettre aux équipes de réaliser des projets prenant en compte la responsabilité individuelle et collective.
Il n’y a pas d’évolution humaine sans prise de risque.
Il n’y a pas d’évolution des projets, des techniques, sans expérimentation et donc sans risque d’échec.
La maîtrise du feu aurait-elle été réalisée si l’homme n’avait pas pris le risque de se brûler ? L’avion aurait-il été inventé si des pionniers n’avaient pris le risque de s’écraser au sol ? Les exemples seraient nombreux à travers les siècles du lien entre l’évolution et la prise de risque. Le rapprochement avec notre secteur peut paraître hasardeux. La similitude entre l’expérimentation et l’évolution est cependant repérable. Dans le domaine éducatif, l’enfant, l’adolescent a besoin d’être accompagné pour repérer les limites, pour réaliser des expériences constructives, pour lui permettre de se confronter à ses capacités de responsabilisation. Il en est de même pour un établissement ou un service. La responsabilisation de chacun et de l’équipe nécessite des espaces dans lesquels les prises de risques sont certes calculées mais indispensables.
Il me semble que dans cette conjoncture, il devient d’autant plus urgent d’associer les usagers aux projets et aux enjeux des risques nécessaires pour leur construction personnelle et sociale.
La gestion des risques renvoie à la notion de responsabilité. Il est vrai que différents niveaux doivent se décliner pour repérer la responsabilité individuelle de la personne. Ainsi, le niveau politique définit le cadre général. Celui-ci ne peut se dédouaner de sa propre responsabilité pour désigner la personne sur laquelle va se porter le risque quotidien. Ne pas prendre en compte des situations sociales en y répondant exclusivement par des mesures de répression, ne peut ni ne doit pas faire peser sur le travailleur social un risque impossible à maîtriser. Comment dès lors accepter d’assumer des situations qui comportent des risques graves de dysfonctionnement institutionnel ?
Dans le cas d’admission en établissement médico-social, la responsabilité du directeur vient en complète contradiction avec la diminution de son pouvoir d’admission. Les situations à risque, dans l’accueil de populations très fragiles psychiquement et physiquement vient quelquefois en complète contradiction avec l’admission de jeunes présentant une symptomatologie comportementale sur le mode de la violence extrême ou de la manipulation. Les évolutions récentes accentuent encore cette situation en plaçant les professionnels dans une position d’exécutant de projets personnalisés conçus hors de ces contraintes institutionnelles et de leur avis éclairé.
La seule possibilité de poser un cadre sécurisant pour tous est de négocier avec les personnes concernées les conditions d’accueil, sans omettre de poser les paramètres en jeu.
Définir les risques semble nécessaire. L’impossibilité de poser une liste exhaustive de ces risques rend la faute toujours possible.
Ne pas se trouver quotidiennement devant la tension de la prise de risque, accepter l’élaboration de projets collectifs, permettre un réel travail personnalisé nécessite de se dégager de l’individualisation, de la surveillance stérile et de partager une relation de confiance minimum, entre les professionnels, avec les usagers et /ou leurs représentants. La conscience politique et sociale, passe par une acceptation des règlements de vie de la structure, des contraintes de la vie collective, du respect des autres, de leur culture, de leur mode de vie.
Il n’est certes pas utopique de penser que la conscience collective vise à apaiser les relations humaines et à modérer les tendances à l’égoïsme naturel auquel chacun est confronté. La dimension politique et sociale devient alors une composante naturelle du développement individuel.
.2. LES CONTRAINTES DIVERGENTES DU DROIT
Roland JANVIER :
Comme nous l’avons déjà constaté, ensemble, le dispositif de droit des usagers conçu dans la loi 2002-2 n’est pas un chef d’œuvre de cohérence. D’abord parce que cette loi est le résultat de compromis plus ou moins heureux entre décideurs politiques, d’autre part parce que la problématique est complexe, enfin parce que la question est socialement sensible.
Le résultat est que le droit des usagers est en tension entre des pôles différents :
- Injonction à garantir la sécurité des bénéficiaires dans un contexte particulièrement incertain et insécure ;
- Obligation générale de confidentialité assortie de la nécessité de communiquer « tout document ou information » à la personne accueillie ;
- Incitation à la participation à la vie de l’établissement ou du service pour des individus qui ne sont déjà pas acteurs de leur propre vie ;
- Attribution d’un statut à des usagers qui ne veulent surtout pas s’identifier à la place stigmatisante que leur assigne l’intervention sociale ;
- Transfert de responsabilités à des personnes trop fragiles pour les assumer…
Certains de nos collègues dénoncent ces tensions comme des « injonctions paradoxales ». Cela me semble excessif, la double contrainte rend fou, nous ne sommes pas encore dans l’aliénation. Je préfère, pour ma part, parler de tensions, voire de paradoxes, qu’il nous revient de résoudre un peu comme des énigmes.
Ma conviction est qu’un système de droits sans ambiguïté, sans failles, sans espaces de négociation éthique, sans marges de manœuvre, est un système totalitaire qui évite au sujet de prendre personnellement position, d’être auteur de sa vie. Les contraintes législatives, par leurs ambivalences, ouvrent des espaces à la réflexion éthique, c’est-à-dire à un questionnement renvoyant aux valeurs morales du sujet, non réglé a priori par un cadre normatif. Loin d’être cause d’incohérence, ces contraintes divergentes créent une dynamique : à nous de prendre en main, collectivement, le débat sur les valeurs qui guideront nos choix face aux incertitudes.
Lors de nos diverses interventions devant des équipes professionnelles, leur tentation, fréquemment exprimée, d’entendre de nous des recettes sur les bonnes façons de procéder étaient massives. Mais lors des bilans finaux, ils ont su témoigner de la dynamique que provoque pour eux le fait de repartir avec plus de questions qu’à leur arrivée.
J’ai pu constater la dynamique institutionnelle qui naît du fait que ces questionnements – éthiques et déontologiques – soient partagés avec les usagers eux-mêmes. Les professionnels découvrent que les usagers peuvent leur donner des clefs pour résoudre les énigmes qu’ils rencontrent. Les usagers découvrent que les professionnels ne sont pas si sûrs de leurs réponses et que cela est une richesse pour eux. Je pense là très concrètement à des groupes de parents animés dans des établissements ou services de protection de l’enfance.
Cette notion de paradoxe a été travaillée par Michel Autès[9], il montre bien que le travail social n’existerait plus s’il parvenait à résoudre ses contradictions, les tensions qui le structurent. A sa suite, je tente d’esquisser une troisième dimension pour sortir de l’opposition, stérile à mes yeux, entre tel point de droit et tel aspect des pratiques (par exemple entre l’obligation générale de sécurité et la prise de risque que représente l’accompagnement éducatif d’un enfant) ou entre deux points de droit (par exemple entre l’obligation de confidentialité et le droit d’accès aux informations). Les opposer comme contradictoires – donc insolubles – revient à cliver la pensée. Les mettre en tension, c’est-à-dire profiter de l’espace ouvert par l’incertitude pour réfléchir sur le sens de l’action, transcende les pratiques.
N’est-ce pas la chance d’un nouveau positionnement de l’intervention sociale : intégrer pleinement la complexité du travail social et médico-social en l’interrogeant collectivement dans le registre des valeurs sous l’angle de ses contradictions internes et externes, jamais résolues, toujours en tensions ?
Yves MATHO :
Tout juriste sait parfaitement que le droit est écrit pour permettre son interprétation. De là les jurisprudences qui précisent, en fonction de l’évolution de la société, des règles de vie collectives, des tendances évolutives de tout groupement social.
C’est pourquoi il ne m’apparaît pas du tout incongru de faire avec les lois telles qu’elles sont énoncées (même si leur multiplication restreint les espaces de liberté et l’équilibre que créent les us et coutumes progressivement élaborés), en élaborant des espaces de négociations internes entre tous les acteurs de la vie collective.
Cependant, certaines directives demeurent complexes à respecter tant le balisage des risques à été contradictoire entre les différentes logiques. Pour reprendre l’exemple énoncé plus haut sur la mise aux normes des cuisines, le carrelage du sol doit pour les services vétérinaires et la DDASS obligatoirement permettre un nettoyage parfait quotidien (textes à l’appui) et donc du carrelage lisse. Pour les services de la DDTE par contre, ce carrelage se doit d’être antidérapant et donc être en opposition avec les autres règlements.
Vous avez dit paradoxal ?
En ce qui concerne les règlements de fonctionnement des établissements et services, la prise en compte des projets institutionnels, des principes de vie collective, des positions éducatives, des soins nécessaires vient quelques fois en contradiction fondamentale avec les positions parentales. L’ouverture du secteur social et médico-social sur l’environnement, son assimilation progressive au droit commun, modifie profondément les repères sur lesquels le directeur s’appuyait jusque là pour énoncer le cadre de fonctionnement. Les nouvelles contraintes sont d’abord externes, ce qui pourrait entraîner la mise en place de règlements internes dans une évolution sécuritaire : « Ces contextes (…) limitent le pouvoir de chacun et contribuent à diluer les espaces de délégation et de responsabilité. (…) Le directeur peut être alors tenté de se protéger au travers de la règle et de la délégation formelle : il peut en découler un risque de fonctionnement bureaucratique et un « réflexe sécuritaire » qui réduit alors de fait la portée de l’implication nécessaire dans l’exercice de la responsabilité impartie à tout dirigeant en fonction. »[10]
Je suis assez en accord avec l’idée qu’il convient de faire un effort particulier pour élaborer de nouvelles logiques de fonctionnement.
S’arrêter aux injonctions qui peuvent paraître paradoxales empêche tout travail de la pensée pour s’en tenir à la plainte, aux regrets ou à l’agressivité.
Tenter d’apporter des réponses en déplaçant l’analyse, la façon de réfléchir aux nouvelles contraintes, ouvre la réflexion, la communication et réinstalle dans la vie, dans l’actualité, dans l’évolution sociétale, un secteur qui se doit d’être au cœur de ces mouvements.
Il est effectivement étonnant de constater avec quelle intelligence, les professionnels sont en capacité d’innover en s’adaptant à l’évolution extérieure quand ils s’autorisent à penser.
Les nouvelles orientations nécessitent de considérer très différemment l’usager et/ou ses représentants légaux, dans ses capacités « partenariales ». Il en est de la gestion des risques comme dans les autres dimensions éducatives ou thérapeutiques. Cette évolution nécessite l’obligation de développer les raisons de tel ou tel positionnement, de tel ou tel projet, et donc d’être beaucoup plus rigoureux dans l’élaboration des pratiques. Doit-on s’en plaindre ou doit-on s’appuyer sur cette évolution pour faire valoir des compétences réelles et souvent peu reconnues ?
.3. LA PREVENTION DES CONTENTIEUX
Roland JANVIER :
De nombreux professionnels de l’action sociale ont exprimé leur crainte que la loi de rénovation sociale n’ait pour effet d’accroître les procédures judiciaires. L’usager, affermi dans ses droits, revendiquant un droit quasi-absolu à la sécurité, conscient des failles ouvertes par les incohérences de la législation, s’engouffrerait dans une judiciarisation de ses relations avec les institutions …
Tout d’abord, il ne me semble pas, bien que ne disposant pas de statistiques sur ce point, que les procédures judiciaires entre usagers et établissements ou services aient explosé ces derniers temps, et plus précisément depuis la loi 2002-2.
Ensuite, il n’est pas sûr que le risque procédural ne soit que du côté des usagers. A constater la manière dont certains responsables d’établissements cherchent à « bétonner » leurs contrats de séjour, il me semble que le souci de se « protéger » est parfois plus du côté des intervenants que des usagers…
Nous avons écrit ensemble, au sujet de la conflictualité : « … cette conflictualité, organisée par le procédé des représentations et des mandats, est un régulateur influant de la démocratie institutionnelle. C’est le moyen d’éviter de renvoyer les acteurs dos-à-dos dans la solitude de leurs difficultés (personnelles ou professionnelles), mais aussi de trouver de nouvelles légitimités pour chacun par la reconnaissance de la parole des uns et des autres. C’est enfin l’occasion de dynamiser les relations entre les personnes en développant des identités collectives. [11]»
Je reste convaincu que c’est par la voie de la conflictualité qu’il nous faut aborder la judiciarisation des rapports afin de positiver les perspectives de travail. Le droit des usagers peut emprunter deux voies : celle du consensus ou celle de la conflictualité.
La première voie, consensuelle, repose sur l’illusion que les rapports sociaux sont solubles dans la pureté de la relation d’aide. Vouloir le bien de l’autre serait une posture suffisamment noble pour qu’elle aboutisse à l’accord de l’usager. Je pense ici à cette phrase de St-Vincent de Paul, plus lucide, qui disait à ses Filles de la Charité : « Vous aurez, mes filles, à vous faire pardonner des pauvres tout le bien que vous leur faites ! ». Cette voie consensuelle mène inévitablement à la désillusion, parce que les rêves ont toujours une fin, elle est peut-être une ligne droite vers la procédure judiciaire. Le juge étant ici convoqué, selon les cas de figure, à ravauder une fusion impossible, à venger l’affront d’une trahison, à désigner un responsable de la déconvenue relationnelle, etc.
La perspective d’un consensus possible, rejoue insidieusement des rapports de domination qui ne disent pas leur nom, la perpétuation d’un asservissement des échanges à la culture dominante. Soit elle « récupère » l’usager qui se soumet à ce jeu de dupes, soit elle le pousse à des comportements d’évitement, de contestation ou de rupture, au repli défensif, à l’opposition ou au conflit ouvert.
La seconde voie, conflictuelle, est à distance de l’illusion d’un accord parfait, elle se fonde sur le rapport d’altérité, la conscience que la frustration est au cœur de tout rapport à l’autre. La notion de conflictualité introduit au cœur de la relation d’aide la disparité des places et des rôles, des rapports sociaux et de leur violence, la douloureuse question, dialectique, du rapport entre normes et comportements. La conflictualité ne clôt pas la relation sur elle-même, dans le colloque singulier du face à face, elle ouvre aux interactions au-delà des sujets, à leurs appartenances culturelles, à leurs identités sociales, à leurs liens collectifs…
Cette voie n’évite pas automatiquement la judiciarisation du rapport mais l’intègre comme un des vecteurs possibles – et acceptable – de la conflictualité. Le juge n’est pas, ici, en position d’arbitre, il est en position de tiers ce qui n’a pas la même signification.
N’oublions pas que la judiciarisation ne signifie pas l’échec de la relation. Le droit de faire valoir ses droits en justice signifie que ceux-ci ne sont pas de simples incantations, ni des vœux pieux qui n’engagent concrètement personne. Bien entendu, il n’est pas souhaitable de voir se multiplier les procédures, faisant ainsi la fortune des avocats et consommant un temps important de la fonction de direction. Mais sommes-nous prêts à accepter la perspective judiciaire comme une opportunité à instaurer « pour de vrai » un régime de droit dans les établissements et services sociaux et médicaux sociaux ?
Yves MATHO :
L’évolution actuelle des conflits, qu’ils se limitent à des contentieux bénins ou des actes ayant des conséquences plus dramatiques, les amène à être traités beaucoup plus fréquemment par l’autorité judiciaire. Le traitement des affaires ayant récemment défrayé les chroniques médiatiques, montre que « Au terme de cette évolution, on s’aperçoit donc que peut-être déclaré coupable non pas seulement quelqu’un qui ne voulait pas du sinistre, mais aussi quelqu’un qui n’était peut-être pas en mesure de supposer que ses agissements pouvaient même partiellement le provoquer. »[12]
Cette dérive sociétale semble une tendance lourde mais n’est pas pour autant inéluctable. Les rapports humains peuvent aussi se construire à partir de l’acceptation de la conflictualité. Je continue à penser avec Roland que cette acceptation demeure une dynamique relationnelle plus respectueuse des différences que le consensus imposé. La perte du pouvoir ancien modifie les rapports de force et crée des risques de contentieux si de nouvelles règles relationnelles ne sont pas posées collectivement.
Le conseil de la vie sociale peut effectivement offrir ce lieu de débat nécessaire à l’expression des désaccords, à la négociation, à l’établissement de règles communes progressivement élaborées. Il n’est pas question non plus de ne plus affirmer des principes, d’établir un profil minimum de l’acceptable. Le conflit est fondateur de la construction personnelle et collective.
Il est à remarquer comment la peur du conflit des parents vis-à-vis de leur jeune enfant génère des difficultés de construction de la personnalité.
L’absence d’avis différents, d’autorité cohérente, de réponse fiable, empêche tout repérage de la différence (différence générationnelle, différence des responsabilités, différence de culture, différence des sexes, différences idéologiques, …). Le manque d’acceptation de la différence génère le totalitarisme et la violence. La responsabilité des établissements et services sociaux prend d’autant plus d’importance qu’ils se retrouvent au cœur des évolutions sociétales et que les réponses que les professionnels apporteront aux questions qui émergent actuellement se rapportent à leur fonction de régulateurs des dysfonctionnements sociaux. Les risques qu’ils assument de prendre représentent des engagements des choix relationnels, et donc politiques, qu’ils veulent promouvoir.
Je suis bien en phase avec Roland sur le fait que d’ester en justice représente une ouverture de droit et d’équilibre des pouvoirs, plutôt salutaire. Cependant je reste prudent sur les dérives que peuvent prendre les relations humaines, si tous les conflits ou désaccords nécessitent de trouver résolutions par l’interpellation de la justice.
Des procès du Moyen-âge durant lequel seuls les us et coutumes faisaient office de cadre légal, aux recours actuels à la justice pour résoudre le moindre des désaccords, il faudrait que le curseur soit ramené plus au centre pour laisser l’espace au conflit et à la régulation du débat.
Il n’y a, bien sûr, pas de recette pour trouver des réponses aux contentieux ni pour les gérer. Ceci dit, les contentieux ne sont pas nombreux et la meilleure des préventions consiste à établir une communication claire, saine, assortie d’un positionnement suffisamment sécurisant pour limiter les conflits stériles et permettre les élaborations fructueuses.
En conclusion
Associer le droit des usagers avec la gestion des risques laisse à penser que les deux démarches sont intimement liées. Il serait sans aucun doute dommageable de penser que seule la montée du droit des usagers ait fait monter les risques pour le directeur dans sa gestion quotidienne. Comme si l’ouverture des établissements et services créait le dévoilement de pratiques peu énonçables.
Il nous semble beaucoup plus intéressant de penser que l’évolution du droit des usagers dans nos établissements et services, vient compenser la dérive de la judiciarisation des rapports humains dans notre société. Développer les instances de concertation et de débats, sans pour autant renoncer aux valeurs et principes des interventions et des projets personnalisés et collectifs, nous paraissent une des évolutions à construire pour notre secteur.
Gérer le risque fait partie des responsabilités de la fonction de direction.
Créer les conditions d’un accompagnement souvent emprunt d’éléments paradoxaux, que ces injonctions viennent des complexités culturelles ou de fonctionnement des univers familiaux, ou qu’elles soient issues des évolutions sociétales, ou des multiplicités des énoncés légaux, font partie des engagements quotidiens et de fondements du métier.
Prévenir les contentieux ou y faire face, est sans doute une des nouveautés qui confronte le directeur à sa relation au pouvoir. Les modifications qui en découlent vont transformer les relations au sein des établissements et services. L’acceptation des lieux de débats, des relations conflictuelles, au sens du désaccord argumenté pouvant amorcer des questionnements internes et externes, doivent se développer pour constituer les nouvelles bases relationnelles et les nouvelles contraintes pour diriger un établissement ou service.
Comment ne pas être enthousiaste devant cet espace de création qui s’ouvre devant les nouvelles responsabilités du directeur ? Rarement l’histoire a autorisé de telles transformations en si peu de temps. Sachons nous en saisir pour constituer de véritables outils démocratiques. Sachons nous appuyer sur les interprétations de la loi pour construire de nouveaux principes d’intervention qui considèrent l’usager non comme un être à part de la société, mais comme un citoyen à part entière au même titre que chacun de nous.
Roland JANVIER et Yves MATHO, 30 juin 2006
[1] R. Janvier & Y. Matho, Mettre en œuvre le droit des usagers dans les organisations sociales et médico-sociales, Dunod, 3ème édition 2004
[2] R. Janvier & Y. Matho, Figures du directeur et enjeux de la fonction, in Empan, n°61, « Management et idéologie managériale », Toulouse, Erès, mars 2006.
[3]Cf. R.Janvier & Y. Matho, Usagers et professionnels, la responsabilité d’un risque à partager, Plein cadre –Andési- avril 2001.
[4] R. Castel, L’insécurité sociale, Qu’est-ce qu’être protégé ?, La république des idées, Seuil, 2003.
[5] Ibid. p.60.
[6] Ibid. p.61.
[7] Ibid. p.23
[8] R. Janvier, Interdit, transgression, sanction, playdoyer pour une pédagogie du risque, in Journal du Droit des Jeunes, n°183, mars 1999.
[9] M. Autès, Les paradoxes du travail social, Dunod, 1999
[10] Cf. P. Lefèvre, Guide de la fonction de directeur d’établissement social et médico-social, Dunod, août 2001, p. 75.
- [11] R. Janvier & Y.Matho, La relation professionnels usagers, un conflit fécond à gérer, in « Institutions et organisations de l’action sociale : crises, changements, innovations ? » coordonné par C. Humbert, Paris, L’Harmattan 2003.
[12] Intervention de M. Pierre Calloch, Président TGI Rennes, au colloque Handilandes 2000 sur le thème « Métiers à risques et risques du métier ». Auteur de l’ouvrage : « Responsabilité civile et pénale des établissements sanitaires et sociaux ».
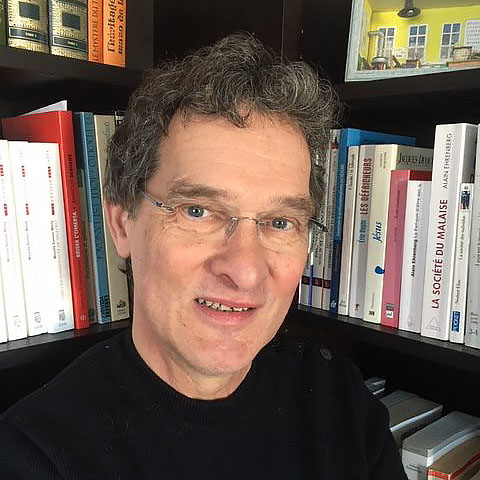
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.


